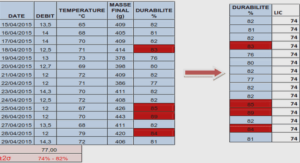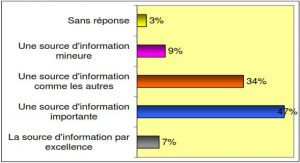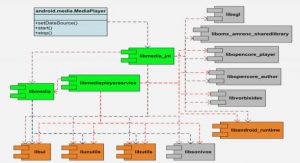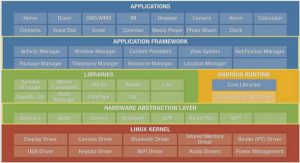Une approche positiviste aménagée
Cette terminologie reflète à la fois notre absence de naïveté et d’ignorance en démarrant notre recherche et en abordant notre terrain et notre conviction d’une capacité à tenir un discours qui est, au moins partiellement, objectivé sur le réel. Notre expérience et nos lectures nous y avaient conduit avec quelques hypothèses préalables ou « a priori théoriques ». Pour MILES et HUBERMAN (1991, p.45), « tout chercheur, si inductif qu’il soit, arrive sur le terrain, avec un certain nombre d’idées directrices, de centres d’intérêts et d’outils ». Cette reconnaissance nous a interdit le recours à une approche inductive pure et à la Grounded Theory en particulier.
Le principe de la Grounded Theory (GLASER et STRAUSS, 1967 ; GLASER, 1978) est en effet, de générer une théorie à partir des données collectées. Ses auteurs distinguent trois étapes qui sont :
1. la collecte des données (entretiens, observations, documentations) ;
2. la retranscription des données et leur codage par le chercheur. Cette étape doit faire apparaître des catégories avec leurs propriétés et des hypothèses qui les relient ;
3. le codage sélectif pour dégager une catégorie centrale (core-category) autour de laquelle sera organisée la théorie.
Cette méthode suppose de ne pas avoir trop de connaissances a priori, afin de ne pas traiter les informations collectées avec une grille de lecture préconçue et de pouvoir, au contraire, laisser émerger les concepts clés. Du fait de la littérature abondante et de notre expérience ainsi que de celle des chargés de mission d’A.L.E.X.I.S., ce n’était pas notre cas. Nous avons collecté nos données en ayant déjà quelques idées a priori.
Sans être pour autant hypothético-déductive, notre approche pourrait être qualifiée d’hypothético-inductive pragmatique. En effet, si nous sommes allé sur le terrain avec des propositions à vérifier, leur non validation ne devait pas revêtir le statut d’infirmation de la théorie, mais était au contraire susceptible de générer de nouvelles explications. Dans notre démarche, nous n’excluions pas de découvrir des propositions théoriques « enracinées dans le terrain » comme le suggère la Grounded Theory.
Selon MBENGUE et VANDANGEON-DERUMEZ (1999, p. 6), l’approche hypothético-inductive, préconisée notamment par MILES et HUBERMAN (1991), « consiste à alterner ou superposer la déduction et l’induction ».
Elle offre donc un chemin médian entre la méthodologie hypothético-déductive traditionnelle et la méthodologie purement inductive.
Comme le schématisent les auteurs (Figure 3.2), dans la première, « la connaissance précède l’expérience empirique » alors que dans la seconde « l’expérience empirique précède la connaissance ».
Dans notre cas, nous n’avons pas fait abstraction de connaissances théoriques notamment anglo-saxonnes précédant notre accès au terrain mais du fait de la spécificité contextuelle française, nous ne pouvions exclure a priori que le terrain n’amende les théories, d’où notre positionnement pragmatique.
Nous avons donc accédé au terrain avec des « idées a priori » sans exclure que de nouvelles n’émergent en cours de route. Ces « idées a priori » qui s’appuient sur la littérature recensée au chapitre précédent et sur des observations préalables sont maintenant présentées.
Un Corpus de « propositions a priori »
Nos principales « idées a priori » sont regroupées en quatre familles qui ont structuré notre travail et sont ensuite déclinables en sous-hypothèses qui s’appuient sur l’étude de la littérature. Elles sont néanmoins subordonnées à l’« Hyper-Thèse » qui sous-tend notre travail et à un axiome instrumental préalable assez commun dans la recherche Entrepreneuriat.
H0 : Axiome Instrumental : l’Homologie Porteur-Projet
La symbiose entre le Porteur et son Projet est telle que le Porteur de Projet issu de l’immigration révèle ses aspirations et sa stratégie d’acculturation en formulant et en construisant son projet.
Cet axiome s’appuie sur les travaux de BRUYAT (1993) déjà cités. Comme le rappelle FONROUGE (2002, p.14), « l’idée forte de la dialogique de BRUYAT empruntée à Edgar MORIN (1984), c’est que les dialogiques (entrepreneur/ entreprise) sont liées en une unité».
L’homologie est une des clefs de la validation du projet sous l’angle de l’adéquation homme-projet (BRUYAT, 1993), et, pour certains, serait même une caractéristique persistante de la Très Petite Entreprise (TPE), comme l’évoque régulièrement MARCHESNAY (1991, 1997) ou de tout processus entrepreneurial. C’est fort de cette adéquation homme-projet que VERSTRAETE (2000) caractérise le processus entrepreneurial dans les termes d’une relation symbiotique entre l’entrepreneur et l’organisation qu’il impulse. Dans cette perspective, pour impulser l’organisation, l’entrepreneur sera amené à faire appel notamment à ses réseaux d’appartenance pour mobiliser les ressources nécessaires afin de servir un marché spécifique susceptible de lui apporter une part de marché importante.
Dans le cas des entrepreneurs expatriés, il est assez naturel de penser que le projet incarne
l’arbitrage de l’individu entrepreneur entre son espace culturel d’origine et l’espace culturel de son pays d’accueil. Cet arbitrage signifie que l’entrepreneur immigré aura tendance, selon sa vision du monde des affaires et des possibilités qui lui sont offertes par divers milieux d’appartenance, à se référer aux deux espaces culturels de façon exclusive ou complémentaire. De ces suggestions découle l’ « Hyper-Thèse » qui structure le travail que nous défendons.
Hyper-Thèse: L’entrepreneur migrant en France s’accommode du système socio-culturel de son pays d’origine et du système socio-culturel français.
Cette Hyper-Thèse est ensuite déclinée en « Propositions a priori » de statuts différents et en « Sous-Propositions a priori »
P1: Il y a des caractéristiques spécifiques du profil des porteurs et de la nature des projets. L’entrepreneuriat immigré constitue bien un objet d’étude au sein de la recherche en Entrepreneuriat.
P2: Le public des entrepreneurs immigrés n’est toutefois pas homogène et on identifie une diversité de stratégies entrepreneuriales qui se font jour au cours de leur processus d’engagement dans les affaires.
P3: Un dispositif d’accompagnement générique répond aux besoins des porteurs de projet issus de l’immigration moyennant quelques aménagements de la part des chargés de mission. P4 : L’Entrepreneuriat est facteur d’intégration.
Tableau 3.1 : Quatre « propositions a priori » structurant la recherche.
Le corpus de propositions descriptives P1 sur la spécificité de l’entrepreneuriat immigré découle directement des théories recensées dans le chapitre 2.
La spécificité porte à la fois sur les motivations entrepreneuriales (Sous-Propositions P1.1, P1.2, P1.3, P1.4), sur la nature des projets (P1.4, P1.5), sur les difficultés rencontrées au cours du processus entrepreneurial, sur le système de gestion mis en place (P1.6, P1.7, P1.8).
Le « déplacement » lié à l’expérience de la migration n’étant qu’un élément déclencheur de l’acte d’entreprendre, nous nous attendions à retrouver chez les porteurs de projet issus de l’immigration, des motivations entrepreneuriales assez classiques, (P1.1), assorties toutefois d’une triple empreinte spécifique (P1.2 ; P 1.3 ; P1.4).
Les sous-propositions relatives aux motivations entrepreneuriales de l’immigré
P1.1 : Comme l’ont déjà montré SCHEINBERG, Mc MILLAN (1988) et de CONSIDINE, Mc MILLAN, TSAI (1988) avec des approches culturalistes, le besoin individuel de se réaliser (need of achievement) et la volonté d’indépendance et de contrôle de son propre destin (locus of control) sont des motivations déterminantes de la décision entrepreneuriale de l’immigré comme de tout entrepreneur.
P 1.2. : Les travaux sur l’entrepreneuriat africain et asiatique recensés laissent à penser que certains entrepreneurs issus de l’immigration entreprendront avec un éthos altruiste marqué, dans le souci de contribuer au bien-être de leur famille ou de leur communauté.
P 1.3. : Conformément à la théorie du désavantage, on s’attend à ce que la perception de discriminations sur le marché du travail soit un déterminant fort de la décision d’entreprendre102.
P1.4. : Enfin, on attend que l’immigrant soit aussi enclin à entreprendre par simple mimétisme comme le suggérait Murat ERPUYAN (2000) à propos des entrepreneurs turcs.
Les sous-propositions relatives à la spécificité des projets
Comme on l’a énoncé, la Théorie des Minorités intermédiaires suggère que l’entrepreneur immigré sera sur- représenté dans certaines activités intermédiaires, notamment commerciales (P1.5).
L’observation suggère également qu’il sera sur-représenté dans les activités dans lesquelles la population immigrée salariée est importante comme le bâtiment (P1.6).
Toutefois, eu égard à nos observations préliminaires (Chapitre 1) et aux travaux sociologiques (SAVELLI, 2004), nous considérons que la qualification des projets est sur-déterminée par le capital social et culturel de l’individu, quelle que soit son origine (P1.7).
Quelles que soient les motivations de l’entrepreneur immigré et la nature de son projet, la littérature lui attribue des difficultés spécifiques. Outre de possibles problèmes de compréhension linguistique ou de rapport à l’écrit (P1.8), RAY et al. (1988) qui étudient des entrepreneurs chinois de Calgary et arméniens de Los-Angeles, lui reconnaissent trois niveaux de difficultés : -un accès plus difficile au financement (P1.9), des difficultés d’adaptation aux normes locales (P 1.10) et une nostalgie du pays d’origine qui pourrait altérer sa vision stratégique.103
Conformément aux prescriptions des théories culturalistes évoquées au Chapitre 2, nous nous attendions également à ce que le système de gestion mis en place soit spécifique, notamment par une plus forte implication familiale dans le projet, (P 1.11), par une imbrication plus marquée entre économie formelle et économie informelle au démarrage du projet (P 1.12) et par un recours moins important au financement bancaire (P 1.13).
En concluant le chapitre précédent, nous avions proposé que les caractéristiques spécifiques de l’entrepreneur immigré en France étaient diluées dans la diversité. L’origine de cette diversité est d’ordre à la fois téléologique (P2.1), historique (P2.2, P2.3) et liée au diplôme du porteur de projet (P 2.4).
Les sous-propositions relatives à la diversité des projets
P2.1. En fonction de ses ambitions d’assimilation, d’intégration ou de retour au pays, l’entrepreneur immigré n’entreprendra pas dans les mêmes activités.
P2.2. On peut avancer que les entrepreneurs turcs auront davantage de projets séparatistes ou intégrationnistes que les entrepreneurs originaires du Maghreb. Cette proposition qui précise l’une des applications de la précédente pour les deux publics les plus représentés dans nos échantillons statistiques à A.L.E.X.I.S., exploite de multiples études sociologiques comme l’illustre l’encadré suivant.
P2.3. Conformément aux prescriptions de H. GANS (1992) sur les ambitions professionnelles des enfants de migrants, les porteurs de projet « de seconde génération » seront porteurs de projets plus ambitieux que les porteurs de projet « primo-migrants ».
P2.4. Les immigrés ou enfants d’immigrés diplômés lorsqu’ils entreprennent auraient des caractéristiques semblables aux autres entrepreneurs diplômés, tant par leur choix d’activité que par le système de gestion mis en place.
Cette idée qui donne à la formation et au diplôme un rôle assimilationniste trouve son origine dans une étude du Centre de Recherches sur les Qualifications auprès de 54.000 enfants d’immigrés montrant que ceux qui avaient un niveau Bac+2 ou Bac+3 au moins, avaient presque les mêmes emplois que les autres français.
Dans le corpus de sous-propositions précédentes, les sous-propositions P 2.1 et P 2.2 sont centrales pour l’approche dialectique adoptée à la suite de GREENE et alii (2003). Elles n’obéissent pourtant pas à la même perspective dialectique. La première met l’accent sur la possible individualisation des trajectoires entrepreneuriales au sein de mêmes groupes ethniques tandis que la seconde insiste sur des différences inter-ethniques de comportement entrepreneurial qui méritent d’être expliquées.
Justifications de la diversité inter-ethnique supposée
Si l’attitude du migrant vis-à-vis de la société d’accueil est liée à son histoire personnelle, elle dépend aussi des déterminismes socio-historiques de son groupe. Or, les sociologues ont souligné des différences très sensibles entre les immigrés turcs et les immigrés maghrébins. Plusieurs faits plaident pour une propension assimilationniste plus forte chez les seconds que chez les premiers. Selon KESTELKOOT (1987), ces faits sont renforcés parce qu’en général, les deux communautés ne vivent pas dans les mêmes quartiers et ne s’inter-influencent pas.
Du fait de l’histoire coloniale, les problèmes de difficultés dans la maîtrise linguistique sont moins prégnants chez les immigrés originaires du Maghreb que chez les turcs. MANCO (1998) note en complément que de nombreux jeunes turcs lisent la presse turque ce qui est loin d’être le cas de leurs homologues marocains par rapport à leur presse nationale.
Il en résulte lorsqu’ils entreprennent que « les turcs développent à travers l’Europe une logique communautaire ouvertement inspirée du modèle d’intégration américain » (MANCO, op. cit., p. 38), ce qui n’est pas le cas des ressortissants maghrébins en Europe. On observe, en effet, chez ces derniers « une intensité particulière dans les relations entre, d’une part, le groupe maghrébin et d’autre part, la population et les institutions du pays d’accueil » .
Ce phénomène débouche sur des différences de pratiques sociales. TRIBALAT (1995) et TODD (1995) ont montré symptomatiquement que le taux d’exogamie de la population maghrébine était largement supérieur à celui de la population tuque.. De même, MALEWSKA-PEYRE (1982) avait montré que les maghrébins faisaient davantage confiance que les turcs aux institutions scolaires et politiques de leur pays d’accueil. Ce constat nous amènera à faire une proposition analogue sur la confiance variable accordée aux dispositifs d’accompagnement génériques (proposition P 3.6). Ce résultat irait dans le sens d’études américaines (YOUNG et THURLOW-BRENNER, 2000) qui soulignent que, du fait de leurs difficultés pour accéder à l’information, les minorités ethniques ou sociales avaient tendance à moins recourir que les autres aux systèmes généraux d’aide et de soutien à l’entrepreneuriat. Dans le cas de l’accompagnement, la difficulté ne jouerait pas dans l’accès au dispositif qui est généralement prescrit, mais dans l’adhésion à la démarche d’accompagnement. On s’attendra donc à constater un plus fort taux d’abandon d’accompagnement à l’issue du premier accueil chez les turcs que chez les autres.
Comme le notent MANCO et AKHAN (1998, p.34) à propos des entrepreneurs turcs de Belgique, ces derniers incarnent la synthèse de la Théorie de l’Enclave et de la Théorie des Minorités Intermédiaires en visant prioritairement une clientèle turque et en étant d’abord implantés dans les quartiers à forte population d’origine turque (théorie de l’enclave) et en concentrant leurs activités dans les secteurs de la vente au détail et du service aux personnes.
Les observations réalisées lors de phases d’accompagnement et les entretiens exploratoires menés auprès de chargés de mission d’A.L.E.X.I.S. ont permis d’étayer nos propositions a priori sur le processus d’accompagnement. La proposition 3 a une vocation prescriptive, mais elle génère des sous-propositions explicatives. Conformément à la philosophie d’A.L.E.X.I.S., nous pensions que le dispositif d’accompagnement y était efficace.