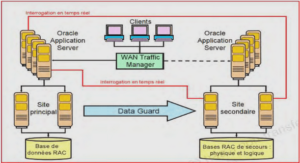Conditions de recueil des données
La méthodologie quantitative mise en œuvre vise à saisir les régularités dans les conceptions des enseignants. Celle-ci s’appuie sur trois corpus de données : des questionnaires (271 réponses35) ; des ressources et des échanges numériques synchrones et asynchrones dans le cadre d’un Enseignement à Distance en littérature de jeunesse en première année de Master 1 MEEF 1 (sur la durée d’un semestre)36 ; l’analyse d’une base de données d’emprunts dans deux sites d’une bibliothèque universitaire (sur cinq ans pour un site, sur un an pour l’autre – en fonction des données disponibles dans la base de données lors de l’enquête)37. Une consultation effectuée en 2015 de 60 mémoires professionnels rédigés de 2007 à 2013 sur l’un des sites d’une bibliothèque universitaire de l’ÉSPÉ de l’académie dans laquelle se déroule l’enquête vient compléter ce corpus.
Le projet d’enquête par questionnaires était de saisir, au sein d’une cohorte, l’évolution des corpus et des conceptions à trois moments de leur parcours : en début de Master 1, en milieu de Master 1 et en Master 2. Il ne s’agit pas de revenir sur l’évolution des représentations à l’échelle individuelle, mais d’analyser comment, au sein de la formation, et par l’effet de la formation les corpus et conceptions des étudiants dans ces groupes évoluent. La méthodologie de passation et d’élaboration du questionnaire a été conçue de façon dynamique afin d’adapter les conditions de recueils au contexte de passation et au public concerné.
La particularité d’accès au terrain de l’enquête quantitative par questionnaire a tenu à la gestion et à la composition des cohortes d’étudiants et stagiaires entre l’année de Master 1 et l’année de Master 2. Deux facteurs de variation de la constitution des groupes doivent être signalés car ils mettent en lumière l’hétérogénéité du public concerné par la formation. D’une part, dans l’académie dans laquelle s’est effectuée l’enquête, les stagiaires sont répartis par site en fonction de leur rang de classement et de leurs vœux. Les étudiants de Master 1 ne sont donc pas nécessairement affectés sur le même site en Master 2. D’autre part, bon nombre de stagiaires ne sont pas d’anciens étudiants de Master 1 et peuvent donc avoir été interrogées en Master 2 sans avoir été interrogés en Master 1.
La continuité et la cohérence du panel reposent sur deux facteurs. D’une part, les formateurs qui ont relayé le questionnaire – et qui nous ont retourné les exemplaires complétés – sont membres des mêmes équipes, d’une année sur l’autre. La continuité est donc assurée par le fait que ces formateurs travaillent ensemble depuis de nombreuses années et partagent les mêmes référents théoriques, les mêmes programmations, allant même jusqu’à se répartir des cours au sein d’un même groupe en fonction des spécialités de l’un ou de l’autre. Le fondement de la formation, les références sont donc semblables d’une année sur l’autre et autorisent une analyse commune puisqu’on peut penser que, d’une année sur l’autre, ces formateurs utilisent sensiblement les mêmes corpus, transmettent les mêmes enjeux concernant la lecture des textes littéraires à l’école. Ce premier aspect de la continuité autorise l’analyse. D’autre part, la continuité tient à la stabilité relative des origines socio-professionnelles des étudiants et stagiaires au sein de la formation MEEF 1 de cette académie. Celle-ci tient aux caractéristiques générales de la population estudiantine et à la relative stabilité des origines socio-culturelles de la population enseignante38. En fait, il s’agit d’une stabilité dans l’hétérogénéité des parcours antérieurs et des origines socio-professionnelles. Cette stabilité est d’autant plus marquée par site : certains sites brassent une population d’étudiants provenant de banlieues et d’universités plus populaires que d’autres. Si ce ne sont donc pas nécessairement les mêmes personnes qui ont été interrogées – ce qui serait gênant dans une enquête qualitative -, on peut considérer que ce sont des étudiants et des stagiaires occupant symboliquement la même place au sein de l’institution et que ce sont des entités statistiques semblables. Ces groupes d’enquêtés de Master 1 et de Master 2 qui ne sont donc pas des cohortes au sens strict du terme revêtent bien des caractéristiques communes, et notamment la constance de la formation suivie, qui autorise une analyse comparative au fil de la formation initiale. À l’échelle quantitative de ce pan de l’enquête, la continuité est suffisamment assurée pour permettre la comparaison des réponses. La diversité des cohortes interrogées apporte des éléments de connaissances sur l’hétérogénéité des publics et des parcours et les conditions de recueil autorisent le traitement quantitatif (anonymat des réponses, nombre assez conséquent de réponses, groupes qui ne sont pas constitués exactement des mêmes étudiants pour les différentes raisons mais qui ont été formés par les mêmes équipes pédagogiques) sur l’évolution des corpus et des enjeux sur la lecture des textes littéraires au fil de la formation. Adapter les conditions de passation et la formulation du questionnaire a permis d’optimiser le nombre et la qualité des réponses.
Le questionnaire a ainsi été distribué en version papier ou par mail par le biais de collègues formateurs de français au sein des sites de l’ÉSPÉ dans laquelle a été effectuée cette enquête. Il a été renseigné en début ou en fin de cours lorsque cela était possible, sinon il a été distribué et les enquêtés ont été invités à nous le retourner. Parfois, il a été transmis par mail39. Des néotitulaires ont également été interrogés par le biais de questionnaires. Sept personnes ont répondu au cours de leur troisième année de titularisation. Si leurs réponses sont prises en compte, leur faible nombre n’autorise pas de traitement quantitatif.
Par ailleurs, devant le faible nombre de réponses sur les premiers questionnaires longs utilisés lors de l’enquête exploratoire (Annexe I, p.7)40, des versions plus synthétiques ont été composées. Le questionnaire a également été adapté lorsque le recueil des réponses s’est fait lors d’un cours auquel nous assistions dans le cadre d’une observation, afin d’interroger les stagiaires sur le module de formation que nous observions ce jour-là. (Annexe I, p.10). Ainsi, des points qui ont été questionnés dans certaines versions du questionnaire ne l’ont pas été dans d’autres. Les réponses concernant les enjeux et les corpus constituent l’essentiel des informations traitées, car ce sont les items les mieux renseignés. Les questions sur les usages des œuvres de littérature de jeunesse, moins renseignées, n’ont pas fait l’objet d’une analyse quantitative.
Concernant le recueil des données, précisons enfin que le questionnaire a connu des évolutions au fil de l’enquête et des questionnements soulevés par la constitution du cadre théorique et les premières analyses. Les différentes versions de ce questionnaire sont disponibles en Annexe I (Annexe I, p.7). Par exemple, dans une première version du questionnaire, une question était posée sous cette forme : « Avez-vous des livres de littérature de jeunesse que vous aimez particulièrement. Si oui, lesquels ? Pourquoi ? » Lorsqu’il a été constaté qu’une part non négligeable de personnes ne répondaient pas à cette question, nous avons cherché à augmenter le nombre de réponses. Cette question a été reformulée par une série de trois questions, formulées différemment : « Avez-vous des souvenirs d’enfance de lecture, de films ou de dessins animés, de sorties au théâtre, au cinéma. Lesquels ? » « Avez-vous des souvenirs scolaires de lecture, de films ou de dessins animés, de sorties au théâtre, au cinéma ? » « Y a-t-il des œuvres que vous avez hâte de pouvoir partager avec vos élèves ? ».
Cette méthodologie dynamique tant du point de vue des conditions de passation que du côté de l’élaboration même du questionnaire a permis un traitement quantitatif des réponses concernant les corpus et les enjeux assignés à la lecture des textes littéraires à l’école.
Le deuxième corpus de l’enquête quantitative est composé de données recueillies sur une plateforme d’enseignement à distance (EAD) d’une université de l’académie dans laquelle se situe cette enquête. Pour accéder à ces données, nous avons obtenu les autorisations d’accès à cette formation à distance par le biais des gestionnaires universitaires de la plateforme. Au cours du premier semestre de l’année universitaire 2014-2015, nous avons analysé les ressources postées par les formateurs ainsi que les échanges synchrones et asynchrones effectués entre des étudiants et entre des étudiants et des formateurs, dans le cadre d’un module de littérature de jeunesse prenant place au premier semestre du Master 1 MEEF 1. L’enquête a porté sur l’ensemble des groupes, soit huit groupes d’environ 15-20 personnes, encadrés par cinq formateurs (trois formateurs ayant deux groupes).
Face à la masse de données, nous avons choisi de concentrer notre observation et notre analyse sur certains points. D’une part, nous avons analysé les corpus d’œuvres cités au fil de la formation : ceux qui sont proposés à l’étude par les formateurs, ceux qui sont cités par les étudiants. Comme avec les questionnaires, il s’agissait d’essayer de définir les points communs et les écarts entre les œuvres citées par les uns et les autres. D’autre part, à la frontière entre l’enquête quantitative et qualitative, nous avons commencé à analyser les modalités d’échanges entre formateurs et étudiants et les postures de lecture recherchées par les formateurs et mises en œuvre par les étudiants. Cette analyse s’est faite en comparaison avec les données recueillies par observation lors de cours de littérature de jeunesse en présentiel. Il s’agissait de voir dans quelle mesure les modalités d’échanges par voie électronique ou en présentiel pouvaient avoir un impact sur les postures de lecture développées par les étudiants et sur leur possibilité de développer une lecture littéraire.
Le troisième corpus est composé de l’analyse des emprunts d’albums faits sur deux sites d’une bibliothèque universitaire implantés sur des sites de formation consacrés alors exclusivement à la formation des maitres. Le traitement des données d’emprunt étant fait différemment sur les deux sites, nous n’avons pas pu accéder exactement aux mêmes données sur un site et l’autre. Dans le premier site (codé S), l’analyse a porté sur les emprunts effectués sur une année (2012). Le recueil de données porte sur cette année en particulier parce que les données pour les autres années étaient incomplètes pour diverses raisons et que les modalités d’usage du logiciel sur ce site ne permettaient pas alors l’analyse sur plusieurs années. C’est une limite de l’intérêt de ce corpus puisqu’il aurait été intéressant de pouvoir comparer les données recueillies dans ce cadre avec celles recueillies par questionnaire sur la même année. Cela étant, les entretiens avec les documentalistes montrent que les emprunts présentent des caractéristiques relativement stables qui autorisent, dans une certaine mesure, à transférer les données obtenues pour une année sur les autres années. L’analyse des emprunts effectués sur le deuxième site (que nous coderons C) le confirme. Le traitement des données le montrera. Sur ce site, le recueil de données a porté sur les emprunts effectués entre 2008 et avril 2013. Il n’a pas été possible d’extraire les données propres à 2012 en raison des modalités d’usage du logiciel de gestion des emprunts sur ce site.
Là encore, face à la masse importante de données disponibles, l’observation a été orientée. Le choix s’est porté sur les ouvrages référencés dans la catégorie « album jeunesse », afin de permettre une comparaison avec les autres corpus et avec l’enquête de Butlen et Joole (2011). En 2012, sur le site S, 13 044 ouvrages classés « albums jeunesse » ont été empruntés, répartis en 619 titres. Entre avril 2008 et avril 2013, sur le site C, 27 902 exemplaires ont été empruntés. Ils portaient sur 1 248 albums. La différence d’effectifs des emprunts peut s’expliquer par la taille plus importante du site C.
L’analyse qui en est faite vise à analyser les répartitions des titres dans ces emprunts afin de voir s’il est possible 1) de dégager des tendances qui permettraient de savoir ce qui est massivement lu ou du moins massivement emprunté 2) de comparer ces tendances avec celles repérées avec les données recueillies par questionnaire et par analyse des ressources et échanges EAD.
Enfin, la consultation effectuée de 60 mémoires professionnels rédigés de 2007 à 2013 sur l’un des sites d’une bibliothèque universitaire de l’ESPE de l’académie complète ce corpus. Elle vise à identifier les enjeux assignés à la lecture des textes littéraires à l’école dans les mémoires portant sur cet objet d’enseignement.
Dans les deux parties suivantes, sont présentés les objectifs poursuivis par l’enquête quantitative menée à partir de ce corpus de données.
Les « corpus de fond » et les « corpus redéfinis »
L’objectif est :
1) d’accéder à une partie de la « bibliothèque intérieure » (Louichon, Rouxel, 2010) de littérature de jeunesse des enseignants : connaitre leurs souvenirs de lecture, leurs gouts actuels ;
2) de dégager une « bibliothèque collective » (Bayard, 2007, p.74) : savoir quels sont les livres fréquemment cités ;
3) essayer de comprendre les facteurs participant de la constitution de ces bibliothèques : souvenirs de lecture d’enfance, lectures de formation, lectures faites sur les terrains de stage.
En somme, il s’agit d’interroger, pour la population des enseignants débutants, l’existence d’un « corpus scolaire », d’un « corpus de formation » (Louichon, Rouxel, 2010, p.10), le rapport au canon littéraire de l’école primaire (Bishop, 2010). Nous cherchons à voir, d’une part, si l’on peut « définir un corpus commun » (Dufays, 2010, p.19), d’autre part, ce que les recoupements et les écarts entre ces corpus révèlent sur les conceptions des enseignants. Pour cela, nous essayons de voir si un corpus commun de textes appréciés et/ou lus en classe se dégage et est susceptible de constituer le socle d’une culture commune. Nous observons les éventuels recoupements entre les corpus institutionnels – les listes ministérielles –, de formation – les œuvres lues à l’ÉSPÉ –, d’enseignement – celles qui sont lues en classe par les enseignants. Ces axes d’analyse appellent des questions plus précises auxquelles nous cherchons à répondre : le corpus d’œuvres constitué dans cette enquête a-t-il les mêmes caractéristiques que celui obtenu par l’enquête de Butlen et Joole (2011), à savoir un « double mouvement : éclatement du corpus vers un grand nombre de titres et resserrement du corpus autour d’un corpus partagé ? Le corpus présente-il des variations selon que les personnes interrogées sont en début, milieu ou fin de formation initiale ? Comment interpréter ces éventuelles variations ? Quel rapport pouvons-nous observer entre ce corpus et celui des listes de référence ministérielles ? Transposant les termes de l’ergonomie, nous pouvons formuler la question ainsi : quel écart y a-t-il entre le « corpus de fond », ce que nous pouvons appeler la « bibliothèque intérieure d’origine », celle des enseignants au début de la formation et le « corpus redéfini » au cours de la formation et des premières expériences en classe ? À partir d’un « corpus prescrit », qu’on peut définir comme celui constitué des listes ministérielles et des ouvrages auxquels se réfèrent les corpus de formation, peut-on déterminer les caractéristiques d’un « corpus redéfini », qui est donc celui que les enseignants débutants pensent pouvoir/devoir mobiliser avec leurs élèves ?
Afin de saisir quelle place la formation universitaire et professionnelle tient dans la constitution de cette bibliothèque intérieure, nous cherchons également à comprendre si l’attachement à ces livres est lié à des souvenirs de jeunesse ou bien à des souvenirs plus récents liés à la formation, par exemple. Afin d’atteindre ces objectifs, nous avons interrogé les enseignants à différents moments de leur parcours (début de Master 1, milieu de Master 1, Master 2 ou néotitulaires) sur les livres qu’ils aiment particulièrement. Par ailleurs, sont distinguées les réponses données par titre, par auteur ou par genre. Les réponses sont classées par fréquence afin de voir dans quelle mesure il est possible de dégager des œuvres, des auteurs, des genres qui seraient particulièrement cités. Ces corpus sont comparés en fonction du moment auquel les personnes ont été interrogées : en début, en milieu ou en fin de formation initiale.
Afin d’affiner l’analyse, des recoupements ont été effectués avec d’autres données que celles issues des questionnaires. D’une part, ces données ont été comparées avec celles des emprunts en bibliothèque universitaire et les résultats de l’enquête de référence (Butlen et Joole, art. cit.). Il s’est agi de voir quelle place ces titres ont dans la culture professionnelle des enseignants. L’analyse des écarts entre sites devait permettre de mettre en évidence la place de la formation dans la constitution de cette culture. Par l’analyse des écarts entre les réponses de la population de notre enquête – professeurs des écoles débutants – et celle de l’enquête de référence – enseignants sans distinction d’ancienneté –, il s’agissait de voir dans quelle mesure les corpus évoluent au fil de la carrière ou sont renouvelés par la formation. D’autre part, afin de dégager un éventuel corpus commun et d’interroger les liens entre « corpus prescrit » et « corpus redéfini », ont été comparés les ouvrages cités par les enquêtés et ceux présents dans les listes de référence du Ministère.
Le premier objectif concerne donc l’analyse des corpus d’œuvres et de leur évolution au fil de la formation initiale et des premières expériences d’enseignement. Le deuxième objectif concerne les enjeux assignés à l’enseignement de la lecture des textes littéraires et, de la même manière, leur évolution.
Les enjeux accordés à l’enseignement de la lecture des textes littéraires et leur évolution au cours de la formation initiale
Un autre objectif de l’enquête quantitative est de déterminer la tâche redéfinie à un niveau collectif et professionnel : comprendre ce qui constitue les enjeux de la lecture des textes littéraires à l’école primaire pour les enseignants débutants.
La question portant sur ce point dans le questionnaire a connu quelques évolutions au cours de l’enquête : « Selon vous, à quoi sert la littérature de jeunesse/l’enseignement de la littérature de jeunesse à l’école ? » ou « selon vous, quels sont les enjeux de la lecture des textes littéraires à l’école ? » Nous avons choisi d’introduire la question par « selon vous » afin d’éviter de produire une question qui pourrait être assimilée à une question de cours, et cela même si le contexte de passation induit nécessairement un biais dans la réponse. Nous avons veillé à ne pas définir ce que nous entendions par textes littéraires ou littérature de jeunesse pour ne pas orienter les réponses des enquêtés. Cela a permis de recueillir des données sur les conceptions des enseignants sur ce sujet.
Inscrivant cette analyse à la suite des travaux en didactique portant sur la définition des enjeux de la lecture, nous avons cherché à catégoriser ceux-ci afin de rendre compte de la manière dont les enseignants les conçoivent. Nous l’avons souligné dans le chapitre 3 de la première partie de cette thèse, la caractérisation des finalités de la lecture scolaire des textes littéraires apparait bien complexe d’un point de vue didactique. Comme le souligne Ahr pour le second degré (2015, p.57), la multiplicité des finalités assignées à l’enseignement et l’apprentissage de la littérature est sans doute l’une des sources de cette complexité. Ce constat nous semble tout à fait transposable au premier degré. Si elle s’appuie sur les axes retenus en didactique, la catégorisation que nous opérons vise avant tout à rendre compte des conceptions des professeurs des écoles interrogés. Pour ce faire, il est apparu pertinent de classer les réponses en deux catégories décomposées en trois sous-catégories. Nous précisons ainsi les catégories qui ont été établies dans nos écrits antérieurs (Fradet-Hannoyer, 2015, Fradet-Hannoyer, 2016b). Sont distingués les enjeux de transmission et les enjeux expérientiels. Si cette double catégorisation répond à la nécessité de traiter des données quantitatives41, elle n’exclut nullement la complémentarité entre ces deux catégories d’enjeux : le développement de l’esprit critique ne peut se réaliser que si le sujet enrichit ses connaissances, de quelque nature qu’elles soient.