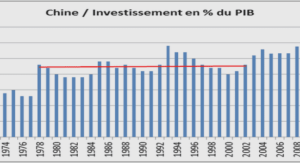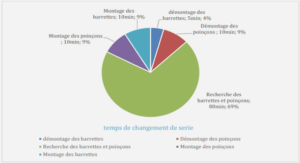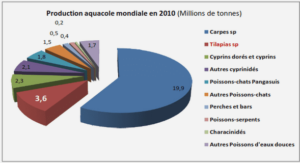La demande anticipée par les Entreprises
La demande anticipée est le déterminant principal de l’investissement. Pendant la période de récession économique, les entreprises adoptent une stratégie d’investissement prudente c’est-à-dire elles ne cherchent pas à augmenter leurs capacités de production, et parfois même ne renouvellent pas les équipements devenus obsolètes. Par contre, pendant la période de croissance soutenue, elles sont incitées à investir pour augmenter leurs capacités de production, pour pouvoir profiter de la hausse de la demande.
Si le capital physique nécessaire à la production est proportionnel au niveau de la production à réaliser, et que les entreprises veulent adopter rapidement leur niveau de capital, le service de l’investissement sera plus fort que celle de la demande. Ce phénomène est connu sous le nom d’accélérateur. En raison du phénomène d’accélération une faible variable de la demande, dans une situation de plein emploi de la capacité de production, suscite une forte variation de l’investissement. A l’inverse, un simple ralentissement de la demande peut suffire à provoquer une baisse de l’investissement.
Le rôle du coût des facteurs de production
La maximisation du projet par la firme fait dépendre le niveau de capital désiré du coût des facteurs travail et capital. Les entreprises ont le choix entre plusieurs combinaisons productives possibles, et choisissent celle que minimisent les coûts et maximise donc leurs profits. A court terme, lorsque le niveau de production est contraint par les débouchés c’est le coût relatif des facteurs de production qui est pris en compte. Ainsi, si le coût du capital s’élève par rapport aux charges salariales, l’entreprise a intérêt à limiter les dépenses d’investissement, en substituant une grande quantité de travail au capital. Le coût réel de chaque facteur intervient de la devise d’investissement. Cette relation entre coût des facteurs de production et niveau de l’investissement apparaît théoriquement solide. Pourtant, les études empiriques réalisées au niveau macroéconomique ont longtemps échoué à mettre en évidence l’incidence du coût des facteurs de production sur l’investissement. En 1997, encore, DORMONT ne parvenait pas à identifier de lien clair entre la demande des facteurs et le coût relatif capital/travail, et encore moins avec le seul coût du capital. Par contre, Crépon et Gianella distinguent deux effets d’une variation du coût d’usage du capital : un effet de substitution et un effet de la profitabilité. Ils ont aussi mis en évidence, économiquement, un impact significatif du coût d’usage du capital sur l’investissement.
Les contraintes d’accès au financement
La capacité d’emprunt d’une entreprise dépend beaucoup des garanties qu’elle peut offrir, ainsi que les conditions de marché (niveau des taux d’investissements). Le niveau des profits et le niveau de l’endettement de l’entreprise sont les deux indicateurs privilégiés pour évaluer la capacité de remboursement de l’emprunteur. Les petites entreprises ont moins de garanties à offrir aux banques, et ont plus de difficulté à financer leurs investissements. De ce fait, les banques sont amenées à intégrer le coût du crédit une peine de financement externe qui reflètent notamment les risques de non recouvrement. Une étude de Crépin et Rosenwald,
réalisée à partir des données d’entreprise montre que le prime de financement externe moyenne serait de l‘ordre de 5%, par rapport aux taux d’intérêt.
Equilibre macroéconomique néoclassique
L’analyse libérale se préoccupe essentiellement des effets de l’offre d’investissements c’est-à-dire à des effets sur la combinaison productive et sur la croissance de l’utilisation des biens d’équipement. Le marché de travail fixe le taux de salaire réel d’équilibre et le volume de l’emploi d’équilibre, ou plein emploi, par confrontation d’une offre et d’une demande de travail. Les salariés qui n’acceptent pas de travailler à ce taux de salaire sont des chômeurs volontaires. Le volume de l’emploi détermine le volume du PIB par l’intermédiaire d’une fonction croissante du taux d’intérêt et un investissement qui est une fonction décroissante du taux d’intérêt. L’équilibre du marché du capital (investissement = épargne) détermine le niveau du taux d’intérêt.
Le rôle économique de l’épargne
L’épargne est la différence entre le revenu et la dépense en biens de consommation. De son revenu, l’individu fait deux choix : l’une qu’il affecte tout de suite à des dépenses de consommation, l’autre qu’il met en réserve sous des formes diverses et qui est l’épargne .L’épargne consiste donc dans la renonciation à une consommation présente : épargner c’est “ mettre de coté ”une somme prélevée sur le revenu .Une épargne est indispensable pour assurer la production des biens capitaux .A cet effet, l’acte d’épargne fait trois voies : la première étant, la consommation : après certain temps, l’individu consomme lui–même les biens épargnes, dans cette hypothèse, l’acte d’épargne ne fait apparaître aucun capital. La deuxième sera la thésaurisation ou le “ bas de laine ” où l’individu renonce non seulement à consommer mais aussi à utiliser son épargne de façon productive. La troisième, c’est l’investissement : affectation de l’épargne à une œuvre productrice comme la création de bâtiment, fabrication de machine, constitution des stocks .Il permet donc à l’épargne de développer le capital technique. L’épargne ainsi devient Créatrice. En un mot, on peut dire que l’épargne permet aux agents économiques qui contribuent à la fabrication des biens capitaux de vivre, c’est-à-dire de consommer pendant qu’ils produisent des biens qui, dans l’immédiat, n’ont aucune utilité, mais dont l’utilité sera très grande un an ou deux ans après, selon la durée que demande leur fabrication
Table des matières
INTRODUCTION
PARTIE I- SITUATION DE MADAGASCAR DANS LE MONDE ET NOTION DE L’IDE
CHAPITRE I- CARACTERISTIQUE DE LA GRANDE ILE
1- Du point de vue géographique et démographique
1.1- Un vaste territoire
1.2- Un grand réservoir de Mains d’œuvres
2- Du point de vue économique et sociale
2.1- Les réalités sociales
2.2- Les réalités économiques
2.2.1- Le secteur primaire
2.2. 2- Le secteur secondaire
2.2.3- Secteur tertiaire
3- Les problèmes rencontrés dans l’économie malgache
3.1- Difficultés sociopolitique
3-1- Le niveau de vie
3-1-2- la santé
3-1-3- La corruption
3.2- Les difficultés économiques
3-2-1- Faiblesse de l’industrie
3-2-2- Techniques de production très traditionnelles
CHAPITRE 2 – LA NOTION D’IDE
1- Définitions et Origines
1-1- Définitions
1-2- Origines
2- Typologies et déterminants
2-1- Typologies
2.1.1- Création de filiales
2.1.2 -Acquisition de société étrangère
2.1.3 – Fusion avec des sociétés étrangères
2-2- Les déterminants de l’investissement
2.2.1- La demande anticipée par les Entreprises
2.2.2- Le rôle du coût des facteurs de production
2.2.3- Les contraintes d’accès au financement
2.2.4- La profitabilité
CHAPITRE 3- LES THEORIES DE L’IDE
1- La conception de l’investissement selon les théoriciens économique
1.1- Equilibre macroéconomique néoclassique
1.2 – L’équilibre macroéconomique Keynésien
2- Relation entre investissement et épargne
2.1- L’épargne chez les classiques
2.2- L’épargne selon Keynes
2.3- Le rôle économique de l’épargne
PARTIE 2- L’IDE A MADAGASCAR
CHAPITRE 1- EVOLUTION DE L’IDE DANS LE MONDE
1- IDE dans les pays avancés
1.1- Evolution de l’IDE dans les pays de l’OCDE
1.1.1- Evolution de la situation dans certains pays
2- IDE dans les pays moins avancés
2-2- Cas de Madagascar
2.2.1- Evolution de l’IDE à Madagascar
2.2.2- Structure de l’IDE par branche d’activité
2.2.3- les origines des IDE à Madagascar par pays
Chapitre 2- Coûts et contributions de l’IDE à Madagascar
1- Les différents coûts
1.1- Les charges économiques
1.1.1- déficits de la balance de paiement et de la balance commerciale
a)- Augmentation des importations
b)- Fuite de capitaux
1.1.2- Limites commerciales
a)- Concurrence déloyale
b)- Les transferts ne sont pas automatiques
1-2- Charges sociaux
1.2.1- Exploitation abusive
a)- Salaire inadéquat
b)- Conditions de travail difficile
1.2.2- Externalités négatives
a)- La population
b)- Dégradation de l’environnement
2- Contribution de l’IDE à Madagascar
2.1- Avantages économiques
2.1.1- Création d’emplois et distributions de revenus
2.1.2- Amélioration de la balance des paiements
2.1.3- Gain en devises
2.1.4-Effets d’entraînement
a)- Les entreprises nationales essaient de suivre les firmes multinationales
2.2- Impacts sociaux positifs
2.2.1- Développement social
a)- Création d’emploi
2.2.2- Possibilité de diversification des produits
a)- Amélioration de la productivité et de la qualité
b)- Transfert de technologie
CHAPITRE 3- PROBLEMES RENCONTRES ET SOLUTIONS
1- Les obstacles pour les IDE à Madagascar
1.1- Problèmes politiques
1.1.1- Politique gouvernementale
1.2- L’instabilité politique
1.2.1- La corruption
1.3- Problèmes économiques
1.3.1- Inexistence d’établissement financier spécialisé
2- Solution envisagées et mesures à prendre
2.1- Solution envisagées
2.1.1- Le rôle de l’Etat
a)- Mesures d’accompagnements
b)- Contrôle
c- Agrandir les marchés
d)- Politique adoptée
2.1.2- Le régime du système commercial
2.2- Mesures prises
2-2-1- L’allègement des procédures administratives par la mise en place du GUIDE
2-2-2- Les législations foncières
2.2.3- L’octroi de certains avantages fiscaux et douaniers
2.2.4- La libéralisation sur les mouvements des capitaux
2.2.5- Stratégie pour la promotion des exportations
CONCLUSION