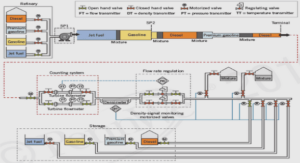L’aire métropolitaine comme territoire de la ville
En observant la carte de l’aire métropolitaine parisienne basée sur la définition de l’INSEE, nous constatons une transition progressive et concentrique vers la ville dense qui rappelle l’évolution historique des villes françaises. Très peu de noyaux denses viennent concurrencer Paris. L’aire métropolitaine parisienne est monocentrique en ce qui concerne les foyers d’habitations. Nous pouvons néanmoins observer des petites taches urbaines denses qui laissent présager de leur importance future dans la croissance urbaine.
Nous remarquons qu’en plus de croitre de manière radioconcentrique, les extensions urbaines se font de ma-nière linéaire le long des grands axes de transports formant des corridors urbains. Cela vient remettre en cause la forme radioconcentrique de l’aire métropolitaine parisienne mais pas sa logique de développement.
Nous pouvons également constater le décalage entre les frontières administratives et les lisières urbaines d’où l’importance de s’appuyer sur le territoire vécu pour notre étude. L’aire métropolitaine du Grand Paris est plus étendue que la Région Ile de France, ce qui m’a obligé à restreindre le nombre de gradients urbains et la préci-sion de l’échelle d’analyse. De même pour les centralités et les pénétrantes. Cette ville territoire demande plu-sieurs degrés d’analyse pour bien percevoir et comprendre les éventuels fonctionnements en réseau des diffé-rentes entrées et portes de la ville diffuse. Pour resserrer mon raisonnement et ma démonstration, j’ai donc pris le parti de considérer l’aire métropolitaine parisienne comme une unité cohérente et non comme un ensemble d’aires urbaines d’où le choix restrictif des pénétrantes en direction du cœur de cette aire métropolitaine. Ce choix s’explique également par le caractère très monocentrique du Grand Paris.
Cette morphologie radioconcentrique facilite la lecture du territoire et de la ville, me permettant de me concen-trer sur l’échelle du grand territoire ce qui limite un travail fastidieux d’emboitement d’échelles.
Les grandes pénétrantes comme entrées de ville
Nous pouvons observer deux typologies de pénétrantes vers Paris et la petite couronne, des autoroutes et des nationales. Ce réseau complémentaire permet l’accès au cœur de ce territoire depuis l’ensemble des directions ce qui leur confère une identité propre. Leur importance dans le réseau viaire permet à une majorité d’entre elles d’être continues et rectilignes depuis l’extérieur de l’aire métropolitaine jusqu’aux boulevards périphé-riques et même au-delà bien qu’elles soient déclassées en arrivant dans Paris intramuros. Cette particularité fait de ces pénétrantes des espaces privilégiés pour observer et mettre en scène la transition du rural jusqu’à la ville dense. La vitesse élevée sur ces grands axes routiers perturbe la perception fine du paysage, la transition se fait par grandes séquences paysagères.
Les grandes centralités comme étapes et portes d’un parcours
Tout comme les foyers de populations, les centralités sont aimantées par les grands axes de transports. Cer-taines profitent de leur éloignement de Paris alors que d’autres à l’inverse semblent attirées par la ville centre. Nous remarquons que les centralités urbaines sont majoritairement concentrées à proximité de Paris. Seules quelques centralités secondaires sont situées à plus de 30km de Paris intramuros. Parmi ces centralités struc-turant la grande couronne, Evry, Marne-la-Vallée, Melun-Sénart, Cergy-Pontoise et St Quentin en Yvelines sont considérées comme des villes nouvelles. Leur construction a été décidée en 1965 lors d’un schéma direc-teur. L’objectif initial était de contrebalancer l’hypercentralité de Paris en proposant une agglomération poly-centrique. Mais malgré un effort soutenu de l’Etat pendant 40 ans, les villes nouvelles représentent moins de 10% de la population de l’aire métropolitaine et ne sont pas devenues des centres indiscutables autour desquels et à partir desquels s’organise le territoire métropolitain.
Ce manque d’influence n’a pas permis de remettre en cause le modèle radioconcentrique du Grand Paris. Néanmoins ces centralités secondaires nous permettent d’identifier les axes prioritaires et donc les entrées de ville et portes principales de l’aire métropolitaine parisienne.
Des parcours d’entrée de ville privilégiés
La superposition schématique des trois principales caractéristiques récurrentes des entrées et portes de la ville nous permettent d’identifier clairement ces espaces transitoires. Nous constatons que certaines pénétrantes ou entrées de ville interceptent davantage de centralités et de pôles urbains que d’autres. De plus la localisation de certaines centralités en bordure de gradients urbains met en évidence une hiérarchie dans les entrées de l’aire métropolitaine parisienne. Par exemple les autoroutes A1, A6, A15 et la nationale 10 apparaissent prioritaires contrairement à l’autoroute A16.
A partir de cette carte, il nous est facile de vérifier si nos trois terrains d’études sont localisés sur des entrées prioritaires et s’ils sont situés à des endroits stratégiques, c’est-à-dire aux portes d’une transition de gradients urbains.
Notre premier constat est que nos trois sites d’analyse sont bien situés sur des pénétrantes et donc sur les en-trées de l’aire métropolitaine. Mais leur position par rapport aux lisières urbaines leur confère à chacun un rôle différent et spécifique. Seul Le Bourget est situé aux portes de l’unité urbaine de Paris. La Porte d’Italie quant à elle bien qu’au seuil de Paris intramuros ne constitue pas une porte à proprement parler de l’aire métropolitaine mais uniquement une porte de la ville de Paris. La Défense est dans une position intermédiaire, ni aux portes de Paris intramuros, ni aux portes de l’unité urbaine parisienne.
Nous pouvons donc admettre qu’il existe encore aujourd’hui des espaces qui ont vocation à participer à l’entrée en ville de par leur localisation sur le parcours qui mène du rural à l’urbain dense et vice et versa. Le Bourget, La Défense et la Porte d’Italie font partie d’un projet global de mise en scène du territoire et ne doivent pas être analysés comme des projets ponctuels. Il s’agira de trouver quel est leur rôle dans l’entrée en ville, dans l’entrée dans l’urbain diffus, généralisé. C’est ce rôle donné par les politiques et acteurs de l’aménagement aux différents projets qui va nous permettre de tirer des enseignements sur le futur du Grand Paris et de son aire métropolitaine.
Les projets d’entrées de ville dans la ville d’aujourd’hui
Le Bourget, La Défense et la Porte d’Italie ont une appellation commune d’entrée de ville ce qui peut porter à confusion sur leur rôle. Leur localisation spécifique implique des enjeux différents et donc des ré-ponses particulières. Nous allons maintenant voir si les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre ont adapté leurs projets à leur position dans l’urbain. Cette différenciation dans les projets va nous renseigner sur la dynamique urbaine désirée et instaurée par les différents acteurs de l’aménagement du territoire, privés et publics mais également sur le devenir de ces espaces dans cette urbain diffus.
Le Bourget, porte d’entrée privilégiée de la métropole du Grand Paris
Notre analyse s’appuie majoritairement sur le Contrat de Développement Territorial (CDT) du Pole métropoli-tain du Bourget de 2014, sur l’étude urbaine rédigée par l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR) en 2014 dans le cadre de ses études sur les évolutions métropolitaines et sur l’étude d’élaboration stratégique de développement territorial et d’aménagement du pôle métropolitain du Bourget réalisée par l’Atelier Christian de Portzamparc.
Grâce à la présence de nombreuses infrastructures routières, ferroviaires et aériennes, le territoire du Bourget constitue une des portes d’entrée Nord dans la métropole francilienne. Traversé par les rocades A86 et A3 et la radiale majeure qu’est l’A1, Le Bourget est relié à tous les grands sites de la métropole dont Paris intramuros situé à moins de 7km. Il joue donc un rôle stratégique sur l’axe de développement majeur qui s’étend de Paris jusqu’à Roissy Charles de Gaulle, le long de l’axe historique de l’ex RN2 et de l’autoroute A1, tant en matière économique, qu’urbaine et paysagère. Ces nombreux équipements et notamment son aéroport d’affaires ont conféré à ce territoire un rayonnement naturel à l’échelle métropolitaine et européenne mais l’ont également impacté en fabriquant un urbanisme fait de coupures, d’enclaves et de secteurs de « fin de ville » qui viennent perturber la lecture du paysage.
Le Bourget constitue un des premiers territoires de la zone dense à accueillir une végétation importante, offrant une respiration pour le Nord-Ouest francilien. De ce fait, le territoire du pôle métropolitain du Bourget joue un rôle d’interface entre la ville dense et compacte de la première couronne et les grands espaces de la seconde couronne même s’il est parfois perçu comme hétérogène et peu lisible.
Ce territoire se structure autour d’une ancienne voie royale, l’ex RN2 aujourd’hui déclassée. C’est l’épine dorsale du pôle métropolitain du Bourget, davantage que les autoroutes A1 et A3. Elle est en effet l’une des voies les plus chargées du département, tous véhicules, confondus avec un volume de trafic de poids lourds important de l’ordre de 1500 poids lourds par jour confirmant ses fonctions de transit et d’entrée de ville. C’est également l’accès routier le plus direct à Paris intramuros.
Nous sommes donc sur un site d’envergure métropolitaine aux enjeux multiples. Que ce soit au niveau écono-mique, paysager, identitaire, social et culturel. Ce territoire fait donc l’objet de nombreuses études et proposi-tions de projets de la part des acteurs de l’aménagement qui voient l’occasion de développer un pôle du futur Grand Paris et d’en faire un pôle aéronautique d’excellence au niveau mondial. La spécificité de sa position en entrée de la métropole n’est qu’une des composantes de la réflexion menée par les maîtres d’œuvres et d’ou-vrages.
Ainsi, le CDT de 2014 commandé par l’Etablissement public d’aménagement de la Plaine de France (93) vise en priorité à recoudre le territoire et à rétablir les continuités qui lui manquent aujourd’hui, pour permettre une intensification urbaine et une meilleure lisibilité dans l’optique de mettre en scène une entrée à double échelle de lecture. A la fois porte d’entrée dans l’urbain dense et dans le pôle métropolitain du Bourget.