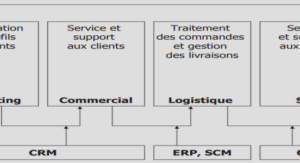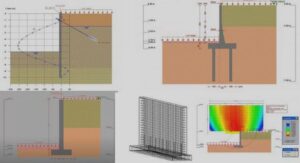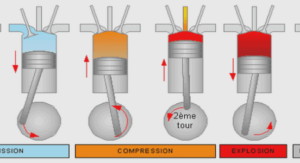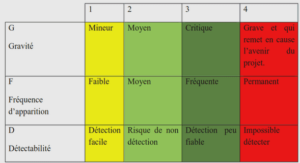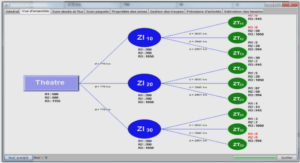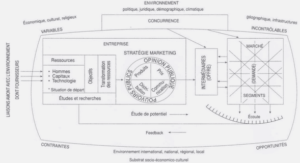Des décors à réseau aux plafonds à caissons
Au sein de ce faible échantillon, les compositions les plus représentées sont les décors à réseau. A Rimini, la domus 2 de l’ ex-vescovado en a livré un exemplaire dans la pièce P (RIM 02.03) : composition de cercles rouges sur fond blanc occupés par des fleurs rouges à larges pétales cordiformes et feuilles vertes lancéolées ou trilobées et organisés selon un schéma à double quadrillage droit et oblique493. Dans la domus del Brüt Fund , à Vercelli, la composition du plafond de la pièce L (VER 01.01) est également fondée sur un motif de cercles (disques verts entourés de cercles concentriques dans les tons bruns et noirs) qui se situent aux intersections d’un quadrillage droit matérialisé par de fines bandes oranges ; dans les espaces laissés libres, prennent place des petits octogones rouges occupés d’un cercle et d’un fleuron central. A Sirmione, la villa retrouvée via Antiche Mura a livré trois groupes de fragments attribués à des décors à réseau de plafond. Le groupe le mieux représenté appartient au plafond du portique C (SIR 01.04) : une composition orthogonale de cercles sécants rouges et jaunes sur fond blanc avec disques bleus aux points de tangence, déterminant des carrés convexes sur la pointe ornés en leur centre d’un petit cercle timbré d’un fleuron jaune. La structure (et qui plus est la datation) des deux autres groupes est plus délicate à établir (SIR 01.03). Plusieurs compositions à réseau sont également attestées à Crémone : un plafond trouvévia Bella Rocca évoque une version plus sommaire du schéma observéàVercelli mais nous ne l’avons pas enregistré dans notre corpus car le contexte de provenance en est trop incertain494 ; un autre, issu de la domus di via Cadolini, présente, sur un fond blanc, des carrés aux côtés concaves déterminés par la rencontre de uatreq peltes et, dans les espaces laissés libres, des cercles matérialisés par des gouttes jaunes (CRE 01.02). Enfin, dans la domus sotto l’Istituto C. Arici à Brescia (BRE 06.06), la composition est fondée sur la répétition d’un motif floral : double quadrillage droit et oblique de lignes de calices adossés avec cercles dentelés aux intersections.
Ces décors, retrouvés en situation d’écroulement, étachésd de leur contexte d’origine, sont d’une datation délicate. Le plafond de Vercelli, pour lequel on ne dispose d’aucun indice archéologique, comme il a été dit plus haut, peuttreê comparé à une peinture d’Andilly-en-Bassigny structurée selon un quadrillage droit marqué aux intersections de cercles timbrés de fleurons495. La comparaison est d’autant plus convaincante que le plafond est bordé, sur ses longs côtés, de guirlandes rectilignes entourées derubans ondés, motif qui ornait les parois de la pièce de Vercelli. Ce décor est issu d’une sallethermale dont la construction est datée du début du II s., comme le suggère le fouilleur à partir d’une m onnaie de Nerva « et d’autres indices »496. Serait ainsi confirmée et resserrée vers le débutdu IIe s. la datation du décor des parois. Celui de Rimini pourrait appartenir à la se conde moitié du même siècle. On ne dispose d’aucun indice archéologique direct mais la comparaison avec un décor d’Amiens daté archéologiquement de cette période accréditerait hypothèsel’ que ce plafond soit lié à la grande phase de restructuration du milieu du siècle497. La prudence est cependant de mise car le décor de Rimini est très peu conservé. On suit nsuite ces compositions à réseaux avec motifs de cercles jusqu’au IIIe s. puisque le plafond de la villa de Sirmione est daté de cette période à partir du phasage de l’édifice (voir catalogue, SIR 01). Cette datation, qui peut trouver une confirmation stylistique dans les grandes dimensions des motifs et leur réalisation nerveuse, doit peut-être être resserrée vers le début du siècle en vertu des comparaisons avec un décor très semblable (sur fond blanc, cercles sécants jaunes et verts avec disques bleus aux points de tangence) issu d’une villa romaine de Baláca (Hongrie) et une peinture de la domus de G. Iulius Silvanus dans l’antique Segobriga (Espagne) dont la composition est proche, quoiqu’un peu plus riche 499 .
Le premier est daté du début du IIIs., sans toutefois que l’on sache sur quels éléments repose la datation ;le second est situé entre la fin du II et le début du III s. à partir des techniques de construction mises e n œuvre pour les murs de la pièce. Ont également été datés du eIIIs., voire du IVe s. pour celui de via Cadolini, les deux plafonds de Crémone, pour lesquels on ne dispose d’aucun élément de datation extérieur (voir catalogue, CRE 01.02).
Le premier est daté du début du IIIs., sans toutefois que l’on sache sur quels éléments repose la datation ;le second est situé entre la fin du II et le début du III s. à partir des techniques de construction mises e n œuvre pour les murs de la pièce. Ont également été datés du eIIIs., voire du IVe s. pour celui de via Cadolini, les deux plafonds de Crémone, pour lesquels on ne dispose d’aucun élément de datation extérieur (voir catalogue, CRE 01.02).
Les quelques indices archéologiques et comparaisons bien datées dont on dispose permettent donc d’attester la diffusion de ces compositions à réseau tout au long du IIe et, sans doute, du IIIe s., sans pour autant nous donner les moyens de restituer de manière fine l’évolution des schémas et des motifs.
Sans constituer à proprement parler une composition à réseau, le plafond du cubiculum de la domus du Chirurgien met également en œuvre un motif répétitif (RIM 05.04). Une bordure ajourée détermine de grands carrés à l’intérieur desquels sont juxtaposés des carrés et des rectangles couchés et debout ornés de fleuronsréalisés en blancs sur les fonds bleus, jaunes et rouges. Nous n’avons guère trouvé de comparaisons convaincantes pour ce décor au motif de base générique (carrés et rectangles colorés timbrés d’un fleuron blanc) mais à la composition d’ensemble plus inhabituelle qui, tout en rappelant les plafonds à caissons, s’en éloignent par le jeu d’enchassement quelque peu irrégulier des formes carrées et rectangulaires. Le décor est, en l’état actuel desconnaissances, daté de la première moitié du IIIe s. ou, au plus tôt, de la fin du IIe s. (voir cata logue, RIM 05).
Des plafonds décorés de motifs de caissons à proprement parler sont documentés dans deux domus de Brescia. Le premier est issu de la domus B de Santa Giulia (pièce 17 ; BRE 03.08), le second de la domus de Dionysos (BRE 01.01) ; ce dernier, retrouvé dans la cour, devait appartenir à un toit à auvent qui bordait ce lle-ci sur les quatre côtés500. Les deux décors sont singulièrement proches : caissons avec motif floral au centre (fleurs d’acanthe dans la domus de Dionysos ; rosettes dans celle de Santa Giulia) encadrés, de l’extérieur vers l’intérieur, d’une bande continue, d’une tresse à d eux brins et d’une frise d’oves réalisées dans les tons marron jaune sur le fond blanc. Dans la domus de Santa Giulia une frise d’astragales constituait l’encadrement le plus intérieur, tandis que dans la domus de Dionysos, ont également été retrouvés des fragments montrant desvolutes à feuilles d’acanthe qui ornaient peut-être l’égout. Ce type de décors, héritage del’architecture monumentale et des plafonds classicisante, bien analysée par C. Pagani . La chercheuse, qui a pu étudier de près les deux ensembles, souligne les dimensions plus réduites des motifs du plafond de la domus de Dionysos et une plus grande attention au clair-obscur et aux détails qui rendent selon elle probable une datation contemporaine des peintures des parois, c’est-à-dire dans la première moitié du II s. Elle met en revanche en lumière les caractéristiques techniques plus grossières du plafond de la domus B de Santa Giulia et, surtout, leur contexte de découverte qui invite à penser que le plafond appartenait à la dernière phase de vie de la maison. Ces éléments parlent pour une datation plus tardive, peut-être contemporaine de celle des parois. Si l’on admet que le plafond restitué dans la cour de la domus de Dionysos est bien resté en place toute au long de la vie de la maison, il n’est selon nous pas à e xclure que les peintres travaillant dans la domus de Santa Giulia toute proche s’en soient inspirés. Nous avons là en tout cas un nouvel exemple de la longévité des schémas et des motifs.
Transpositions de ces compositions en parois
Ce goût que l’on devine, tout au long du IIe s. et jusqu’au IIIe s., pour les motifs répétitifs est également attesté sur certains décors de parois, comme l’ont déjà souligné, pour Rimini, D. Scagliarini et, plus récemment, A. Fontemaggi, O. Piolanti et C. Ravara502. Les attestations les mieux documentées, deux parois et un plafond issus de la domus du palazzo Arpasella, sont sans doute un peu plus précoces que la période qui nous intéresse mais l’on peut noter, pour le IIe s., le cas de la pièce R du palazzo Diotallevi (RIM 04.09) où les fragments en situation d’écroulement ont permis de reconstituer une composition orthogonale de cercles sécants avec cercles plus petits aux points de tangence et réticulé de tiges feuillues vertes. Signalons également, à Brescia, la composition d’octogones adjacents décorés de corbeilles de fleurs et déterminant des carrés surla pointe, composition restituée à partir des fragments récoltés dans les pièces 23 et 24 de ladomus C1 de Santa Giulia (BRE 04.01).
Cette bonne représentation des décors à motifs répétitifs s’explique d eplusieurs façons. Il ne faut sans doute pas négliger l’aspect technique, dans la mesure où il s’agit de décors faciles à appliquer, qui ne nécessitent pasune conception d’ensemble élaborée de la paroi. Au-delà de leur intérêt pratique, ces décorsdevaient aussi répondre au goût des commanditaires, comme le laisse penser leur présence sous des formes variées sur un site comme la villa de Sirmione et leur utilisation à la fois sur les plafonds et les parois. Il ne faudrait cependant pas surinterpréter ce phénomènecar une telle représentation s’explique également par le fait que ces décors peuvent êtrestituésr même à partir d’une faible quantité de fragments, ce qui n’est pas le cas des compositions centrées plus complexes.
Compositions centrées à emboîtements
Dans notre corpus, seuls trois groupes ont permis la restitution de compositions plus complexes : un premier issu de la pièce 11 de la domus des Fontaines à Brescia (BRE 02.08), un deuxième retrouvé en remblai dans ladomus di Via Cesare Correnti à Milan (MIL 01.03), un dernier provenant de la pièce 26 de la domus del Serraglio Albrizzi à Este (EST 01.01). Ces trois décors s’avèrent proches, tant par la structure que par les choix chromatiques. A Brescia, le schéma, à emboîtements sur fond jaune safran, est constitué de bandes concentriques rouges organisées autour d’un octogone central inscrit dans un carré. L’octogone est orné d’une Victoire ailée à côté d’un candélabre en argent ; le carré qui le contient est soutenu sur les diagonales par quatre candélabres desquels pendent des guirlandes végétales. Entre les bandes concentriques prennentplace des cadres et compartiments de différentes formes et décorés de motifs divers, situés dans les cadres ou posés dessus : dauphins, griffons, cratères, paniers contenant des objets, paysages monochromes à sujet sacro-idyllique. A Milan, les fragments récupérés ppartiennent à un plafond, également à emboîtements sur fond jaune, dont on peut partiellement restituer la structure : bandes concentriques dans lesquelles sont insérés des médaillons ornées de figures féminines ; d’autres fragments permettent de recomposer des compartiments ornés d’oiseaux et une figure féminine centrale. Enfin, le plafond de la domus d’Este témoigne des mêmes choix chromatiques (bande rouges et noires sur un fond jaune) mais selon un schéma peu plus complexe. Il est en effet issu d’une grande pièce rectangulaire dans laquelle on a préféré traiter le plafond en deux compositions à plan carr é juxtaposées. Seule une des deux a pu être restituée : il s’agit d’une composition à emboîteme nt avec diagonales affirmées. Des médaillons avec représentation figurée sont insérésau milieu des bandes rouges qui marquent les diagonales ; ils sont reliés entre eux par une bande noire, elle-même interrompue, au milieu de chaque segment, par un compartiment à red ans ; autour du carré central à fond noir ( ?) se déploient une série de frises concentriques, toutes différentes. Toutes les bandes colorées sont également rehaussées de fines frisesornementales. Il s’agit donc dans les trois cas de compositions à emboîtements sur fond jaune, organisées autour d’un compartiment central occupé, au moins dans deux cas, par un motif figuré ; on retrouve par ailleurs le même usage des bandes concentriques formant carrés ou rectangles et interrompues par des compartiments et / ou médaillons. Les couleurs dominantes, outre le fond jaune, sont le rouge et le noir ou le brun ; l’ornementation est riche.