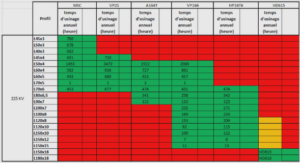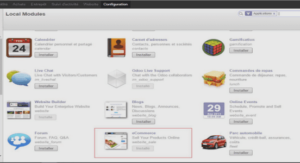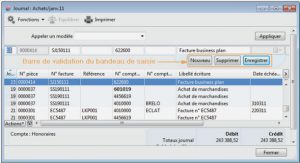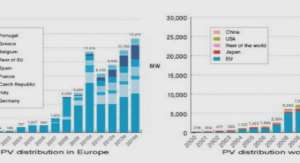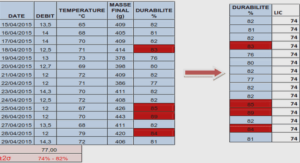Les réseaux pré-numériques
Les réseaux socionumériques sont trop souvent assimilés à un phénomène récent ; pour Castells, le réseau n’est pas une organisation nouvelle, mais au contraire ancestrale (Castells, 2002). Les réseaux sociaux en ligne ne doivent pas masquer l’ancienneté de pratiques et de formes de sociabilité dont il serait naïf de croire qu’elles ont été engendrées par Internet. En réalité, l’affaiblissement des liens, la transformation de la notion de groupe, l’horizontalisation et l’informalisation des relations ont précédé Internet, et l’ont peut-être même suscité, plutôt qu’elles n’en sont les conséquences (Mercklé, 2011a).
En Sciences Humaines et Sociales49, la notion de réseau est généralement convoquée pour ses caractéristiques sociales ; c’est un objet d’étude qui intègre un ensemble de relations interhumaines (Barnes & Grange, 2014, p. 209‑237), les infrastructures, les lieux, les flux, la médiatisation, sans omettre la mobilité des usagers. L’organisation « en réseau » multiplie les interdépendances en stigmatisant les sociétés contemporaines (Bakis, 1993).
A en juger les travaux d’analyse des réseaux sociaux (Wasserman et Faust, 1994 ; Lazega, 1995 ; Degenne et Forsé, 2004 ; Mercklé, 2011 ; Scott, 2012), leur origine est celle de l’humanité elle-même : dès lors qu’il y a interaction entre individus et entités sociales, il y a des réseaux sociaux. L’historiographie pose que des réseaux existaient déjà en France au XIXème siècle (Gribaudi & Blum, 1990), en Italie au XVème (Padgett & Ansell, 1993), dans la Rome antique (Alexander & Danowski, 1990) ou le Néolithique méditerranéen (Brysbaert, 2011).
Outre l’historienne Claire Lemercier, d’autres sociologues, anthropologues et politologues ont étudié les liens qui, de tout temps, ont existé entre individus. Différentes approches sont convoquées suivant qu’il s’agisse des élites florentines de la Renaissance, des réseaux égocentrés par le biais d’analyses de relations épistolaires, des réseaux familiaux liés à l’épiscopat, des réseaux scientifiques, économiques ou politiques.
Les académies italiennes
La terminologie d’académie est utilisée à partir du XVème siècle pour désigner un groupe de personnes animées de considérations intellectuelles se réunissant régulièrement pour discuter des sujets tels que la culture, les courants philosophiques, la recherche et les sciences. La particularité de ces académies était de donner lieu à des publications issues de ces échanges périodiques à l’instar de l’académie vénitienne, l’académie de Rome, Sienne, Bologne ou Padoue. Ces Académies endossent la fonction de promotion de la recherche dans différents secteurs tels que la littérature, les sciences naturelles, l’astronomie, l’histoire et la géographie (explorations), et les arts (musique, théâtre, arts figuratifs). La diffusion du savoir issu de ces communautés rayonnait à travers toute l’Italie et même en Europe moderne sous forme manuscrite ou imprimée.
« La façon dont une société fait corps, s’unit, en même temps qu’elle hérite d’une expérience du passé, ce que l’on appelle souvent la connaissance, mais aussi, et plus largement, les savoirs » (Stiegler, 2006, p.22).
Les salons mondains parisiens
En France, la première forme de réseau identifié remonte à 1779 ; il s’agit de salons aristocrates informels ne tenant ni procès-verbal ou liste de membres. L’un d’entre eux consignait toutefois dans un journal quotidien le nom des cent deux personnes qui rejoignaient trois fois par semaine le cercle d’aristocrates de cour, membres de l’administration royale, un médecin, des évêques, trois hommes de lettres, un savant… Loin d’être un salon littéraire, il s’agissait d’un lieu de sociabilité aristocratique dont l’objectif n’est pas de façonner des réseaux intellectuels, mais bien d’intégrer les hommes de lettres aux réseaux de la mondanité parisienne50, voire européenne. Ainsi, le XVIIème siècle sera une véritable « fête épistémologique » du réseau que l’on convoque pour trouver une explication à tout phénomène naturel ; l’Encyclopédie et Les Lumières trouvent des formes réticulées dans tous les corps qu’ils soient solides et cristallins, organisés et vivants.
« Le monde est fait d’un nombre incalculable de réseaux qui unissent les choses et les êtres aux autres » (Durkheim, 1955).
Les réseaux de communication horizontale
Dans un article intitulé « Réseaux de communication horizontale, un aperçu à travers le temps », Jacques Perriault dresse un état des lieux du réseau avant de s’intéresser en particulier aux réseaux sociotechniques (Perriault, 2012). Celui-ci recouvre une notion ternaire :
• Les réseaux de premier type comprennent les réseaux matériels au sens des infrastructures telles que chemins de fer, réseaux autoroutiers, métro…
• Les réseaux de second type sont les réseaux humains à l’instar des réseaux d’entraide, de solidarité dont les plus emblématiques sont certainement les réseaux de la Résistance. Il s’agit d’organisations sociales multipolaires dont l’objectif est d’agir ensemble, au nom d’une cause commune.
• Les réseaux de troisième type sont les réseaux sociotechniques, multipolaires et dévolus à la communication sous toutes ses formes.
Ainsi pour Jacques Perriault, l’organisation matérielle en réseau a également précédé le concept si l’on se réfère aux réseaux d’irrigation ancestraux, aux réseaux philosophiques ou scientifiques du XIXème siècle. Une acception médicale était également utilisée pour symboliser le réseau sanguin : on parlait alors de réseau admirable. Et de citer également Saint Simon ou Théophile Gauthier avec qui la notion est synonyme d’innovation. L’auteur s’intéresse ensuite
à une possible archéologie des réseaux de communication. Il parcourt l’histoire en quête de traces matérielles d’activités réticulaires à partir de réseaux commerciaux de l’Antiquité. A partir de fouilles archéologiques, des tablettes comptables mentionnant vendeurs et acheteurs ont permis de mettre à jour une cartographie d’échanges commerciaux assimilable à un réseau.
L’archéologie des réseaux de communication
Dans le même article, Perriault décrit la démarche archéologique effectuée en 1973 à partir d’archives relatives aux projections lumineuses pour l’éducation des adultes au XIXème siècle. Il s’agissait de plaques de verres utilisées pour des cours donnés le soir entre 1875 et 1914 ; selon un réseau de circulation propre, celles-ci étaient acheminées par la Poste en France et dans les colonies dans des boîtes en chêne sur lesquelles figuraient des étiquettes mentionnant l’adresse des instituteurs destinataires. A l’initiative de sociétés philanthropiques telles que la Ligue de l’Enseignement, la Bonne Presse ou le Musée Pédagogique, un réseau de distribution de plaques et de matériel de projection se mit en place à cette époque. L’archéologie des réseaux de communication est ainsi démontrée. Ce dernier exemple illustre parfaitement la troisième typologie mise en exergue ; il s’agit de réseaux de communication – à visée pédagogique – sociotechniques en tant qu’ils reposent sur l’utilisation de plaques de verre et de lanternes de projection pour remplir leur rôle pédagogique.
Pour autant, Perriault refuse d’attribuer aux réseaux socionumériques les vertus de sociabilité que l’engouement actuel semble accréditer. Pour ce faire, il remonte au début des années soixante pour retracer les prémices de ce que l’on nommait à l’époque la communication horizontale. Sous l’impulsion première de penseurs comme Deleuze, Guattari, Foucault ou encore Enzensberger, des mouvements sociaux et autres actions syndicales naissent çà et là, de façon multipolaire, tel un rhizome51. Dans la même veine, l’expérience de Schaeffer à l’ORTF52 a pour objectif de fonder une radio fonctionnant sur le modèle horizontal. Schaeffer, qui vient de théoriser le triangle de la communication53, recherche un modèle de communication radiophonique alternatif au réseau étoilé. ANTELIM54, la première radio à diffuser sans être contrôlée par une instance de programmation – en d’autres termes par le Pouvoir – émettra de 1979 à 1984. Cette expérience, pour le moins innovante, sera riche d’enseignements et déterminante pour le développement des réseaux de communication horizontale. Avec d’autres projets du même type, les prémices de l’Internet se dessinent : tous sont des projets empiriques, issus d’expérimentations sociales à contre-courant du modèle hiérarchique vertical.