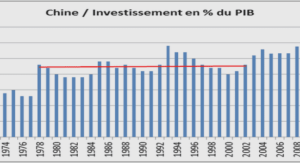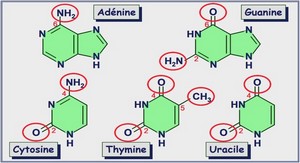Environnement sonore des élèves et représentations du CDI : quelle acoustique ?
En dépit de l’importance du silence et du bruit dans le CDI et de la pratique répandue parmi les professeur.es-documentalistes de rédaction d’un « état des lieux » lors de la prise de poste, il est rare qu’on y fasse figurer un « état des lieux » acoustique.
Moi-même, alors même que je pensais déjà rédiger un mémoire sur le sujet, je n’ai pas pensé en début d’année à y inclure cette information. Cet oubli, presque un acte manqué, en dit long sur la cécité volontaire que nous avons sur tout le travail que nous fournissons en gestion du bruit.
Il y a certainement une partie de honte « d’être la dame qui dit chut », une partie d’impuissance (on ne change pas facilement l’acoustique d’une salle quand on en est pas l’architecte) et d’incompétence normale (nous ne sommes par formé.es en acoustique, comment savoir que mesurer et par où commencer ?).
Idéalement le travail avec un programmiste ou un acousticien pour aménager le CDI (ou avec l’architecte si on crée le CDI) permettrait d’intégrer la fonctionnalité, c’est à dire le fait de soutenir l’apprentissage par le son, au sein même de la pensée design.
Lors de l’aménagement spatial du CDI, on pense volontiers à la lumière, à la couleur, qui sont en effet des données essentielles pour le confort de travail. Ce qu’il faudrait pour les CDI, comme pour les salles de spectacle et les salles de conte, c’est une réflexion sur le matériau et l’acoustique en relation avec la pédagogie.
Cette réflexion pourrait s’articuler autour des deux grands principes énoncés par Marielle de Miribelle : « Privilégier les solutions de bruit absorbé plutôt que de bruit réfléchi » et « Privilégier les ruptures de face plutôt que des grandes surfaces d’une même tenue. »28
On commence à observer l’application de ces principes dans certains CDI «modulaires » à l’aide de « paravents » sonores et de cloisons acoustiques, dans les bibliothèques universitaires avec l’installation de salles insonorisées pour des étudiants déjà autonomes et de mobilier phonique29, ou bien encore en bibliothèque municipale. Par exemple, à la bibliothèque de Pernes-Fontaine, dans l’espace co-working où l’on trouve des tables de travail, on a descendu des faux-plafonds carrés en tissu qui étouffent le son, sans nécessité de cloisonner l’espace.
Dans le CDI où j’ai précédemment exercé, au collège Darius Milhaud de Marseille, on avait installé un « T » acoustique pour reduire la réverbération. En y associant un tapis (la moquette et les tapis absorbent aussi la réverbération et provoquent un étouffement pour un son plus « gras » moins agressif) on avait crée un espace particulièrement propice au conte, et à la lecture…
Le travail en amont sur le lieu, et sur le mobilier (Des balles ou des roues sous les chaises pour atténuer les raclements, par exemple) devrait répondre d’ores et déjà à des logiques d’amplification ou d’étouffement du son selon l’usage de l’espace prévu en pédagogie.
A défaut, les professeur.es-documentalistes se retrouvent souvent dans un travail incessant d’adaptation de l’espace, dans le « rattrapage. »
C’était un peu le cas dans le CDI du lycée Saint-Exupéry où j’ai mené mes expérimentations : Très haut de plafond, vitré, il disposait d’une excellente acoustique depuis le fond de la salle vers le bureau, ce qui nous a permis une exploitation maximale lors des concerts organisés avec des musiciens dans le cadre de projets financés par la Région ainsi qu’une surveillance efficace des élèves, même dans les recoins éloignés du bureau.
Néanmoins les défauts de ses qualités étaient sensibles : difficulté à différencier l’espace entre les tables de travail et un espace plus « cosy » pour la lecture solitaire, surface «réfléchissant » les sons (Un espace ouvert ne permet pas le zonage et n’offre pas d’obstacle à la propagation du bruit30), angle mort dans le coin informatique où pourtant nous donnons une grande partie de nos séances…
Dans le cadre de mon mémoire, j’avais installé un sonomètre basique sur la tablette fournie au professeur.es par ma collectivité de rattachement et j’avais pour objectif de réaliser plusieurs relevés, parmi lesquels :
– Un son du CDI « vide » qui servirait de base pour le calcul de toutes les autres fréquences. Peut-être ce même son, avec en plus le bruit caractéristique que fait le lecteur de codes-barres lors du prêt, pour savoir si ce « bibliobip »31 avait une mesure en décibel qui le classerait au rang de nuisance ou non.32
– Un son du CDI avec des élèves (50) en leur demandant un silence absolu (pour vérifier si la résonnance était différente ou non.)
– Un son du CDI avec des élèves avec un bruit maximum (en sacrifiant une heure de grande affluence sans faire aucune gestion du son, peut-être.)
– Un son du CDI au moment où moi, professeure-documentaliste, je jugerai qu’il y aurait trop de bruit (pour évaluer mon propre seuil de fatigue auditive.) il faudrait sans doute plusieurs relevés sur plusieurs semaines car ce seuil n’est pas le même en fonction de la fatigue accumulée. Ce relevé pourrait aussi être effectué sur l’un ou l’autre de mes collègues dont le seuil serait différent.
– A tout hasard, je voulais aussi effectuer un relevé dans une rame de métro pour y comparer la nuisance sonore avec celle qui peut-être engendrée par les élèves.
Hélas, j’avais prévu d’attendre le printemps pour notamment grouper mes relevés au moment des révisions du bac, avec une affluence particulièrement forte au CDI ,
De par les circonstances particulières du confinement de mars 2020, je n’ai pas pu effectuer cette mesure.
Néanmoins, dans son étude sur le silence dans des bibliothèques lyonnaises, menée en 2018, Victor Kherchaoui a relevé ceci : « Au cours de notre enquête, nous n’avons pas enregistré d’intensité supérieure à 70 dB, pour une moyenne d’environ 50 dB pour chaque établissement visité. »33 Nous n’avons pas de raison de supposer que le relevé aurait été infiniment différent dans notre CDI ; sans doute, aurions-nous été plutôt dans le haut de la fourche, du fait de la jeunesse de notre public mais sans doute de peu.
Trouver un bon équilibre entre le silence et le bruit : sons à privilégier au CDI
Le son se caractérise selon plusieurs mesures : le volume (l’intensité, mesurée en décibels), la durée (le rythme, mesuré en battement par minutes), le timbre (la fréquence, mesurée en hertz).
Lent ou rapide ?
Le battement par minute est important pour déterminer l’effet qu’on cherche à obtenir, ainsi les résultats de cette étude sur l’effet d’une musique de fond au tempo élevé sur les performances cognitives sur l’apprentissage d’une langue concluent que ces effets sont observables et prédictibles.34
Intuitivement, nous nous doutons qu’une musique au tempo élevé excite, donne de l’énergie, quand une musique au tempo plus lent détend et apaise parfois plus qu’un anxiolytique comme le midazolam ! « When using music in order to decrease anxiety, it has been suggested that the best choice is calm music with 60–80 b.p.m., i.e. the same pace as the heart at rest. »35 Pour réduire les états anxieux, le meilleur choix se situe donc entre 60 et 80 battements à la minute parce que c’est à peu près le battement de notre cœur au repos.
Pour retranscrire cette unité en langage musical, on choisira donc de préférence des morceaux au tempo Larghetto (entre 60 et 66 bpm) ou Adagio (entre 66 et 76 bpm).
A l’exception du Tango dont le bpm se situe souvent entre 50 et 56 bpm , la plupart des genres musicaux modernes ont en général un bpm plus élevé.
C’est sans doute en partie à cause de cela que la musique classique et le jazz sont favorisés pour la réduction du stress chez les auditeurs (dans les ascenseurs et ailleurs.).
Néanmoins, au CDI, il ne faut pas se priver de choisir des bpm un peu plus élevés parce que l’objectif poursuivi n’est pas uniquement la détente des élèves mais leur motivation au travail. Sur ce point, on ne peut que recommander de rester à l’écoute des élèves.
Combien de décibels ?
« Une ambiance sonore de vingt-cinq à trente décibels est indispensable pour que ne soit pas créée pour l’homme une impression d’ennui et de solitude . »
C’est ce qu’écrivaient les médecins en 1962.36 Ces mêmes médecins affirmaient que l’inconfort apparaissaient à 50 décibels, l’agression auditive à 85, la douleur à 120.
De nos jours, l’association Journée Natonale de l’Audition donne des mesures encore plus normées en établissant six niveaux d’exposition au bruit, répartis sur une échelle de 0 à 140 décibels: très calme (de 0 à 25), acceptable (de 25 à 45), supportable (de 45 à 65), pénible (de 65 à 90), risqué (de 90 à 110) et nocif (de 110 à 140).
Comme on peut le voir, en dépit des variations individuelles, il existe donc un certain consensus. Sans nous avancer sur le nombre exact de décibels nécessaires au bien-être auditif de nos élèves, il est indéniable qu’un silence absolu peut représenter pour eux (comme pour nous) une source de stress. Et sans doute, notre intolérance au bruit trouve un équivalent dans leur réluctance face à un silence inquiétant et absolu.
Il faut donc réussir à trouver un équilibre qui permette les différents usages du CDI, tout en créant une atmosphère propice au travail et au bien-être. Peut-être quelquepart entre 20 à 30 décibels pour un son minimum et entre 50 à 60 pour une musique détendante.
Si l’on fait le choix d’une diffusion sonore collective au CDI (c’est à dire, pas une écoute individuelle grâce à des écouteurs), surtout si le lieu est grand, il faudra aussi prêter attention à l’acoustique, car il y a un différentiel entre l’enceinte, derrière l’enceinte (sans retour), éloigné de l’enceinte…