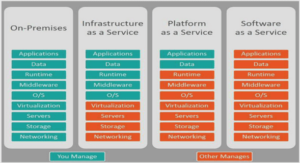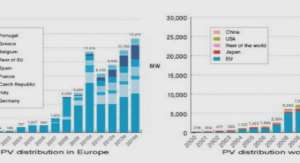Contrainte 1. Tri dans l’exploitation des signifiants pour désigner cette notion
Selon notre répertoire non exhaustif mais pouvant être représentatif, nous constatons que tous les signifiants sont composés de phones situés sur les axes des labiales et des dentales, d’une part, et des occlusives et des nasales, d’autre part. Toutefois, sauf à solliciter la quasi-totalité des phonèmes dans leurs réalisations, un tri a été nécessairement opéré par la structure pour la mise en saillance. En effet, les capacités formelles n’impliquent pas tous les phones. Par exemple, dans la catégorie du mode d’articulation labial, on note le peu d’actualisations sous la forme [f]- x ou x-[f] où x est [t], [d], [s], [tȓ] ou [θ]. Les quelques cas relevés sont :
Fusible (Del b. lat. fusibĭlis) 1. adj. Que puede fundirse.2. m. Hilo o chapa metálica, fácil de fundirse, que se coloca en algunas partes de las instalaciones eléctricas, para que, cuando la corriente sea excesiva, la interrumpa fundiéndose. (DRAE)
Fuste (Del lat. fustis, “palo”) 1. m. madera (parte sólida de los árboles ).2. m. vara (palo largo y delgado).3. m. Vara o palo en que está fijado el hierro de la lanza. 9. m. Arq. Parte de la columna que media entre el capitel y la basa. (DRAE)
Fusto (De fuste, “madera”) 1. m. rur. Hues. Pieza de madera de hil o, de 5 a 6 m de longitud, con una escuadría de 25 a 38 cm de tabla por 24 a 29 de canto. (DRAE)
Or, en l’occurrence, si fusible n’est qu’un dérivé defundir déjà répertorié, les deux derniers mots pourraient également être actualiséspar la saillance {ST} qui contient plus de dénominations de bâtons ou de pieux que cette structure-ci (cf. chapitre sixième). La majeure partie des capacités formelles repose, au vrai, sur des réalisations [bilabiale x dentale]. En somme, c’est clairement l’axe des bilabiales qui es t sollicité pour le premier membre. Mais au-delà du constat formel, il convient d’établir si ce choix restreint est dû aux contraintes systématiques au niveau des formes canoniques ou bien à un paramétrage structurel propre.
Contrainte 2. Établissement des formes cano niques existantes et de leur fréquence dans le système linguistique
Nous avons classé ci-dessous l’ensemble des formes mises à disposition par le système sur les axes mentionnés et issues du corpus OTA. L’objectif est de déterminer si l’éviction d’une racine synthétique ou analytique trouve son origine au niveau du système linguistique ou au niveau, plus étroit, de la structure, ce qui en ferait une des spécificités. Nous ferons donc apparaître toutes les possibilités de combinaisons existantes répondant au schéma [nasale x dentale] ou [bilabiale x dentale] et les fréquences d’usage en système pour discerner a posteriori lesquelles n’ont pas été sélectionnées.
Parmi les groupes consonantiques recensés, certains sont donc tolérés par le système, à des degrés divers, et plus ou moins sollicités. On notecependant que les lieux de compatibilité sont souvent les résultats d’une composition (exvoto, postverbal, adnato, vestfaliano, circumcirca, radiumterapia, bienplaciente).
Au vu de toutes ces données, nous prenons la mesuredes contraintes sémiogénétiques imposées par le système espagnol, d’une part et celles s’y ajoutant pour la spécification de cette structure, d’autre part. Nous ne décelons en effet dans les mots constituant le répertoire que les racines [m-t], [t-m], [m-d], [d-m], [n-t], [t-n], [nt], [nd], [m-s], [s-m], [m-θ], [m-ks], [b-θ], [b-s], [s-β], [m–s], [m–t], [b-t], [t-b], [t-p], [p-t], [b-d], [b-t] et, plus sporadiquement, [f-d], [f-t] et [f-s], soit 26 capacités formelles alors que le système autorise au moins 138 combinaisons phonétiques différentesi l’on ne tient compte que des variantes synthétiques et analytiques.688 Parmi ces formes canoniques, 32 sont attestées 100fois ou plus, seulement chez les variantes synthétiques.
Par exemple, la racine graphique m-x n’étant recensé qu’en 33 occurrences sur le corpus OTA est malgré tout exploitée ici. À l’inverse, la racine m-r attestée dans 4056 mots n’a pas été sollicitée par cette structure à ce stade de nos recherches. On discerne également dans le répertoire peu de racines dont le premier membre est le graphème v- (cf. vacilar) alors qu’elles sont globalement assez usitées par le système.
Par ailleurs, contrairement aux premières remarques, tous les phones ne se situent pas sur l’axe de la « bilabialité » ou des dentales. Nous avons donc intégré la fricative [s] au tableau. L’information que nous apporte cette « utilité du [s] » pour l’actualisation ici est que le lien entre les mots de la structure n’est pas uniquement d’ordre phonétique puisque aucun axe n’opère de lien entre le [s] et une (bi)labiale ou une dentale. Nous avons aussi fait figurer le son [θ] (représenté par les groupes ce- et -ci), qui, lui en revanche, se trouve au croisement des fricatives [s] ou [f] et des dentales [t], [d] ou [n]. Nous verrons plus avant ce qui légitime ces ajouts qui correspondent de fait à un nouveau p aramétrage. Déterminons d’abord l’invariant sémiologique auquel est associé ce concept de « tension entre un élément A et un élément B ».
Détection de l’élément saillanciel sémiologique
Pour le recoupement des mots du répertoire et des groupes cités, nous constatons que l’invariant sémiologique « simple » n’existe pas, mais que les réalisations phonétiques permettent de corréler certains vocables morpho-sémantiquement. Il importe en effet de considérer la saillance comme un point d’intersection. Ici, il est possible de prendre comme repère la racine [m-t], que nous considérons commela saillance motrice (ou matricielle), désormais dénommée {M-T}. Elle se compose en effetd’une labiale nasale [m] et d’une occlusive sourde [t]. C’est autour de cette combinaison de phones que gravite la majeure partie des racines phonétiques contenues dans les mots actualisés, le phone [m] étant le seul à se situer à la croisée des axes des labiales et des nasales présentes dans les racines des signifiants recensés. Concernant le son [t], s’il se trouve à la fois sur l’axe des occlusives et des dentales, il ne semble être sollicité dans le adrec de cette saillance, que pour sa propriété dentale. Par ailleurs, pour la constitution de l’invariant, c’est le phone non voisé [t] qui nous apparaît par défaut comme le plus convenant en tant qu’ antérieur. Plus qu’une saisie précise sur un moment de l’acte phonatoire, il s’agit donc ici de la combinaison de deux phones situés en des lieux articulatoires stratégiques pour la production du sens. Récapitulons ces informations sous forme de tableau pour plus de clarté en définissant le rapport à l’invariant.
Récapitulatif des corrélations phonologiques opérables
Tous ces paramètres augurent l’exploitation de mécanismes tels que la modulation de voisement ou la correspondance inversive, notamment, que nous avons déjà repérées lors de l’analyse de la structure en {nasale x vélaire}, mais aussi de la variation axiale.
Les corrélations sont donc basées sur des faits phonétiques assez simples . En revanche, les corrélats reposant non sur un lien phonétique mais sur une analogie plus propre au système : [t] / [s] ou [d] / [s] demandent une explication plus approfondie.
Exploration des capacités formelles [m-s], [s-m], [m-ks]
Légitimation de l’intégration de ces racines dans la structure en {M-T}
Si l’intégration sémantique à la structure en {M-T} de mezclar ou des suffixes meso-et semi-, par exemple, ne pose pas question, une cohérencedoit être établie au plan phono-articulatoire.
La corrélation avec la fricative palatale [s] est manifestement d’ordre analogique puisque non phonétique. L’on perçoit en effet dans le système la présence de la marque s-dans certains dérivés nominaux (ou adjectivaux) dont le radical s’achève en -d ou en -t : tender / tenso, tensión 689 ; persuadir / persuasión, persua sivo ; (ac)ceder / (ac)cesión ; sentir / sensible ; transmitir / transmisión , par exemple, où l’on remarque que la fricative se supplée à l’occlusive dentale (voisée ou non). Mesura et medida (dérivé demedir < metiri) sont un autre exemple en synchronie de cette aptitude corrélatoire. Enfin, nous pouvons ajouter – rapprochement plus audacieux – que le rapport t- / s- existe explicitement entre les pronoms et adjectifs personnels de seconde et de troisième personnes ti/sí ; tu / su ; te / se, etc. Quant à un thème m- « de première personne », il supposerait ici la duplication phono-consonantique potentiellement signifiante (m-m) ou au moins du trait nasal (m-n) ou encore bilabial (m-p ; m-b). C’est peut-être pour cette raison qu’il est absent des corrélations de cette structure car la duplication n’y serait pas perçue comme pertinente. Nous arrêterons là la comparaison.
Face à ces constats, nous pouvons admettre qu’il ex iste dans l’esprit des sujets parlants une marque de cette analogie, permettant ici d’établir un lien systématique entre [m-s] et [m-t] ou [m-d] est donc d’ordre analogique au niveau du système. Cela nous offre la possibilité par exemple de mettre en perspective les signifiants co-référentielsmeso-, semi- et medio.
Mise en regard des préfixes meso-, semi-, hemi- et d’autres formes en [m-s] avec medio
Soit les trois entrées suivantes extraites duDRAE690 :
Semi- (Del lat. semi-, Libro de Apolonio. Corominas, s.v. semi-) 1. elem. compos. Significa ‘medio’ o ‘casi’. Semidifunto, semitransparente, semiconsonante. (DRAE)
Meso- (Del gr. εσο , sin fecha. Corominas, s.v. medio) 1. elem. compos. Significa ‘medio’ o ‘intermedio’. Mesodermo, mesozoico. (DRAE)
Hemi- (Del lat. hemi-, y este del gr. ἡι -, 1438. Corominas, s.v. semi-) 1. elem. compos. Significa ‘medio’. Hemisferio, hemistiquio. (DRAE)
Medio, dia.(Del latín Mĕdĭus, Poema de Mio Cid) 1. adj. Igual a la mitad de algo. Medio metro.2. adj. Que está entre dos extremos, en el centro de algo oentre dos cosas.3. adj. Que está intermedio en lugar o tiempo.4. adj. Que corresponde a los caracteres o condiciones más generales de un grupo social, pueblo, época, etc. El español medio. El hombre medio de nuestro tiempo. La cultura media de aquel siglo. La riqueza media de tal país.5. adj. U. para designar, hiperbólicamente, gran parte de la cosa expresada. Medio Madrid fue a los toros.
D’un point de vue étymologique, tout d’abord, notons que Corominas ne met pas en relation les préfixes meso- et semi-, peut-être du fait qu’il ne consacre pas d’article spécifique à chaque affixe. Il est pourtant possible d’établir une corrélation sémantique entre des mots en [s-m] et d’autres en [m-s]. Selon Corominas (s.v. medio), d’un usage littéraire, meso, équivalent latin demedio, a été emprunté directement au grecεσο( ) tandis que semi- est issu du latin (Corominas, s.v.). Quant à la forme plus l ittéraire hemi-, elle procède directement du grec : ἡι (hêmi) (Corominas, s.v. semi-). Certes les suffixes hemi et meso sont tous deux savants mais l’analogie est tout de même palpable car le sujet parlant peut avoir en connaissance passive, dans sa compétence, les termes hemisferio ou Mesopotamia, par exemple, ce à quoi auront pu concourir leurs fréquences d’emploi respectives. 691