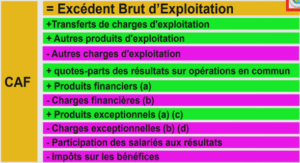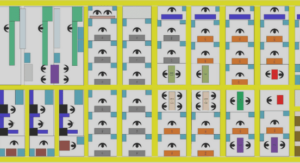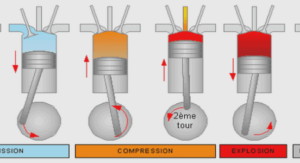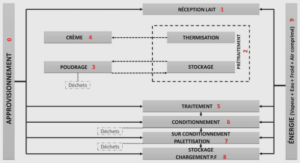Réseau hydrographique
Le bassin du fleuve Sénégal amont de Bakel ou bassin du Sénégal supérieur s’étend de la latitude 10°21 à la latitude 17°N environ et est compris entre les méridiens 7°W et 12°20’W. Sa forme est sensiblement ovoïde, et il est réparti entre la Guinée, le Mali, la Mauritanie et la Guinée. Il s’étend sur une superficie d’environ 218000km2 sur les 300000km2 que compte le bassin total.
Le Fleuve Sénégal en amont de Bakel est constitué par la jonction du Bafing et du Bakoye près de Bafoulabé. Long de 760 km ; le Bafing a un bassin versant de 38400km2 et fournit la majeure partie des écoulements du fleuve Sénégal (40% à 60%) des apports. Le Bafing prend sa source en Guinée, dans le massif du F outa Djallon, à 800 m d’altitude. Le Bafing est considéré comme étant la branche mère du f leuve Sénégal. Le Bakoye (640m) prend naissance en territoire guinéen, au Nord Ouest de Siguiri, près de la limite méridionale du plateau Mandingue, à 760 m d’altitude. Il reçoit le Baoulé en rive droite, avant de se jeter dans le Bafing. A partir de la confluence à Bafoulabé, le fleuve prend la dénomination « Fleuve Sénégal ». Il reçoit alors la Falémé (bassin versant de 29000km2), son plus important affluent rive gauche, qui prend sa source à 800 m d’altitude dans la région du Fouta Djallon en Guinée. Deux autres affluents intermittents en rive droite complètent le réseau hydrographique du Haut Bassin : il s’agit du Karakoro, de la Kolombiné et du Gorgol.
La station de Bakel contrôle la quasi-totalité des écoulements de la basse vallée.
Réseau hydrométrique
Parmi les stations hydrométriques du bassin amont, nous avons retenu celles qui sont actuellement utilisées par l’OMVS dans le cadre de la gestion des deux barrages de Diama et de Manantali. Il s’agit des stations de Dakka Saidou, Bafing Makana et Manantali sur le Bafing, de Oualia sur le Bakoye, de Gourbassi sur la Falémé, et Kayes et Bakel sur le Fleuve Sénégal (FigureIII- 2)
Les courbes de tarage sont généralement biunivoques, sauf à la station de Bakel dont la courbe de tarage est non biunivoque.
Données utilisées
Les stations retenues dans ce mémoire relèvent de la gestion des services l’OMVS (Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal). Cette dernière a gracieusement mis
à notre disposition des données provenant de sa base. Il s’agit des débits moyens journaliers recueillis au niveau des stations retenues. Ces dernières sont au nombre de sept : BAFING MAKANA, BAKEL, DAKA SAIDOU, GOURBASSI, KAYES, MANANTALI et OUALIA. L’étude couvre la période de 1961 à 2006 po ur toutes les stations sauf pour MANANTALI où les débits ont été enregistrés en 1988 à 2006 a près la construction du barrage. Ces débits recueillis seront ensuite traités à partir des méthodes que nous expliciterons la démarche et enfin une analyse et une interprétation résultats obtenus seront faites.
Méthodologie
La démarche que nous avons optée dans le traitement consiste, dans un premier temps, à faire une représentation graphique pour visualiser l’évolution des débits moyens mensuels et des modules annuels en fonction du temps. Pour cela, nous avons tracé des courbes représentant l’évolution interannuelle des modules, des débits et de leurs variables centrées et réduites avec une moyenne mobile. L’objectif ici est de déceler graphiquement toute tendance dans ces séries. Ensuite un traitement statistique des séries de modules annuels et des débits moyens mensuels est fait sur toutes les stations retenues en vue de détecter des ruptures, après que l’absence l’indépendance au sein des séries ait été vérifiée. L’indépendance est définie en terme d’absence de persistance entre observations successives. L’homogénéité est définie de diverses manières. L’échantillon est homogène lorsque les observations qui le constituent ont été générées à partir des mêmes processus physiques que la population mère, ou à l’issue de processus physiques voisins. Dans ce mémoire, nous définissons l’homogénéité d’une série par l’absence de rupture, celle-ci étant définie comme un c hangement dans la loi de probabilité de la série chronologique contenant les observations.
Pour faciliter l’étude, nous avons utilisé le logiciel KHRONOSTAT mis au point par l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), et disponible gratuitement sur le net. Les tests contenus dans ce logiciel ont été appliqués par un grand nombre de chercheurs sur les séries hydro pluviométriques en Afrique de l’Ouest et Centrale.
Préparation des données
Les données mises à notre disposition par l’OMVS (Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal) sont des débits journaliers enregistrés pendant la période de 1961 à 2006 pour toutes les stations retenues à l’exception des débits enregistrés dans la station de Manantali enregistrés depuis 1988 après construction du Barrage. De ces débits, de longues séries ont été créées. A partir des séries de débits moyens journaliers sur l’ensemble des stations retenues, les débits moyens mensuels, puis les modules ont été calculés. Les caractéristiques statiques (moyenne, mode, médiane et variance) ainsi que les principaux coefficients (coefficients de variation, coefficients d’asymétrie et d’aplatissement notamment) ont été calculés à l’aide du logiciel Hydraccess, les séries de variables centrées réduites constituées (voir tableaux ci-dessous).
Les valeurs des variances sont généralement très élevées. On assiste dès fois des coefficients de variation supérieurs à 0,2 et dépassant parfois 1 et en module supérieure à 0,3. Ceci met en évidence une mauvaise répartition des débits moyens mensuels et des modules annuels.
Les coefficients d’asymétrie sont positifs pour tous les débits moyens mensuels et des modules annuels de chacune des stations retenues à l’exception des débits moyens de Juillet et Février de la station de Manantali. Ce qui explique que les distributions en général sont étalées à droite.
Les coefficients d’aplatissement en majeure partie positifs. Cela montre que ces observations suivent des lois moins aplaties que celle de la loi normale.
Présentation et synthèse des résultats.
Les modules annuels
Le module annuel de débit est le débit moyen d’un cours d’eau calculé pendant le nombre de jours de l’année correspondante.
L’évolution interannuelle des modules annuels
La figure III-3 représente l’évolution temporelle à l’échelle annuelle des modules annuels pour toutes les stations à la période d’étude correspondante. En dehors de la station de Manantali, on note généralement un comportement similaire, plus ou moins accentué par une tendance à la baisse des écoulements entre 1961 à 1982 ou 1985, une tendance à la hausse ou à la stabilisation des écoulements de 1982 ou 1985 à 2006. Cette tendance à l a hausse est notée pour les séries de la station de Bafing Makana, de Dakka Saïdou et de Kayes. Par ailleurs pour les stations de Bakel, Gourbassi et d’Oualia l’évolution des séries entre 1982 ou 1985 à 2006 semble stationnaire.
A Manantali nous constatons une tendance qui semble être stationnaire durant la période d’enregistrement (1988-2006). La figure III-3 ci-dessus illustre les résultats.
Evolution interannuelle des valeurs centrés et réduits des modules annuels
L’indice pluviométrique permet de caractériser une période humide et sèche.
Les conclusions de l’évolution temporelle des séries de modules sont confirmées par l’analyse de l’évolution temporelle des valeurs centrées et réduites des modules annuels. Le tracé de la moyenne mobile a fait ressortir nettement ces deux tendances constatées lors de l’analyse de l’évolution temporaire des modules annuels. Pour toutes les stations la tendance à la baisse est généralisée sauf la station de Manantali où les enregistrements ont débuté en 1988. Cette dernière est caractérisée par une tendance plus ou moins constante. Entre 1983 ou 1986 e t 2006 les stations ont des tendances diverses. Les unes ont une tendance à la hausse (Bafing Makana, Dakka Saïdou et Kayes). Les autres ont une tendance stationnaire (Bakel, Gourbassi et Oualia). La figure III -4 ci-dessous en constitue une illustration des résultats. Nous remarquons, compte tenu du r ôle que joue l’indice pluviométrique, trois périodes pour chacune des séries : une période humide (1961 vers 1970) . Cette époque est suivie d’une période sèche (1970 vers la fin des années 90), ce qui met en évidence la sécheresse constatée vers les années 1970 en Afrique de l’Ouest. Et enfin une année qui semble être humide apparaît pour le reste des années d’enregistrement.