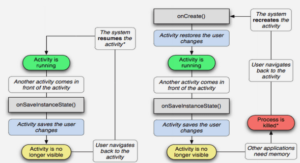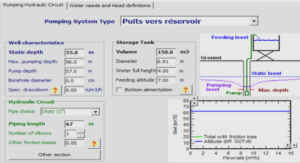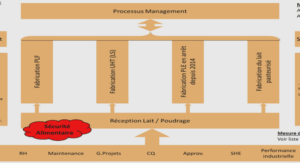SOCIÉTÉ PRIMITIVE ET SOCIETE MODERNE
Au cours de l’évolution sociale, les individus humains tentent de rétablir l’ordre juste dans les familles, mais leurs tentatives restent plus ou moins vaines. Leur échec est aussi confirmé par l’insuffisante des moyens qu’ils ont mis en œuvre pour maintenir l’ordre dans les sociétés : à peine se rassemblent-ils pour vivre en communauté que leurs membres sont déjà divisés par l’amour-propre.
Les blessures d’orgueil occasionnent des conflits. Faute de lois communes qui sanctionnent le mépris, l’outrage, la justice dans les sociétés primitives repose sur la vengeance. Ces sociétés sont rongées par le principe de la division interne et externe qui suscite l’inégalité psychologique.
Cette dernière est consolidée par l’apparition de nouveaux modes de production : l’invention de l’agriculture extensive et de l’industrie de fer développe l’inégalité économique (entre classes sociales) qui s’accentue dans les sociétés modernes. Ces dernières sont fondées sur un système de production et d’échanges entre travailleurs.
Or certains individus refusent de travailler mais décident de profiter des relations économiques. Quelles sont donc leurs méthodes pour y parvenir ? Comment l’opposition entre être et paraître engendre-t-elle les inégalités ? Il s’agit de montrer ici que la volonté de distinction (satisfaction) d’amour-propre accroît la hiérarchie sociale.
En d’autres termes, la non-conformité à l’archétype rationnel (l’utilité commune) bouleverse la propriété privée et les activités sociales. Celles-ci, visant au départ à satisfaire les besoins naturels des hommes entrés dans la société, s’orientent vers les désirs artificiels, inutiles.
Certains individus s’approprient exclusivement des terres, tandis que d’autres hommes sont privés du nécessaire pour vivre ; certains citoyens travaillent excessivement, tandis que d’autres demeurent extrêmement oisifs.
LA SOCIÉTÉ PRIMITIVE
Historiquement, la présence de la femme chez Rousseau coïncide avec le début de la société étant donné que dans l’état de nature le mâle ne se distinguait pas de la femelle, c’est-à-dire ils avaient un mode de vie identique : « chaque famille devint une petite Société […] ; ce fut alors que s’établit la première différence dans la manière de vivre des deux Sexes, qui jusqu’ici n’en avaient qu’une. »
La femme arrache l’homme à son monde solitaire et le propulse dans le monde communautaire qui produit les nations primitives. Celles-ci sont nées de la fédération des familles hétérogènes mais unies par l’amour, les mœurs et des caractères communs. Ces éléments identitaires n’empêchent pas toutefois des conflits entre les membres des nations primitives.
Pourquoi l’identité ethnoculturelle ne fonde-t-elle pas durablement le sentiment d’unité nationale dans les premières nations ? Et pourquoi leurs premières règles de justice aboutissent-elles au désordre général ? a. Pourquoi l’amour, les mœurs et caractères communs sont-ils incapables de fonder durablement le sentiment d’unité nationale ?
Tout commence à changer de face. Les hommes errans jusqu’ici dans les Bois, ayant pris une assiète plus fixe, se rapprochent lentement, se réunissent en diverses troupes, et forment enfin dans chaque contrée une Nation particulière, unie de mœurs et de caractères,
non par des Réglemens et des Loix, mais par le même genre de vie et d’alimens, et par l’influence commune du Climat. Un voisinage permanent ne peut manquer d’engendrer enfin quelque liaison entre diverses familles