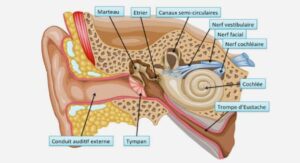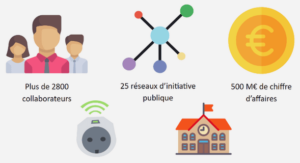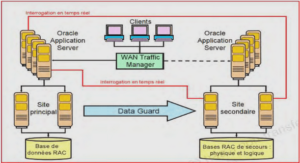Dé-essentialiser la culture et les différences culturelles
Dans une approche qui mobilise des éléments de la psychologie et de l’anthropologie, Rogoff essaye de comprendre le rôle de la culture dans le développement de l’enfant, et notamment dans ses apprentissages. Le développement humain est, selon elle, un processus culturel. Son ouvrage The Cultural Nature of Human Development (Rogoff, 2003) montre comment les individus se développent en tant que participants à des communautés culturelles. Afin d’utiliser le langage et d’autres outils culturels et d’apprendre les uns des autres, les individus s’appuient sur l’héritage culturel et biologique. Au lieu de considérer les façons de faire spécifiques à une certaine communauté comme étant « naturelles », l’auteure les considère comme des possibilités de faire (Rogoff, 2003, p. 3), pour ainsi mettre en question les postulats incontestés issus des pratiques d’une communauté. En partant d’exemples concrets, elle montre que les objectifs du développement humain varient considérablement en fonction des traditions culturelles et des situations des différentes communautés, qui sont continuellement en train de changer. Par exemple, plusieurs études mettent en lumière l’âge à laquelle l’enfant devrait avoir certaines compétences. L’approche culturelle du développement proposée par Rogoff montre que différentes communautés culturelles peuvent avoir des attentes concernant la participation des enfants à certaines activités à des moments très différents de leur enfance, et considérer les « calendriers » de développement dans d’autres communautés comme surprenants ou même dangereux (Rogoff, 2003, p. 4). Il s’agit donc des variations culturelles de représentations de l’enfance et du développement. Ainsi, aux États-Unis et en Angleterre les enfants sont considérés comme étant incapables des garder d’autres enfants, et cela jusqu’à l’âge de 14 ans. Dans d’autres communautés culturelles, les enfants commencent à être responsables de leurs frères et sœurs entre 5 et 7 ans, comme dans la communauté Maya de Guatemala, ou même avant cet âge, comme dans la communauté Kwara d’Océanie, où les enfants travaillent dans les jardins et à la maison et prennent soin de leurs frères et sœurs dès leurs 3 ans. Rogoff s’appuie sur les travaux du psychologue russe Vygotski (1978) et sa théorie socioculturelle du développement. Contrairement aux théories du développement qui traitent l’individu séparé de son contexte social et culturel, l’approche de Vygotski suppose que le développement de l’individu doit être considéré dans son contexte social, dans le cadre des institutions qu’il fréquente et dont il fait partie. L’enfant a un rôle actif dans le développement humain et son développement social est le résultat de l’activité collective, activité qui est située dans une société, à travers les interactions avec les autres. Selon Vygotski, dans l’appropriation de la culture par l’individu, le langage joue un rôle essentiel, qui est à la fois un outil pour participer au sein d’une communauté et un porteur de codes culturels, outre son rôle cognitif. L’enfant acquiert et utilise la langue et ainsi reproduit une culture construite depuis des générations. Les enfants apprennent à utiliser les outils de réflexion à travers leurs interactions avec des adultes et des pairs dans le cadre de la zone proximale de développement. Selon Vygotski, s’engager dans des interactions avec d’autres pairs plus expérimentés, ou des parents ou des enseignants, permet à l’enfant de mieux apprendre, par rapport à des interactions avec des enfants d’un même niveau cognitif. Dans la même lignée, Rogoff souligne dans ses démarches théoriques l’importance de l’activité collective de l’enfant avec ses pairs et les adultes. Elle affirme que « le développement humain est un processus de participation des personnes aux activités socioculturelles de leurs communautés » (Rogoff, 2003, p. 52). Elle suggère d’étudier le développement de l’enfant et son engagement dans les activités socioculturelles en prenant en compte à la fois la communauté, la dimension interpersonnelle et celle individuelle au sein des activités collectives (Rogoff, 1996).
Selon Rogoff, la culture n’est pas une collection statique de caractéristiques, mais fluide négociée et renégociée en permanence (Rogoff, 1996). Dans une approche historique et socioculturelle, pour elle :
« Il s’agit de concevoir la culture non plus comme une caractéristique stable et singulière des individus, mais comme l’expérience des pratiques culturelles, à travers l’histoire d’une vie et d’une communauté. Ces histoires contribuent alors à la propension des individus (et des communautés) à agir selon certains modes, de manière dynamique, variant d’une génération à l’autre et selon les contacts avec d’autres modes de fonctionnement. » (Rogoff et al., 2007, p. 128)
Au lieu d’utiliser des termes qui désignent les individus en fonction de leurs origines nationales ou ethnique, comme « français », « mexicain » ou autre, qui pourraient envoyer à des expériences communes, mais ne peuvent pas être employés pour créer des stéréotypes, Rogoff et ses collaborateurs considèrent que les origines culturelles sont représentées par la participation des individus aux pratiques culturelles (Gutiérrez & Rogoff, 2003; Rogoff & Angelillo, 2002; Rogoff et al., 2007). Dans cette perspective, le concept de répertoire de pratiques de-essentialise la culture et les différences culturelles en prenant en compte la participation des individus aux pratiques et expériences quotidiennes. Plutôt que de privilégier des stéréotypes, cette approche permet de comprendre les différences culturelles en partant des expériences communes dans des pratiques culturelles et historiques d’une communauté. Le terme « répertoire », selon le dictionnaire français Larousse, provient du bas latin repertorium, inventaire, et du latin classique reperire, retrouver. Il est définit comme : « recueil, livre comportant des données classées selon un certain ordre ; registre, cahier, carnet dont les pages sont munies d’onglets pour permettre une consultation rapide ; titre donné à des recueils méthodiques ; ensemble des œuvres qu’a l’habitude d’interpréter un artiste, une troupe ».
Pour Rogoff et ses collaborateurs (2007, p. 123), le terme répertoire de pratiques décrit : « (…) la variété des pratiques familières à chacun, avec la possibilité de les mettre en application sous divers formats, selon les circonstances. L’idée des répertoires de pratiques renvoie au fait que les individus sont engagés dans plusieurs traditions. » S’il se rapproche du concept habitus du sociologue français Bourdieu (2000), le concept de répertoire présente des différences, qui seront explicitées après une brève définition du concept bourdieusien. En sociologie, Bourdieu propose ce concept pour désigner des manières d’être, un ensemble d’habitudes ou de comportements acquis par un individu ou un groupe social. Pour lui, l’habitus correspond à des « systèmes de dispositions durables et transposables » (Bourdieu, 1980, p. 82) acquis par les individus qui appartiennent à une même catégorie sociale, vivant dans des conditions similaires et ayant les mêmes goûts, comportements, vision du monde. Dans son ouvrage, Esquisse d’une théorie de la pratique, il explique : « L’habitus est le produit du travail d’inculcation et d’appropriation nécessaire pour que ces produits de l’histoire collective que sont les structures objectives (e. g. de la langue, de l’économie, etc.) parviennent à se reproduire, sous la forme de dispositions durables, dans tous les organismes (que l’on peut, si l’on veut, appeler individus) durablement soumis aux mêmes conditionnements, donc placés dans les mêmes conditions matérielles d’existences. » (Bourdieu, 2000, p. 282)
La langue est une structure sociale structurée essentielle qui construit et permet l’expression de l’individu. Elle est acquise dans un contexte social et culturel spécifique. Bourdieu considère que l’habitus est inculqué pendant la socialisation dite primaire de l’individu et continue à s’achever pendant la socialisation secondaire. L’enfant intériorise et apprend des normes, des valeurs, des principes et des règles de son groupe social d’appartenance à travers l’éducation familiale et scolaire. L’habitus est une :
« loi immanente, lex insita, déposée en chaque agent par la prime éducation, qui est la condition non seulement de la concertation des pratiques mais aussi des pratiques de concertation, puisque les redressements et les ajustements consciemment opérés par les agents eux-mêmes supposent la maîtrise d’un code commun et que les entreprises de mobilisation collective ne peuvent réussir sans un minimum de concordance entre l’habitus des agents mobilisateurs (e.g. prophète, chef de parti, etc.) et les dispositions de ceux dont ils s’efforcent d’exprimer les aspirations. » (Bourdieu, 2000, p. 272) Dans la perspective de Bourdieu, l’habitus fait référence à des comportements acquis au sein d’une classe sociale qui sont reproduits d’une génération à l’autre, qui deviennent comme une seconde nature. Dans la perspective proposée par Rogoff, les répertoires de pratiques sont mobilisés par l’action de l’individu, une certaine agency est possible en ce qui concerne la construction identitaire. L’action individuelle est en lien avec les processus contextualisés et la façon dont les personnes passent d’une situation à l’autre. Les enfants et les adultes ont une certaine marge de choix entre plusieurs approches qu’ils peuvent mettre en place au sein des interactions, quoique les pratiques ne soient pas toujours choisies par les individus. De façon réflexive ou pas, chacun peut adapter ou sélectionner une approche de son propre répertoire, en faisant appel à sa capacité d’agir ou agency (Rogoff et al., 2007). Les enfants peuvent refuser ou négocier des pratiques auxquelles ils participent dans la vie quotidienne.
Cette démarche théorique historique et culturelle va au-delà des caractéristiques rigides ou innées de l’individu, pour se centrer sur les expériences des enfants dans des activités. Il s’agit de leur engagement tout au long de la vie dans des activités culturelles spécifiques. Ainsi, selon Rogoff et ses collaborateurs, la culture ne désigne pas les caractéristiques de l’individu mais leurs activités en cours (Gutiérrez & Rogoff, 2003). En adoptant cette approche, les auteurs argumentent contre les régularités qui seraient statiques et contre les traits généraux des individus basés sur leur appartenance à un groupe ethnique. « Caractériser les répertoires ou les tendances des enfants impliquerait caractériser leur expérience et leur initiative dans des activités culturelles antérieures (Rogoff, 1997). Nous caractériserions leurs répertoires en termes de leur familiarité concernant leur engagement dans des pratiques particulières sur la base de leur histoire et celle de leur communauté. Par exemple, les élèves qui ont participé à des divers traditions culturelles présenteront des différences dans leurs répertoires en ce qui concerne la participation à des discussions avec des figures d’autorité, leurs réponses à des questions dont les réponses sont connues par les adultes, leur analyse des problèmes de mots sur la base de prémisses contrefactuels, cherchant ou évitant de se distinguer pour être appréciés, spontanément aider ses camarades de classe, observer les événements en cours sans la gestion des adultes, en répondant rapidement ou en réfléchissant avant d’offrir volontairement leurs contributions, et de nombreuses autres approches qui sont parfois traitées comme des caractéristiques d’individus. »3 (Gutiérrez & Rogoff, 2003, p. 22)
La culture comme expériences incarnées et situées
Dans « Writing Against Culture » (Écrire contre la culture), Abu-Lughod (1991) s’attache à critiquer le concept de culture tel qu’il est souvent utilisé par les anthropologues culturels, comme un outil qui les placent dans une position d’autorité. Selon Abu-Lughod (1991, p. 446) « la culture agit dans le discours anthropologique pour renforcer des séparations entre soi et autrui, ce qui crée inévitablement des hiérarchies ». En citant l’ouvrage Writing Culture (Écrire la culture) (Clifford & Marcus, 1986), une collection d’essai qui met en question les écrits ethnographiques de l’anthropologie culturelle, Abu-Lughod réclame l’absence de deux groupes de cet ouvrage, groupes qui contribueraient à la critique des travaux portant sur la culture. Il s’agit des féministes et des « halfies » (moitiés) qui sont « des personnes dont l’identité nationale ou culturelle est mixte due à la migration, à l’éducation à l’étranger ou à la filiation » (Abu-Lughod, 1991, p. 446). Ces catégories permettent une mise en question des frontières entre soi et les autres, et ainsi de réfléchir sur la nature conventionnelle et les effets politiques de cette distinction, pour repenser le concept de culture. Les féministes et les halfies critiquent une vision rigide, stricte et homogène de la culture, cet outil anthropologique qui créé l’autre et la différence, et implicitement une relation de pouvoir. Pour cette raison, l’auteure suggère que les anthropologues devraient envisager des stratégies pour écrire contre la culture.
Abu-Lughod suggère trois stratégies pour confronter le concept de culture et ses effets problématiques de positionnalité, notamment les inégalités. La première stratégie vise à démonter des discussions théoriques sur le concept de culture en se concentrant davantage sur les pratiques et les discours des individus. La deuxième stratégie souligne l’importance des connexions locales, nationales et mondiales contemporaines et historiques pour mettre en question la culture, comme entité homogène d’une certaine communauté. La troisième stratégie consiste dans l’écriture des « ethnographies du particulier », qui reconnaissent que toutes les études et analyses sont partielles et positionnées (Abu-Lughod, 1991, p. 473).
Abu-Lughod propose une perspective proche de l’approche de Rogoff sur la culture comme expérience des pratiques culturelles, en redéfinissant ce terme comme étant des expériences incarnées des individus ayant des vies humaines particulières et participants à des pratiques recréées en permanence par des personnes ayant des relations sociales. Elle propose une stratégie pour écrire contre la culture comme entité homogène, afin d’éviter la généralisation.
La généralisation, comme utilisée dans les écrits en sciences sociales n’est plus considérée comme étant une description neutre (Foucault, 1975; Said, 2006), et dans le cadre d’une science qui se veut objective, elle implique un langage de pouvoir. Un autre problème de la généralisation que l’auteure signale est qu’elle représente les effets d’homogénéité, de cohérence et d’intemporalité qu’elle produit. La réalité est caractérisée par des exceptions et des nuances au sein des contextes culturels, que la généralisation risque d’effacer. « Quand on généralise des expériences et des conversations avec un certain nombre de personnes spécifiques dans une communauté, on a tendance à aplanir les différences entre eux et les homogénéiser. L’apparente absence de différenciation interne rend plus facile le fait de concevoir un groupe de personnes comme un groupe distinct, une entité homogène, comme « le nuer », « les balinais » et « les bédouins d’Awlad Ali », qui font cela et qui ont telles ou telles croyances. L’effort de produire des descriptions ethnographiques générales de croyances ou d’actions des personnes tend à atténuer les contradictions, les conflits d’intérêts, les doutes et les querelles, sans parler de l’évolution des motivations et des circonstances. » (AbuLughod, 1991, p. 475)
Ainsi, l’auteure propose une ethnographie du particulier selon laquelle les individus occupent des positions particulières dans un temps et un lieu spécifique, la réalité quotidienne de chacun étant unique et distincte. Il faudrait donc focaliser l’analyse sur des personnes et raconter les expériences des individus particuliers, dans des lieux et des périodes de temps déterminés. Cette approche bouleverserait, selon elle, les connotations négatives portées par le terme de culture, notamment l’homogénéité, la cohérence et l’atemporalité. Mon étude se focalisera ainsi sur l’analyse des pratiques des enfants, en tant que personnes singulières, dans des contextes spécifiques (des classes d’école maternelle à S) et pendant des périodes de temps précises (première et, en partie, deuxième année de l’école maternelle). Elle contribue à lutter aussi contre une perspective illusoire de l’homogénéité de l’enfance (Danic et al., 2006).
La dynamique identitaire des enfants nés en France, le pays d’accueil des parents migrants
Des nombreux termes sont utilisés pour désigner les enfants nés dans le pays d’accueil où leur famille a immigré, par exemple enfants issus de l’immigration ou seconde génération d’immigration. Quoiqu’utiles, ces termes catégorisent les enfants d’un point de vue statistique, et prennent en compte la situation des parents, mais ne prennent pas en compte leur propre expérience spécifique dans le contexte social où ils se retrouvent. Sans prétendre avoir trouvé le terme le plus adéquat, cette partie présente les concepts théoriques mobilisés afin de mieux positionner les expériences vécues par des enfants nés en France, appartenant à des familles migrantes. Dans un souci pragmatique, je retiens le terme « enfant de migrant », associé à la dimension de migrancy de son expérience, qui implique une dynamique identitaire hybride.
Grandir en migrancy
Si les parents sont nés à l’étranger et ont migré dans un autre pays, et sont considérés comme migrants, les enfants participants à cette étude sont nés en France, et pourtant considérés également comme des migrants d’un point de vue statistique (INSEE, 2010). Ils « grandissent en migrancy », un syntagme anglophone proposé par les éditeurs Seeberg et Gozdziak dans l’ouvrage Contested Childhoods : Growing up in Migrancy. Migration, Governance, Identities (2016). Elles distinguent entre le processus de migration et l’espace social dans lequel se retrouvent les enfants de migrants. Cet espace social dont ils font partie en tant qu’acteurs à part entière façonne leur dynamique identitaire en parcourant des langues, des contextes culturels et des histoires familiales (Chambers, 1994). Seeberg et Gozdziak soutiennent l’idée selon laquelle « un nombre croissant d’enfants grandissent, non principalement dans un lieu ou une période, mais dans un espace social appelé migrancy » (Seeberg & Gozdziak, 2016, p. 8). Elles critiquent la définition du dictionnaire anglais Oxford sur la migration, comme étant le statut de migrant ou définir le migrant comme classe ou groupe. Le migrancy est un espace social où grandissent des enfants qui ne sont pas des migrants, mais parce que leurs parents ou même leurs grands-parents l’étaient. Les auteurs citent Näre (2013, p. 605) (2013, p. 605), pour montrer leurs perspective sur la signification du terme « migrancy » comme « (…) la subjectivité socialement construite du ‘migrant’ (…), inscrite dans certains organes de la société au sens large et les pratiques législatives en particulier. (…) Très souvent, la subjectivité inscrite de la migration est attribuée non seulement à ceux qui ont migré ».