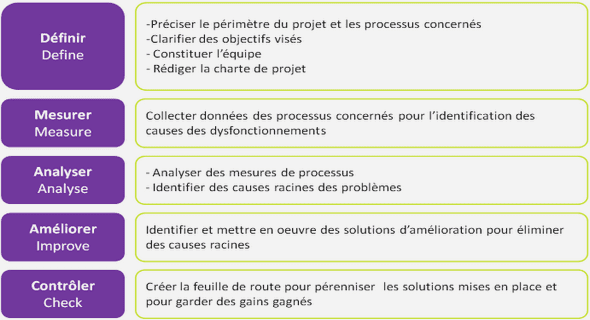Le commandement de l’armée malgache
L’armée malagasy comporte les forces de l’armée de terre, armée de l’air et l’armée navale. Son commandement est placé sous l’autorité du chef de l’État-Major général de l’Armée malagasy (CEMGAM) qui relève de l’autorité hiérarchique du ministre de la Défense nationale. Le CEMGAM participe à l’élaboration de la politique du gouvernement en matière de défense et exécute les directives du ministre de la Défense nationale. Dans l’exercice de ces fonctions, il est le responsable de l’organisation, de la préparation et de l’emploi des forces. La gestion du personnel militaire et civil relève du ministère de la Défense nationale, en collaboration avec le CEMGAM, en particulier celle des officiers généraux, supérieurs ainsi que la coordination des activités communes. Il est nommé par décret pris en conseil des ministres et à rang de secrétaire général de ministre.Plusieurs services et états-majors sont rattachés directement à l’État-major général de l’armée malagasy (EMGAM) dont premièrement son cabinet et les services centraux, le commandement des six régions militaires, le commandement des forces implantées à Antananarivo constitué par les forces d’intervention de l’armée, les forces de développement, les forces aériennes et les forces navales. L’EMGAM assure en partie le soutien logistique et administratif de l’académie militaire, du régiment chargé de la sécurité présidentielle et du bataillon chargé de la sécurité des institutions.
Le commandement de la gendarmerie nationale
La Gendarmerie nationale, faisant partie intégrante des Forces armées, participe à la Défense de la souveraineté et des intérêts de la Nation sous l’égide du Ministère des Forces armées. Son commandement relève de l’autorité du commandant de la gendarmerie, qui est placé à son tour sous l’autorité du secrétaire d’État à la gendarmerie (SEG). Le rôle du SEG est de concevoir, élaborer et de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de sécurité relevant du domaine de la gendarmerie nationale. Il est rattaché au ministère des forces armées. À cet effet, les principes suivants régissent les relations entre les deux ministères : premièrement, l’administration générale, l’emploi, l’organisation et l’exécution des missions de la gendarmerie nationale relèvent directement du Secrétaire d’État à la gendarmerie. Deuxièmement, ce qui relève du ministre des Forces armées en collaboration avec le SEG, la gestion du personnel militaire (en particulier celle des officiers), l’organisation et la coordination des activités et domaines communs à l’armée et à la gendarmerie nationale.
L’organisation au sein du secrétariat de la gendarmerie est composée de divers échelons de commandement, à savoir le cabinet du SEG, le commandement de la gendarmerie nationale, et les organismes rattachés. En ce qui concerne le cabinet, le rôle de son directeur est de coordonner et de superviser les activités des membres du cabinet. Il est chargé du traitement des dossiers à caractère politique, des informations et communication dans les relations avec les institutions nationales et internationales et de toutes missions qui lui sont confiées par le SEG. Il assiste le SEG dans la vision globale et l’évaluation politique de la situation dans le domaine de la sécurité.
Organisation interne de l’institution militaire
Organisation hiérarchique
S’inspirant du modèle bureaucratique de M. WEBER, plusieurs institutions essaient d’adopter un système d’organisation hiérarchique, mais elle trouve son aspect le plus abouti au sein de l’institution militaire. Pour K. LANG le trait spécifique de l’organisation militaire se dessine sous trois formes, à savoir l’organisation hiérarchique, la chaine de commandement descendant et l’aspect communautaire. Cette organisation hiérarchique des armées a servi de fondement pour la distinction entre aspects bureaucratiques et professionnels de la vie militaire. Ce qui fait que les deux types d’éléments tendent à coexister au sein de l’institution. Mais la culture de l’institution militaire varie si elle se rapproche du modèle bureaucratique ou du modèle professionnel.
Les indicateurs de cette bureaucratisation sont : la prégnance de lois, règlements et circulaires ; le commandement est fondé sur le grade et l’autorité ; les groupes de référence (ceux auxquels les subordonnés voudraient appartenir et auxquels ils s’identifient) sont situés verticalement dans la hiérarchie.
À l’inverse, les indicateurs de la professionnalisation sont : l’importance des codes éthiques professionnels ; le commandement est fondé sur la compétence professionnelle ; les groupes de référence sont situés horizontalement (ces groupes, les plus innovants permettent de rencontrer d’autres professions au sein ou en dehors de l’institution).
Il est toutefois à remarquer que cet aspect bureaucratique pouvait provoquer un certain autoritarisme dans les rapports humains entre les militaires.
Le commandement ou general ship
Le principe hiérarchique amène le fractionnement du commandement, des personnels militaires en deux catégories distinctes. En effet, le commandement militaire est fondé sur le principe que, quelle que soit la situation, en présence de deux membres de l’institution, l’un est nécessairement subordonné à l’autre par l’ordre des grades et dans chaque grade par ordre d’ancienneté. Ainsi, est assurée la reconnaissance immédiate du détenteur du pouvoir, qui l’exerce de manière individualisée et exclusive. Ce modèle s’observe en réalité dans toutes les institutions bureaucratiques, mais avec une force toute particulière au sein de l’institution militaire. Il rend impossible la compétition entre les acteurs pour le pouvoir, puisque, quelle que soit la situation, les ordres seront donnés par une unique source et qu’ils seront incontestables et exécutés.
Le contrôle de l’État sur l’institution militaire
Un État sans armée est un cercle carré, dont nulle société n’a encore résolu le problème de ce cercle. Seuls les États du Vatican et la Suisse sont tout à fait dépourvus d’une force autonome, mais elle subsiste toujours sous forme de police et de garde nationale. En effet, l’illusion serait de considérer l’armée comme une force uniquement tournée vers l’extérieur et de juger de son existence à l’aptitude qu’aurait un État à déployer un corps de bataille opposable à ceux de ses rivaux. Pourtant, l’armée est indissociable à l’État, car elle est la forme nue de rapport de domination et de souveraineté qui fonde tout État. Pour Lénine, «l’État, c’est des bandes d’hommes armées», Weber quant à lui affirmait d’une manière plus noble, en reconnaissant que « l’État a le monopole de la contrainte physique légitime », toutes ces visions tendent à reconnaitre le rôle central de l’État au contrôle des forces armées.
De l’époque royale jusqu’à l’avènement de la République, le Prince et le chef de l’État se voit affublé par la tradition de la constitution du titre de Chef suprême des forces armées. C’est de là que naît l’ambiguïté du rôle confié au président de la République. L’autorité au pouvoir tend donc à soumettre l’armée à l’État.
Table des matières
INTRODUCTION GÉNÉRALE
Généralité
Motifs du choix du thème
Motifs du choix de terrain
Problématique
Hypothèse
Objectifs
Méthodologie
Techniques
Limites de la recherche
Plan du document
PARTIE I : FORCES ARMÉES MALAGASY ET LES VERTUS MILITAIRES
Chapitre 1 : États des lieux sur les forces armées malgaches
1.1. L’armée royale
1.2. L’armée coloniale
1.3. Le passage de l’armée coloniale à l’armée nationale
1.3.1. L’assistance technique militaire sous la Ière RÉPUBLIQUE
1.3.1.1. Aide directe en matériel
1.3.1.2. Assistance en personnel
1.3.1.3. Formation des cadres militaires
1.3.2. Directoire militaire de 1972-1975
1.3.3. La IIe RÉPUBLIQUE sous le régime socialiste révolutionnaire
1.3.4. Les forces armées durant la crise politique de 1991-1993
1.3.5. Le morcèlement des forces armées sous la crise postélectorale de 2002
1.4. Organisation et fonctionnement des forces armées malagasy
1.4.1. La compétence du chef de l’État et du premier ministre sur la politique de défense
1.4.2. Les attributions du ministre de la Défense nationale sur les forces armées
1.5. Les forces armées malgaches
1.5.1. Le commandement de l’armée malgache
1.5.2. Le commandement de la gendarmerie nationale
Chapitre II : Présentation du terrain et cadre théorique de la recherche
2.1. Présentation du terrain
2.1.1. Cadre juridique de l’état-major mixte opérationnel
2.2.1. Organisation interne de l’institution militaire
2.2.1.1. Organisation hiérarchique
2.2.1.2. Le commandement ou general ship
2.2.1.2.1. Les trois dimensions du commandement
2.2.1.3. La culture de la discipline
2.2.2. Le contrôle de l’État sur l’institution militaire
PARTIE II : LA REPRÉSENTATION SOCIALE DES FORCES ARMÉES
Chapitre III : La représentation sociale des forces armées par les citoyens
3.1. Présentation du panel
3.2. Résultat de l’enquête
3.2.1. Intérêt sur la question militaire
3.2.2. Idées reçues sur les forces armées
3.2.3. Connaissance de l’existence des forces armées
3.2.4. Les rôles des forces armées selon les personnes enquêtées
3.2.5. L’autorité des trois entités de forces de sécurité
3.2.6. La confiance envers les forces de sécurité
3.2.7. La raison de confiance envers les forces de sécurité
3.2.8. Les clichés sur les forces armées
3.2.9. L’accomplissement des missions confié aux forces armées
3.2.10. Le renforcement de capacité opérationnelle des forces armées
3.2.11. Connaissance de l’existence de l’EMMO
Chapitre IV : Les forces armées et la politique
4.1. Implication des militaires dans la vie politique
4.2. Les sphères d’activité incompatibles au métier des forces armées
4.3. La participation des militaires dans la sphère politique
4.4. Les postes politiques préjudiciables aux forces armées
4.5. Les militaires connus dans la sphère politique malagasy
4.6. La période politique propice à la politisation des forces armées
4.7. La raison politique de la nomination d’un officier
4.8. La nomination d’un militaire dans la sphère politique comme étant la preuve de la militarisation du pouvoir
4.9. Les conséquences négatives de la politisation des forces armées
4.10. Les conséquences positives de la militarisation du pouvoir politique
Chapitre V : Les forces armées dans le rouage politique
5.1. La militarisation du gouvernement de 1972 à 1991
5.2. Le retour en caserne impulsé par le comité de réflexion des forces armées
5.3. Le clientélisme au sein des forces armées malgaches
5.4. Le clientélisme à l’origine de la scission des forces armées au cours de la crise de 2002
5.5. Écartement progressif des forces armées dans la sphère politique sous le régime de RAVALOMANANA
5.6. Politisation des forces armées
5.6.1. Politisation des forces armées sous le régime de RAJOELINA
5.6.2. Militarisation de l’administration des régions
5.6.3. Indice de militarisation du pouvoir politique de 1972 à 2014
PARTIE III : APPROCHES PROSPECTIVES DE LA RESOLUTION DE LA PROBLEMATIQUE
Chapitre VI : Professionnalisation des forces armées
6.1. Redéfinition du cadre d’emplois des forces armées
6.1.1.La défense opérationnelle du territoire
6.1.2.Renforcement de la sécurité intérieure
6.1.3.Développement de l’esprit de défense et d’unité nationale
6.1.4.Renforcement de la défense civile
6.1.5.Contribution au développement économique et social
6.1.6.Contribution à la défense économique et environnementale
6.1.7.Participation aux opérations de maintien de la paix
Chapitre VII : Suggestions et recommandations
7. Redéfinition du principe d’utilisation des forces armées par les autorités civiles
7.1. Application du contrôle civil sur les forces armées
7.2. Adoption du concept de défense
7.3. Démilitarisation du gouvernement
7.4. Amélioration du cadre de vie des militaires
CONCLUSION GÉNÉRALE
Bibliographie