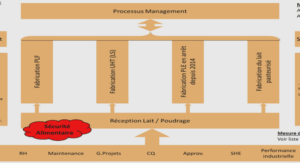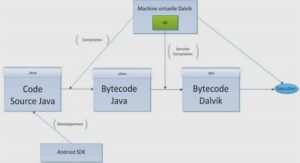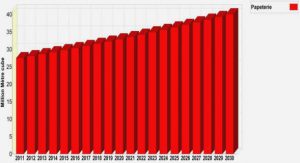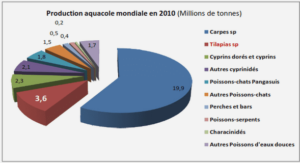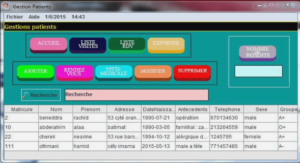De bons et de mauvais élèves
Aujourd’hui le discours le plus fréquent sur l’économie insiste sur sa complexité et induit une certaine disqualification de ceux qui ne possèdent pas les connaissances nécessaires pour la maîtriser. Il aboutit également à entériner le fait que la réflexion et la décision dans ces domaines obscurs doivent être laissées aux experts, à ceux qui présentent les cursus scolaires les plus brillants, garantie indispensable pour une direction éclairée des affaires. Cette manière de concevoir le monde de l’économie, qui peut d’ailleurs être intéressée et correspondre à la valorisation par certains de diplômes chèrement acquis, signifierait aussi que l’on ne saurait diriger une grande entreprise, mener les investissements d’un holding, accumuler richesses et pouvoirs économiques, sans être sorti d’une grande école, sans avoir en poche le diplôme de Polytechnique ou de l’ENA.
Or, il n’en est rien. La diversité dans les origines sociales des nouveaux entrepreneurs se retrouve aussi dans leur rapport à l’institution scolaire. Bons et mauvais élèves se côtoient. Bien plus : l’école n’est pas nécessairement le levier qui a permis aux plus démunis de compenser la faiblesse des ressources dont ils disposaient par leur naissance. Ce ne sont pas les plus pauvres qui ont fait les meilleures études. Les diplômes et les grandes écoles sont des moyens pour les enfants de milieux modestes d’engager une ascension sociale dans la fonction publique ou dans les états-majors des entreprises. Ils peuvent être un moyen pour certains d’accéder à la fortune professionnelle. Ce n’est pas une condition nécessaire, et encore moins suffisante.
Des autodidactes et des énarques
Jean-Pierre Savare, Franco Cesari et Raymond Obermajster n’ont pas le baccalauréat et s’ils ont suivi des études secondaires, ils sont largement autodidactes pour nombre des savoirs pratiques qu’ils mettent en œuvre dans leur activité de chefs d’entreprise. Jean-Charles Naouri et Marc de Lacharrière ont fait l’ENA après des cursus scolaires brillants. Louis Roncin cumule le diplôme de l’École centrale et de l’Institut d’études politiques (Sciences-Po) et Robert Zolade des diplômes de sciences politiques, de droit et de sciences économiques. Yvon Gattaz a fait l’École centrale de Paris plus quelques certificats de la licence de droit. Tandis que Jacques Bourgine, Pierre Blanc, Paul-Louis Halley et Pierre Bellon ont fait leurs études dans des écoles d’ingénieurs ou de commerce, Jean-Marc Lech a suivi des études universitaires de philosophie et de sociologie, Frank Ténot a entamé une préparation aux grandes écoles d’ingénieurs, non couronnée de succès, et Francis Reversé n’a pas poursuivi sa scolarité au-delà du baccalauréat. Rémy Robinet-Duffo a un diplôme d’études supérieures d’économie politique et de sciences économiques et André Rousselet une licence en droit.
Des parcours aussi variés ne permettent pas d’imputer des effets décisifs aux résultats scolaires. Ce que la diversité de ceux-ci met en évidence, c’est l’importance d’autres facteurs d’ordre personnel. Pour autant, on ne peut pas se contenter d’inverser l’image méritocratique du bon élève qui réussit et interpréter l’échec à l’école comme un facteur de stimulation qui conduirait à la volonté de prendre une revanche.
Il y a bien une même logique entre l’idéologie méritocratique, entre la compétition scolaire comme obsession du classement et de l’élimination, et la dureté du monde concurrentiel des entrepreneurs. Mais les facteurs déterminants de la réussite, de l’efficacité compétitive, se situent en amont, ou en
tout cas en dehors de l’institution scolaire elle-même. L’école a été utilisée par certains comme moyen d’accéder au sommet économique de la société. Elle n’a pas été le facteur déclencheur de trajectoires exceptionnelles. Tous les énarques ne deviennent pas de grands patrons aux fortunes professionnelles dépassant la centaine de millions. Et à l’inverse, on ne peut pas déceler dans un arrêt précoce de la scolarité ou des échecs apparemment définitifs le fondement d’une attitude de défi, l’individu cherchant à faire ses preuves contre l’institution qui l’a rejeté, ou dans laquelle il n’a pu se mouler.
Jean-Pierre Savare, président du groupe François-Charles Oberthur, rate son baccalauréat. Entré dans la vie active, dans le domaine de l’informatique, il suit des cours aux Arts et Métiers de Paris et obtient un diplôme de préparation aux affaires. « J’avais deux raisons pour réussir, analyse-t-il. La première vis-à-vis de mon père qui n’avait pas voulu que je redouble l’année de mon baccalauréat. Et la deuxième, vis-à-vis du monde entier pour leur dire : ne croyez pas que je sois un imbécile, si je n’ai pas fait d’études, c’est parce qu’on ne m’a pas aidé à les faire. Sinon j’aurais fait d’excellentes études. Ce dont je reste persuadé. » Les études étaient terminées avant d’avoir véritablement commencé. Que faire, sinon prouver au père que le fils est talentueux, qu’il peut réussir. Prouver que l’on n’est pas
« un imbécile » est une chose, mais l’enjeu était bien plus important. Il s’agissait de renouer avec la lignée, interrompue durant une génération, pour reprendre le flambeau entrepreneurial. Aujourd’hui, Jean-Pierre Savare peut savourer sa réussite : la reconquête d’une position sociale qui ne correspondait pas à la vision de son père, vision que le fils ne saurait envisager puisque le sens de sa vie est dans l’action patronale. Que l’argent ne soit pas tout transparaît dans l’attention que Jean-Pierre Savare accorde sans réticence aux gains symboliques manifestés par la notice dont il bénéficie dans le Who’s who ou par son élévation au rang d’officier de la Légion d’honneur. « Je pense que si j’avais fait l’X ou Centrale comme mon fils, dit-il, j’attacherais moins d’importance à ces signes extérieurs de réussite et de notoriété. » Aujourd’hui sa mère, qui fut serveuse de restaurant, vit dans une grande demeure en Normandie avec plusieurs domestiques. « C’est la revanche de ma mère. » Mais aussi, bien sûr, celle de son fils.
On nous a raconté l’anecdote de cet entrepreneur qui a réussi dans les affaires, ayant toutefois raté son baccalauréat. Son cauchemar favori, à cinquante-cinq ans, c’est l’apparition de son père en statue de commandeur lui disant : « C’est très bien, tu as bien réussi, mais maintenant il va falloir que tu ailles passer ton bac ! » Il y a une certaine fierté à avoir réussi dans les affaires après avoir échoué à l’école. Daniel Filipacchi, l’associé de Frank Ténot, se revendique comme autodidacte. À la rubrique « Études » de sa notice dans le Who’s who, on peut lire : « École communale du 9 de la rue Vaugirard à Paris ». Aussi, c’est avec une certaine joie que Daniel Filipacchi, avec son partenaire préféré, Frank Ténot, a accepté l’offre de Jean-Luc Lagardère d’entrer dans le groupe Hachette où son père occupait une position importante, mais comme salarié. Frank Ténot raconte que « Daniel n’a même pas réfléchi, il n’a même pas discuté les conditions. C’était pour lui quelque chose de fabuleux, c’était la légende qui devenait réalité. Il allait être l’un des plus gros actionnaires d’une maison dont son père avait été l’un des grands “commis”, comme on disait autrefois ». Quand on demande à Franco Cesari quel est son niveau de diplôme, il répond sans ambages « Bac moins trois ». « Autour de moi je n’ai que des Sciences Po et autres HEC, alors j’adore dire Bac moins trois. » Mais ces patrons ne font pas de l’« autodidaxie » la clef de la réussite en général. Ils sont très attentifs à la scolarité de leurs enfants. Le fils aîné, âgé de quinze ans, de Franco Cesari est scolarisé à Saint-Jean-de-Passy, et le fils de Jean-Pierre Savare a fait l’École centrale de Paris, ses filles ayant réussi des études commerciales à l’université. « J’ai un fils exceptionnel, musicien, sportif, il a même été admissible à l’X. Il ne m’a donné que des satisfactions. » Les trois enfants de Jean-Pierre Savare ont des responsabilités dans l’entreprise familiale. Exemple incarnant cette logique qui conduit à associer du capital scolaire et culturel au capital économique, le temps passant.
Dans leur enquête sur les dirigeants d’entreprises cotées sur le Nouveau Marché, Michel Bauer et Bénédicte Bertin-Mourot notent eux aussi qu’« au total on rencontre donc deux types d’entrepreneurs très contrastés : des autodidactes, d’une part, des hauts diplômés, plutôt de formation scientifique et technique, d’autre part[17] ».
Des études scientifiques et commerciales mais aussi des études de droit et de sociologie
La formation et les compétences spécifiques des grands patrons interviewés frappent par leur diversité. Tous n’ont pas fait des études scientifiques et commerciales. La sociologie peut conduire à la fortune. Jean-Marc Lech et Didier Truchot, son associé, l’ont prouvé.
La diversité des origines sociales mettait déjà en évidence l’importance de facteurs qui tiennent aux histoires individuelles. Les cursus scolaires et les disciplines confortent cette conclusion : les nouveaux entrepreneurs ont suivi des itinéraires très diversifiés et ils doivent leur bonne fortune, leur réussite à une interaction constante et dynamique entre leur personne, c’est-à-dire du social incorporé et une histoire psychique singulière, et les conditions de leur pratique, social objectivé en particulier dans l’économie. C’est dans la rencontre entre la volonté de réussir propre à Jean-Marc Lech et le développement extraordinaire des sondages d’opinion que l’on peut expliquer une telle réussite professionnelle. C’est également avec la libéralisation des radios privées que Jean-Paul Baudecroux, en 1981, a eu l’idée de créer NRJ. N’ayant pourtant suivi que des études secondaires, selon sa notice dans le Who’s who 1993-1994, il est aujourd’hui à la tête d’une fortune professionnelle de 3,3 milliards de francs selon Capital (1998), ce qui lui vaut le dix-huitième rang des fortunes professionnelles de la région parisienne.
Les frères Blanc sont aussi un bon exemple de l’importance du secteur économique dans lequel la réussite est réalisée. Le père, Clément Blanc, dans le cadre de ses donations, avait fait quatre lots pour ses quatre fils.
Deux lots concernaient ses affaires dans le domaine du commerce en gros de la viande et les deux autres étaient composés de restaurants, dont Le Pied de cochon. Les deux aînés choisirent le secteur de la viande et les deux cadets celui de la restauration.
Ainsi, dans tous les cas, on trouve comme schéma pour rendre compte de la réussite (et parfois de l’échec, mais ce n’était pas notre objet) une combinaison de facteurs, parfois très personnels, comme une blessure narcissique remontant à l’enfance, parfois très globaux, comme l’évolution de secteurs économiques en déclin.
Reste un facteur qui semble avoir beaucoup perdu de sa pertinence, depuis les analyses de Max Weber, celui de la religion [18]. Weber voyait dans le protestantisme une source importante de la constitution de la mentalité capitaliste propre aux entrepreneurs des débuts de la Révolution industrielle. Or, les patrons interviewés sont majoritairement catholiques, à l’image de la société française, avec des degrés très divers dans la pratique elle-même, et deux sont de religion juive. Aucun n’est protestant et pourtant tous, comme on va le développer, sont des bourreaux de travail, préférant l’accumulation du capital à la jouissance effrénée des biens de ce monde. Est-ce à dire que la pensée protestante continue à influencer la mentalité capitaliste, alors même que la pratique religieuse se marginalise, y compris chez les patrons ? Ne peut-on pas plutôt avancer l’hypothèse d’un habitus patronal, propre aux premières générations d’entrepreneurs qui, bâtissant leurs affaires, rencontrent au XIXe siècle la pensée protestante, mais continuent aujourd’hui, dans un monde laïcisé, à adopter les seules stratégies qui permettent de gagner dans la concurrence intercapitaliste, différer le moment de la jouissance et privilégier la croissance ?
Des bourreaux de travail
Dans les propos recueillis, l’argent n’est que rarement mis en avant. Il n’apparaît pas comme la motivation première du travail acharné sur lequel les interviewés, au contraire, insistent volontiers. L’effort personnel est revendiqué comme source principale de l’enrichissement. Comme fruit du travail et du mérite, la richesse devient légitime en s’inscrivant dans l’idéologie méritocratique. Les hésitations de certains devant la perspective de la transmission de leurs affaires à leurs enfants relèvent de cette posture selon laquelle la richesse héritée n’a guère de valeur et de légitimité. Mais objectivement placés en position de légataires, les nouveaux patrons se trouvent ainsi devant une contradiction, entre leurs réticences en face de l’héritage et leur volonté de transmettre. On retrouve, à des degrés divers, des traces de cette contradiction dans chaque entretien.
Le rapport au travail est variable selon les individus et surtout selon les phases de leur ascension sociale. Si, au moment de l’entretien, l’accent est mis sur la nécessité de déléguer et de s’appuyer sur une équipe en laquelle on ait la plus grande confiance, il semble bien qu’il n’en a pas toujours été ainsi et que, dans les débuts, la charge de travail s’est trouvée particulièrement alourdie par la nécessité de contrôler et de mettre en place soi-même tout le dispositif qui allait permettre de faire fortune. C’est probablement là que réside l’explication de la fréquence des duos parmi ces nouveaux entrepreneurs. Ou encore de la présence de parents proches dans les structures de direction de l’entreprise. Le monde des affaires est un monde dangereux où les autres sont aussi des concurrents qui ne sont pas toujours animés des meilleures intentions. Les frères Blanc et les frères Gattaz sont des exemples de ces équipes formées de parents proches, ce qui permet une grande confiance dans le partenaire et empêche l’émergence de ce sentiment de solitude que peut ressentir le grand patron isolé au sommet de sa création. Mais l’amitié peut remplacer la famille et Jean-Marc Lech avec Didier Truchot, Robert Zolade avec Francis Markus, ou Frank Ténot avec Daniel Filipacchi, sont exemplaires de ces duos fondés sur une confiance absolue en l’autre. Cet appui, sur lequel on sait pouvoir compter, permet de mener son action en partageant les risques. Car ce qui caractérise ces entrepreneurs, c’est le goût de l’action, la créativité dans le monde des affaires, qui leur font risquer leur mise sur une idée, sur un projet dont les chances de réussite ne sont jamais certaines. Partager le risque de l’aventure permet de limiter l’angoisse, mais aussi le temps consacré au travail.
Des journées bien remplies
La passion qui habite les entrepreneurs se traduit dans l’importance du temps consacré au travail. Jacques Bourgine et Robert Zolade mentionnent des journées de quatorze heures. Franco Cesari, à cinquante-deux ans, revient le dimanche après-midi dans ses somptueux bureaux de la rue François-Ier pour y travailler après une journée commencée sur un terrain de golf. « Mais il est vrai, commente-t-il, que le travail pour moi est un plaisir puisque j’ai toujours envie d’entreprendre. » Qu’il faille nuancer ces affirmations, peut-être, mais de toute façon, cette revendication de l’importance accordée au travail est une manière de souligner la part objective prise par l’entreprise dans la vie quotidienne et la dimension personnelle incontournable de la réussite. Les affaires qui marchent et prospèrent sont le fruit de la passion de ceux qui les animent. Partant, leur richesse démesurée, eu égard aux revenus et au patrimoine de la très grande majorité des Français, apparaît comme légitime, méritée par cette offrande de la personne au dieu travail.
Les vieilles familles de banquiers ou d’industriels ont aussi à résoudre ce problème de légitimation, ne serait-ce que dans la mesure où le maintien de la domination suppose un minimum d’adhésion et que soient reconnues de bonnes raisons à son existence et à sa perpétuation. Les riches héritiers légitiment leur richesse par l’accumulation d’autres formes de capitaux. Ainsi peuvent-ils mettre en avant leur bon goût culturel, leur culture scolaire et artistique, la qualité de leurs manières, leur courtoisie et leur affabilité. À cela s’ajoute la richesse sociale de réseaux familiaux et amicaux tissés et entretenus au fil des décennies qui assurent un pouvoir sans égal dans toutes les sphères de l’activité sociale. Les nouveaux venus ne disposent pas de telles ressources car elles demandent du temps pour leur accumulation. Chez les entrepreneurs de la première génération, la légitimité ne saurait être collective, comme dans le cas des vieilles familles de la noblesse et de la bourgeoisie, où la légitimité passe par un travail de toute la classe. Elle reste au contraire individuelle chez ceux qui ne doivent leur position et leur richesse récente qu’à la qualité de leurs œuvres. Les entrepreneurs mettent donc volontiers le travail à l’origine de leur enrichissement. C’est ainsi que l’on peut entendre le discours de Jean-Claude Sensemat, PDG d’un groupe qui commercialise de l’outillage : « Je suis parti de zéro, déclarait-il à France Inter. Je suis un pauvre devenu riche. Je me suis enrichi par mon travail. L’argent que j’ai provient de mon travail et non point de la spéculation, grâce aux produits et aux entreprises que je crée. Je vis en dessous de mes moyens puisque je travaille en permanence. C’est par le travail que l’on devient riche, c’est en ayant de l’imagination, en entreprenant, et là il n’y a pas de question de chance, c’est le travail et l’intelligence de savoir saisir des opportunités[19]. » Fils de modestes artisans, Jean-Claude Sensemat jouit d’une notice dans le Who’s who de 1997-1998 qui mentionne, entre autres titres de gloire, qu’il a été élu manager de l’année 1995 par Le Nouvel Économiste.
Mais au-delà de son poids réel dans l’accumulation des fortunes professionnelles comme condition nécessaire de la réussite, et au-delà de son rôle comme moyen de légitimation, le travail et le temps qui lui est consacré sont des agents protecteurs contre l’angoisse inattendue qui peut naître de la très grande richesse. Les nouveaux patrons ne sont pas toujours formés pour faire face à une telle fortune, fut-elle potentielle. Le temps compté et le travail envahissant offrent alors un refuge paradoxal devant une fortune si conséquente qu’elle intimide, dirait-on, ses possesseurs. Les nouveaux riches ne se comportent pas aussi volontiers que le pense le sens commun comme des « nouveaux riches », c’est-à-dire comme ces représentations toutes faites qu’en offrent volontiers une certaine littérature, des feuilletons télévisés ou les pages spécialisées des hebdomadaires. Dans son analyse de la bourgeoisie capitaliste en Europe durant la période post-napoléonienne, Joseph Schumpeter note également « dureté, âpreté au gain, autorité, puissance de travail, autodiscipline impitoyable qui implique en particulier le renoncement à d’autres aspects de la vie. Ce dernier facteur échappe souvent à l’observateur étranger au milieu, porté à retenir plutôt les seuls excès compensateurs[20] ». Aujourd’hui plus encore, la concurrence pèse lourdement sur l’avenir, car elle est devenue mondiale. Les nouveaux entrepreneurs savent très bien que leur fortune professionnelle est fragilisée par l’accroissement des échanges, la disparition des protections douanières et l’entrée en lice d’industriels et d’hommes d’affaires de nouvelles nations.
L’enquête étant centrée sur l’entreprise et sa transmission, elle mettait plutôt l’accent sur la dimension professionnelle de la fortune. Les plaisirs de la richesse en étaient d’autant moins volontiers abordés que l’ascétisme ainsi mis en évidence était plus facilement utilisable dans une perspective de légitimation de la réussite et de la fortune. Un mode de vie souvent éloigné des mondanités, lié à des habitus construits dans des conditions bien plus modestes, le caractère figé d’un patrimoine essentiellement professionnel, le travail comme élément central d’une justification méritocratique de la fortune, tout cela concourt à jouer dans le sens de la légitimation et du renforcement de la croyance dans la rotation des élites et dans l’égalité des chances.
Mais cette configuration de pratiques et de représentations trouve aussi sa raison d’être dans une situation sociale qui n’autorise pas le triomphe sans retenue. Aujourd’hui, si l’idéologie libérale domine, elle doit composer avec un chômage endémique et une mise hors jeu d’une fraction de la population. Aussi l’entrepreneur trouve-t-il dans la mise en avant de son travail, des résultats de celui-ci, et dans la continuité des efforts entrepris, une légitimité en tant qu’employeur pourvoyeur d’emplois. La personnalité dynamique de l’industriel va à l’encontre du déclin économique généralisé et de l’exclusion sociale. L’entrepreneur se retrouve homme de devoir, soucieux de l’avenir de son entreprise et de celui de ses salariés ou plutôt de ses « collaborateurs », ce terme manifestant qu’ouvriers, employés et cadres travaillent avec leur patron pour le bien commun de l’entreprise et donc de la société.
Une journée ordinaire d’un grand patron
Rémy Robinet-Duffo, soixante-huit ans, est le propriétaire et le dirigeant du groupe d’assurances et de conseil Henner. Il est par ailleurs président du MEDEF (Mouvement des entreprises de France) Paris. Il a fait des études de droit et on a vu qu’il avait suivi une lignée familiale à la fibre très entrepreneuriale tout en ayant franchi un palier important quant au montant de la fortune accumulée. Le jour de l’entretien, en décembre 1998, Rémy Robinet-Duffo a accepté d’ouvrir son agenda et de décrire le programme de sa journée.
« Aujourd’hui je me suis levé à 6 h 45, et comme je n’aime pas trop me bousculer, je suis parti à 8 h 15 avec ma voiture et mon chauffeur. J’ai lu les journaux et écouté les informations à la radio. Arrivé rue Henner, j’ai eu une réunion à 9 heures avec trois interlocuteurs et deux collaborateurs. C’était une réunion importante qui concernait le devenir informatique de notre organisation. De 11 heures à 12 h 35, j’ai reçu quelques collaborateurs, j’ai lu et écrit du courrier, j’ai téléphoné et je suis parti déjeuner aux Buttes-Chaumont, dans le 19e arrondissement. Le président de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris souhaitait me présenter le secrétaire général du syndicat FO de Paris. C’était donc un rendez-vous d’échanges et d’informations entre un responsable patronal du MEDEF et un syndicaliste. À 15 heures, je suis revenu à mon bureau pour préparer le voyage en Chine, depuis Hongkong jusqu’à Shanghai, où je dois partir demain soir pour mes affaires. J’ai rencontré deux collaborateurs et vous êtes arrivée. À 18 h 30, il faut que je sois à l’ambassade des États-Unis pour rencontrer l’ambassadeur. C’est important, comme vous pouvez l’imaginer. Puis j’irai à une réception offerte par le président des commissaires aux comptes, ce qui veut dire que je rentrerai chez moi entre 21 h 30 et 21 h 45, puisque je ne resterai pas pour le dîner qui est offert. »
Une journée bien remplie avec des horaires très précis qui font penser à la vie monastique lorsqu’elle obéit à la règle de saint Benoît. Celle-ci est fondée sur le principe que « l’oisiveté est ennemie de l’âme[21] », de telle sorte que le temps doit toujours être plein et rythmé par des horaires fixes. Lorsque les bénédictins ne travaillent pas, c’est qu’ils prient. Les offices sont nombreux chaque jour et ils ponctuent la journée avec les cloches qui les annoncent. Sans doute est-ce une façon efficace de bannir toute angoisse existentielle. De même un temps plein, rythmé par des horaires non pas fixes mais précis, permet, d’une part, de faire oublier au grand patron que l’intérêt de ce qui le fait courir ne va pas toujours de soi, et, d’autre part, le conforte dans son importance sociale à ses yeux et au regard de ceux qu’il sollicite et qui le sollicitent. La vocation est totale, Rémy Robinet-Duffo dit ne pas faire de politique, « je suis du parti de l’entreprise », cet engagement englobant tous les autres. Un parti qui tenait en quelque sorte ses assises lors du salon des entrepreneurs en janvier 1999. L’esprit combatif et militant a pu alors se manifester sur tous les problèmes de la création et de la transmission d’entreprises. Un militantisme qui ne se réduit pas à la vie active puisque des chefs d’entreprise retraités offraient bénévolement leur aide aux visiteurs tentés par la création de leur propre société. Ainsi, pris au jeu des affaires, profondément légitimés en cela par le rôle positif qu’ils jouent sur le marché de l’emploi, les patrons de la première génération ne sont guère disposés à cesser leur activité pour prendre une retraite bien méritée. Et cela même dans le cas de figure où leur succession paraît solidement assurée.
Une retraite impossible
Jean-Pierre Savare, âgé de soixante et un ans en 1998, reconnaît cette difficulté à envisager cette cessation d’activité. « Si, aujourd’hui, j’étais contraint de quitter mon poste, je pense que je ne ferais pas de vieux os. Parce que je n’ai pas assez de richesse intérieure, à mon avis, pour reconstituer… Peut-être que je me mettrais à écrire, je ne sais pas. » L’entreprise apparaît ainsi comme une passion suffisamment forte pour remplir une vie.
Mais un autre argument est aussi avancé, d’une tout autre nature, qui paraît à lui seul pouvoir justifier, expliquer la réticence des entrepreneurs à cesser leur activité. « Je ne peux en aucune façon me retirer de l’entreprise, explique Jean-Pierre Savare, parce que, dès que je ne suis plus dirigeant, je suis assommé par l’ISF, car ma richesse ne serait plus considérée comme outil de travail [22]. » Ce type de considérations est tout à fait pertinent. Le Conseil des impôts le reconnaît lorsqu’il constate des « comportements indésirables » liés au non-assujettissement des biens professionnels à l’ISF. « Ainsi [cette exonération] conduit-elle les dirigeants à poursuivre leur activité professionnelle au-delà d’un âge qui pourrait être celui de la retraite afin que leurs actifs patrimoniaux continuent de bénéficier de la qualification de biens professionnels et ainsi de l’exonération d’impôts[23]. » Mais la loi de finance de 1999 prévoit qu’à partir de soixante-quinze ans les patrons ne pourront plus faire reconnaître leur patrimoine professionnel comme outil de travail et ce, avec pour objectif officiel de favoriser la transmission.
François Michelin semble en avoir pris acte. En avril 1999, il annonce son intention de proposer la nomination de son fils Édouard, trente-six ans, à la tête de l’entreprise, lors de la prochaine assemblée générale extraordinaire, en juin de la même année. Âgé de soixante-treize ans, il était temps, fiscalement, que le patriarche passe la main.
Le rapport à la cessation d’activité connaît une certaine variation selon les entrepreneurs, mais elle n’est jamais clairement affirmée comme la délivrance tant attendue qu’elle représente pour nombre de salariés. D’où l’ambiguïté de certaines attitudes, comme celle de Francis Reversé qui avoue être lassé des servitudes de la vie de bureau, où il ne se rend plus que deux jours par semaine. Il passe le reste de son temps avec sa femme, dans leur propriété normande. Est-ce une préretraite ? À la question Francis Reversé réagit vivement. « Non, c’est un terme que je n’aime pas. Parce que j’aime travailler, j’aime créer des choses. » Sans doute, une certaine forme d’activité peut peser, surtout lorsqu’elle devient routinière. Mais le travail du chef d’entreprise a quelque chose à voir avec la création. Le goût qu’en ont certains les conduit à ne jamais véritablement cesser de s’adonner à ce qui constitue la raison d’être de leur vie adulte.
Cette volonté très répandue de rester aux affaires aussi longtemps que possible est liée aussi aux gains symboliques que procurent ces positions dominantes. Le pouvoir de l’entreprise est source de grandes satisfactions personnelles. Il en est ainsi du pouvoir sur le temps et l’espace. En voyage, souvent pour leurs affaires, sur d’autres continents, les distances s’effacent, et le temps, nécessaire au commun des mortels pour être en contact avec l’étranger, est aboli. Cette maîtrise du temps et de l’espace, certes partiellement illusoire, fait tout de même partie de ces signes du pouvoir que cumulent ces personnages importants, moins soumis que tous les autres aux vicissitudes de la vie quotidienne.