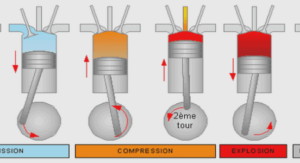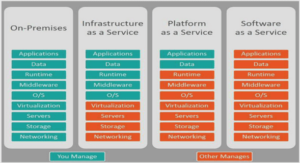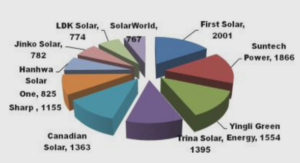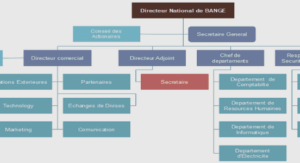Allah n’est pas obligé de Ahmadou Kourouma
Aux enfants de Djibouti : c’est à votre demande que ce livre a été écrit.
Et à mon épouse, pour sa patience.
I. Je décide le titre définitif et complet de mon blablabla est Allah n’est pas obligé d’être juste dans toutes ses choses ici-bas. Voilà. Je commence à conter mes salades.
Et d’abord… et un… M’appelle Birahima. Suis p’tit nègre. Pas parce que suis black et gosse. Non ! Mais suis p’tit nègre parce que je parle mal le français. C’é comme ça. Même si on est grand, même vieux, même arabe, chinois, blanc, russe, même américain ; si on parle mal le français, on dit on parle p’tit nègre, on est p’tit nègre quand même. Ça, c’est la loi du français de tous les jours qui veut ça.
… Et deux… Mon école n’est pas arrivée très loin ; j’ai coupé cours élémentaire deux. J’ai quitté le banc parce que tout le monde a dit que l’école ne vaut plus rien, même pas le pet d’une vieille grand-mère. (C’est comme ça on dit en nègre noir africain indigène quand une chose ne vaut rien. On dit que ça vaut pas le pet d’une vieille grand-mère parce que le pet de la grand-mère foutue et malingre ne fait pas de bruit et ne sent pas très, très mauvais.) L’école ne vaut pas le pet de la grand-mère parce que, même avec la licence de l’université, on n’est pas fichu d’être infirmier ou instituteur dans une des républiques bananières corrompues de l’Afrique francophone. (République bananière signifie apparemment démocratique, en fait régie par des intérêts privés, la corruption.) Mais fréquenter jusqu’à cours élémentaire deux n’est pas forcément autonome et mirifique. On connaît un peu, mais pas assez ; on ressemble à ce que les nègres noirs africains indigènes appellent une galette aux deux faces braisées. On n’est plus villageois, sauvages comme les autres noirs nègres africains indigènes : on entend et comprend les noirs civilisés et les toubabs sauf les Anglais comme les Américains noirs du Liberia. Mais on ignore géographie, grammaire, conjugaisons, divisions et rédaction ; on n’est pas fichu de gagner l’argent facilement comme agent de l’État dans une république foutue et corrompue comme en Guinée, en Côte-d’Ivoire, etc., etc.
… Et trois… suis insolent, incorrect comme barbe d’un bouc et parle comme un salopard. Je dis pas comme les nègres noirs africains indigènes bien cravatés : merde ! Putain ! Salaud ! J’emploie les mots malinkés comme faforo ! (Faforo ! signifie sexe de mon père ou du père ou de ton père.) Comme gnamokodé ! (Gnamokodé ! signifie bâtard ou bâtardise.) Comme Walahé ! (Walahé ! signifie Au nom d’Allah.) Les Malinkés, c’est ma race à moi. C’est la sorte de nègres noirs africains indigènes qui sont nombreux au nord de la Côte-d’Ivoire, en Guinée et dans d’autres républiques bananières et foutues comme Gambie, Sierra Leone et Sénégal là-bas, etc.
… Et quatre… Je veux bien m’excuser de vous parler vis-à-vis comme ça. Parce que je ne suis qu’un enfant.
Suis dix ou douze ans (il y a deux ans grand-mère disait huit et maman dix) et je parle beaucoup. Un enfant poli écoute, ne garde pas la palabre… Il ne cause pas comme un oiseau gendarme dans les branches de figuier. Ça, c’est pour les vieux aux barbes abondantes et blanches, c’est ce que dit le proverbe : le genou ne porte jamais le chapeau quand la tête est sur le cou. C’est ça les coutumes au village. Mais moi depuis longtemps je m’en fous des coutumes du village, entendu que j’ai été au Liberia, que j’ai tué beaucoup de gens avec kalachnikov (ou kalach) et me suis bien camé avec kanif et les autres drogues dures.
… Et cinq… Pour raconter ma vie de merde, de bordel de vie dans un parler approximatif, un français passable, pour ne pas mélanger les pédales dans les gros mots, je possède quatre dictionnaires. Primo le dictionnaire Larousse et le Petit Robert, secundo l’inventaire des particularités lexicales du français en Afrique noire et tertio le dictionnaire Harrap’s. Ces dictionnaires me servent à chercher les gros mots, à vérifier les gros mots et surtout à les expliquer. Il faut expliquer parce que mon blablabla est à lire par toute sorte de gens : des toubabs (toubab signifie blanc) colons, des noirs indigènes sauvages d’Afrique et des francophones de tout gabarit (gabarit signifie genre). Le Larousse et le Petit Robert me permettent de chercher, de vérifier et d’expliquer les gros mots du français de France aux noirs nègres indigènes d’Afrique. L’Inventaire des particularités lexicales du français d’Afrique explique les gros mots africains aux toubabs français de France. Le dictionnaire Harrap’s explique les gros mots pidgin à tout francophone qui ne comprend rien de rien au pidgin.
Comment j’ai pu avoir ces dictionnaires ? Ça, c’est une longue histoire que je n’ai pas envie de raconter maintenant. Maintenant je n’ai pas le temps, je n’ai pas envie de me perdre dans du blabla. Voilà c’est tout. À faforo (cul de mon papa) !
… Et six… C’est vrai, suis pas chic et mignon, suis maudit parce que j’ai fait du mal à ma mère. Chez les nègres noirs africains indigènes, quand tu as fâché ta maman et si elle est morte avec cette colère dans son cœur elle te maudit, tu as la malédiction. Et rien ne marche chez toi et avec toi.
Suis pas chic et mignon parce que suis poursuivi par les gnamas de plusieurs personnes. (Gnama est un gros mot nègre noir africain indigène qu’il faut expliquer aux Français blancs. Il signifie, d’après Inventaire des particularités lexicales du français en Afrique noire, l’ombre qui reste après le décès d’un individu. L’ombre qui devient une force immanente mauvaise qui suit l’auteur de celui qui a tué une personne innocente.) Et moi j’ai tué beaucoup d’innocents au Liberia et en Sierra Leone où j’ai fait la guerre tribale, où j’ai été enfant-soldat, où je me suis bien drogué aux drogues dures. Je suis poursuivi par les gnamas, donc tout se gâte chez moi et avec moi. Gnamokodé (bâtardise) !
Me voilà présenté en six points pas un de plus en chair et en os avec en plume ma façon incorrecte et insolente de parler. (Ce n’est pas en plume qu’il faut dire mais en prime. Il faut expliquer en prime aux nègres noirs africains indigènes qui ne comprennent rien à rien. D’après Larousse, en prime signifie ce qu’on dit en plus, en rab.)
Voilà ce que je suis ; c’est pas un tableau réjouissant.
Maintenant, après m’être présenté, je vais vraiment, vraiment conter ma vie de merde de damné. Asseyez-vous et écoutez-moi. Et écrivez tout et tout. Allah n’est pas obligé d’être juste dans toutes ses choses. Faforo (sexe de mon papa) !
Avant de débarquer au Liberia, j’étais un enfant sans peur ni reproche. Je dormais partout, chapardais tout et partout pour manger. Grand-mère me cherchait des jours et des jours : c’est ce qu’on appelle un enfant de la rue. J’étais un enfant de la rue. Avant d’être un enfant de la rue, j’étais à l’école. Avant ça, j’étais un bilakoro au village de Togobala. (Bilakoro signifie, d’après l’inventaire des particularités lexicales, garçon non circoncis.) Je courais dans les rigoles, j’allais aux champs, je chassais les souris et les oiseaux dans la brousse. Un vrai enfant nègre noir africain broussard. Avant tout ça, j’étais un gosse dans la case avec maman. Le gosse, il courait entre la case de maman et la case de grand-mère. Avant tout ça, j’ai marché à quatre pattes dans la case de maman. Avant de marcher à quatre pattes, j’étais dans le ventre de ma mère. Avant ça, j’étais peut-être dans le vent, peut-être un serpent, peut-être dans l’eau. On est toujours quelque chose comme serpent, arbre, bétail ou homme ou femme avant d’entrer dans le ventre de sa maman. On appelle ça la vie avant la vie. J’ai vécu la vie avant la vie. Gnamokodé (bâtardise) !
La première chose qui est dans mon intérieur… En français correct, on ne dit pas dans l’intérieur, mais dans la tête. La chose que j’ai dans l’intérieur ou dans la tête quand je pense à la case de ma mère, c’est le feu, la brûlure de la braise, un tison de feu. Je sais pas le nombre de mois que j’étais au temps où je me suis braisé l’avant-bras. (Braiser signifie, dans l’inventaire des particularités lexicales, cuire à la braise.) Ma maman n’avait pas compté mon âge et mes mois ; elle n’en avait pas le loisir vu qu’elle souffrait tout le temps, pleurait tout le temps.
J’ai oublié de vous dire quelque chose de fondamental, de très, de formidablement important. Ma maman marchait sur les fesses. Walahé (au nom d’Allah) ! Sur les deux fesses. Elle s’appuyait sur les deux mains et la jambe gauche. La jambe gauche, elle était malingre comme un bâton de berger. La jambe droite, qu’elle appelait sa tête de serpent écrasée, était coupée, handicapée par l’ulcère. L’ulcère, d’après mon dictionnaire Larousse, est une plaie persistante avec écoulement de pus. C’est comme ça on appelle une plaie à la jambe qui ne guérit jamais et qui finit par tuer la malade. L’ulcère de maman était dans des feuilles emmitouflées dans du vieux pagne. (Emmitouflé signifie, d’après Larousse, enveloppé.) La jambe droite était toujours suspendue en l’air. Maman avançait par à-coups, sur les fesses, comme une chenille. (Par à-coups, c’est l’arrêt brusque suivi d’une reprise brutale.) Moi, je marchais à quatre pattes. Je me le rappelle, je peux le conter. Mais je n’aime pas le dire à tout le monde. Parce que c’est un secret ; parce que, quand je le conte, je tremble de douleur comme un peureux par la brûlure de feu dans ma chair. Je courais, tournais à quatre pattes, elle me poursuivait. J’allais plus vite qu’elle. Elle me poursuivait, sa jambe droite en l’air, elle allait sur les fesses, par à-coups, en s’appuyant sur les bras. Je suis allé trop vite, trop loin, je ne voulais pas me faire rattraper. J’ai foncé, j’ai bousculé dans la braise ardente. La braise ardente a fait son travail, elle a grillé mon bras. Elle a grillé le bras d’un pauvre enfant comme moi parce que Allah n’est pas obligé d’être juste dans toutes les choses qu’il fait sur terre. La cicatrice est toujours là sur mon bras ; elle est toujours dans ma tête et dans mon ventre, disent les Africains noirs, et dans mon cœur. Elle est toujours dans mon cœur, dans tout mon être comme les odeurs de ma mère. Les odeurs exécrables de ma mère ont imbibé mon corps. (Exécrable signifie très mauvais et imbibé signifie mouillé, pénétré d’un liquide, d’après Larousse.) Gnamokodé (bâtard) !
Donc, quand j’étais un enfant mignon, au centre de mon enfance, il y avait l’ulcère qui mangeait et pourrissait la jambe droite de ma mère. L’ulcère pilotait ma mère. (Piloter, c’est guider dans un lieu.) L’ulcère pilotait ma mère et nous tous. Et, autour de ma mère et de son ulcère, il y avait le foyer. Le foyer qui m’a braisé le bras.
Le foyer fumait ou tisonnait. (Tisonner, c’est remuer les tisons d’un feu pour l’attiser.) Autour du foyer, des canaris. (Canari signifie, d’après l’inventaire des particularités lexicales, vase en terre cuite de fabrication artisanale.) Encore des canaris, toujours des canaris pleins de décoctions. (Décoction, c’est la solution obtenue par l’action de l’eau bouillante sur des plantes.) Des décoctions pour laver l’ulcère de maman. Au fond de la case, des canaris s’alignaient encore contre le mur. Entre les canaris et le foyer, il y avait ma mère et son ulcère dans la natte. Il y avait moi, il y avait le féticheur, le chasseur et guérisseur Balla aussi. Balla était le guérisseur de ma maman. C’était un type chic, formidable. Ça connaissait trop de pays et de choses. Allah lui avait donné cent autres chances, qualités et possibilités incroyables. C’était un affranchi, c’est comme ça on appelle un ancien esclave libéré, d’après Larousse. C’était un donson ba, c’est comme ça on appelle un maître chasseur qui a déjà tué un fauve noir et un génie malfaisant, d’après Inventaire des particularités lexicales. C’était un cafre, c’est comme ça on appelle un homme qui refuse la religion musulmane et qui est plein de fétiches, d’après Inventaire des particularités lexicales. Il a refusé de brûler ses idoles, donc n’est pas musulman, ne fait pas les cinq prières par jour, ne jeûne pas un mois par an. Le jour de sa mort, aucun musulman ne doit aller à son enterrement et on ne doit pas l’enterrer dans le cimetière musulman. Et personne, strictement (strictement signifie rigoureux, qui ne laisse aucune latitude), strictement personne ne doit manger ce qu’il a égorgé. Balla était le seul Bambara (Bambara signifie celui qui a refusé), le seul cafre du village. Tout le monde le craignait. Il avait le cou, les bras, les cheveux et les poches tout plein de grigris. Aucun villageois ne devait aller chez lui. Mais en réalité tout le monde entrait dans sa case la nuit et même parfois le jour parce qu’il pratiquait la sorcellerie, la médecine traditionnelle, la magie et mille autres pratiques extravagantes (extravagant signifie qui dépasse exagérément la mesure).
Tout ce que je parle et déconne (déconner, c’est faire ou dire des bêtises) et que je bafouillerai, c’est lui qui me l’a enseigné. Il faut toujours remercier l’arbre à karité sous lequel on a ramassé beaucoup de bons fruits pendant la bonne saison. Moi je ne serai jamais ingrat envers Balla. Faforo (sexe de son père) ! Gnamokodé (bâtard) !
La case de ma maman s’ouvrait par deux portes : la grande porte sur la concession de la famille et la petite porte sur l’enclos. À quatre pattes, je roulais partout, m’accrochais à tout. Des fois, je tombais dans l’ulcère. Maman hurlait de douleur. L’ulcère saignait. Maman hurlait comme l’hyène dont les pattes sont coincées dans les dents d’un gros piège à loup. Elle pleurait. Elle avait trop de larmes, toujours des larmes dans le profond du creux des yeux et des sanglots plein la gorge qui toujours l’étouffaient.
« Arrête les larmes, arrête les sanglots, disait grand-mère. C’est Allah qui crée chacun de nous avec sa chance, ses yeux, sa taille et ses peines. Il t’a née avec les douleurs de l’ulcère. Il t’a donné de vivre tout ton séjour sur cette terre dans la natte au fond d’une case près d’un foyer. Il faut redire Allah koubarou ! Allah koubarou ! (Allah est grand.) Allah ne donne pas de fatigues sans raison. Il te fait souffrir sur terre pour te purifier et t’accorder demain le paradis, le bonheur éternel. »
Elle essuyait ses larmes, avalait les sanglots. Nous recommencions nos jeux, nous commencions à nous poursuivre dans la case. Et un autre matin elle arrêtait de jouer et pleurait de douleur et s’étranglait de sanglots.
« Tu devrais au lieu de te plaindre prier Allah koubarou ! Allah koubarou. Tu devrais remercier Allah de sa bonté. Il t’a frappée ici sur terre pour des jours limités de douleurs. Des douleurs mille fois inférieures à celles de l’enfer. Les douleurs de l’enfer que les autres condamnés, mécréants et méchants souffriront pour l’éternité. » Grand-mère disait cela et demandait à ma maman de prier. Ma maman essuyait encore les larmes et priait avec grand-mère.
Quand mon bras a braisé, maman a trop pleuré, a trop gonflé la gorge et la poitrine avec des sanglots. Grand-mère et mon père sont venus tous les deux. Ils se sont fâchés tous les deux, ont réprimandé tous les deux ma mère.
« C’est une autre épreuve d’Allah (épreuve signifie ce qui permet de juger la valeur d’une personne). C’est parce que Allah te réserve un bonheur supplémentaire dans son paradis qu’il te frappe encore sur terre ici d’un malheur complémentaire. »
Ma maman a essuyé les larmes, a avalé les sanglots et a dit des prières avec grand-mère. Et maman et moi avons repris nos jeux.
Balla disait qu’un enfant n’abandonne pas la case de sa maman à cause des odeurs d’un pet. Je n’ai jamais craint les odeurs de ma maman. Il y avait dans la case toutes les puanteurs. Le pet, la merde, le pipi, l’infection de l’ulcère, l’âcre de la fumée. Et les odeurs du guérisseur Balla. Mais moi je ne les sentais pas, ça ne me faisait pas vomir. Toutes les odeurs de ma maman et de Balla avaient du bon pour moi. J’en avais l’habitude. C’est dans ces odeurs que j’ai mieux mangé, mieux dormi. C’est ce qu’on appelle le milieu naturel dans lequel chaque espèce vit ; la case de maman avec ses odeurs a été mon milieu naturel.
C’est dommage qu’on connaît pas ce qu’a été le monde avant la naissance. Des matins, j’essaie d’imaginer ce que maman était avant son excision, comment elle chantait, dansait et marchait avant son excision, quand elle était jeune fille vierge. Grand-mère et Balla m’ont dit qu’elle était jolie comme une gazelle, comme un masque gouro. Moi je l’ai toujours vue ou couchée ou sur les fesses, jamais sur les jambes. Sûr qu’elle était excitante et irrésistible. Parce que après trente ans dans la merde et ses odeurs, les fumées, les douleurs, les larmes, il restait encore quelque chose de merveilleux dans le creux du visage. Quand le creux du visage ne débordait pas de larmes, il s’éclairait d’une lueur. Quelque chose comme une perle perdue, ébréchée (ébréché signifie endommagé sur le bord). Une beauté pourrie comme l’ulcère de sa jambe droite, une lueur qui se voyait plus dans la fumée et les odeurs de la case. Faforo ! Walahé !
Quand maman était jolie, appétissante et vierge, on l’appelait Bafitini. Même complètement foutue et pourrie, Balla et grand-mère continuaient encore à l’appeler Bafitini. Moi qui l’ai toujours vue que dans son état déplorable de dernière décomposition multiforme et multicolore, je l’ai toujours appelée Ma sans autre forme de procès. Simplement Ma, ça venait de mon ventre disent les Africains, de mon cœur disent les Français de France.
Grand-mère dit que Ma est née à Siguiri. C’était un de ces nombreux lieux pourris de Guinée, de Côte-d’Ivoire, de Sierra Leone où des piocheurs et casseurs de cailloux trouvent de l’or. Grand-père était grand trafiquant d’or. Comme tout trafiquant riche, il achetait beaucoup de femmes, de chevaux, de vaches et de grands boubous amidonnés. Les femmes et les vaches ont produit beaucoup d’enfants. Pour loger les femmes, les enfants, les veaux, la famille, le bétail et l’or, il achetait et construisait beaucoup de concessions. Grand -père avait des concessions dans tous les villages de baraquements où des aventuriers marchands d’or se défendaient.
Ma grand-mère était la première femme de grand -père, la mère de ses premiers enfants. C’est pourquoi il l’avait envoyée au village pour gérer la concession familiale. Il ne l’avait pas laissée dans les villages aurifères où il y a beaucoup de voleurs, d’assassins, de menteurs et de vendeurs d’or.
L’autre motif pour quoi grand-mère restait au village c’était pour empêcher que maman meure par arrêt net du cœur et pourrissement définitif de l’ulcère. Maman disait que la douleur allait la tuer sans faute la nuit que grand-mère la quitterait pour aller trouver les égorgeurs de femmes des baraquements des chercheurs d’or où grand-père trafiquait.
Grand-mère aimait beaucoup maman. Mais elle ne connaissait pas sa date de naissance, elle ne connaissait pas non plus le jour de sa naissance dans la semaine. La nuit où elle a accouché de ma mère, elle était trop occupée. Balla m’expliquait que cela n’avait pas d’importance et n’intéressait personne de connaître sa date et son jour de naissance vu que nous sommes tous nés un jour ou un autre et dans un lieu ou un autre et que nous allons tous mourir un jour ou un autre et dans un lieu ou un autre pour être tous enfouis sous le même sable, rejoindre les aïeux et connaître le même jugement suprême d’Allah.
La nuit de la naissance de ma mère, ma grand-mère était trop occupée à cause aussi de mauvais signes apparaissant un peu partout dans l’univers. Cette nuit-là, il y avait trop de mauvais signes dans le ciel et sur la terre, comme les hurlements des hyènes dans la montagne, les cris des hiboux sur les toits des cases. Tout ça pour prédire que la vie de ma mère allait être terriblement et malheureusement malheureuse. Une vie de merde, de souffrance, de damnée, etc.
Balla a dit qu’on a fait des sacrifices mais pas suffisamment assez pour éteindre tout le mauvais destin de ma maman. Les sacrifices, c’est pas forcé que toujours Allah et les mânes des ancêtres les acceptent. Allah fait ce qu’il veut ; il n’est pas obligé d’accéder (accéder signifie donner son accord) à toutes les prières des pauvres humains. Les mânes font ce qu’ils veulent ; ils ne sont pas obligés d’accéder à toutes les chiaderies des prieurs.
Grand-mère m’adorait moi, Birahima, comme un chéri. Elle m’aimait plus que tous ses autres petits-enfants. Chaque fois que quelqu’un lui donnait des morceaux de sucre, des mangues bonnes et douces, de la papaye et du lait, c’était pour moi, pour moi seul : elle ne les consommait jamais. Elle les cachait dans un coin de sa case et me les donnait quand j’y entrais, en sueur, fatigué, assoiffé, affamé comme un vrai mauvais garçon de la rue.
Ma maman, quand elle était jeune, vierge et jolie comme un bijou, elle vivait dans un village où grand-père trafiquait l’or et où il y avait de nombreux vendeurs d’or bandits qui violaient et égorgeaient les jeunes filles non encore excisées. C’est pourquoi elle n’a pas attendu longtemps. Dès le premier harmattan, elle est retournée au village pour participer à l’excision et à l’initiation des jeunes filles qui a lieu une fois par an quand souffle le vent du nord.
Personne dans le village de Togobala ne savait d’avance dans quelle savane aurait lieu l’excision. Dès les premiers chants des coqs, les jeunes filles sortent des cases. Et, à la queue leu leu (queue leu leu signifie à la file l’un après l’autre), elles entrent dans la brousse et marchent en silence. Elles arrivent sur l’aire de l’excision juste au moment où le soleil point. On n’a pas besoin d’être sur l’aire de l’excision pour savoir que, là-bas, on coupe quelque chose aux jeunes filles. On a coupé quelque chose à ma mère, malheureusement son sang n’a pas arrêté de couler. Son sang coulait comme une rivière débordée par l’orage. Toutes ses camarades avaient arrêté de saigner. Donc maman devait mourir sur l’aire de l’excision. C’est comme ça, c’est le prix à payer chaque année à chaque cérémonie d’excision, le génie de la brousse prend une jeune fille parmi les excisées. Le génie la tue, la garde comme sacrifice. Elle est enterrée sur place là-bas dans la brousse, sur l’aire de l’excision. Ce n’est jamais une moche, c’est toujours parmi les plus belles, la plus belle excisée. Ma maman était la plus belle des jeunes filles de sa génération ; c’est pourquoi le génie de la brousse avait choisi de la retenir pour la mort.
La sorcière exciseuse était de la race des Bambaras. Dans notre pays, le Horodougou, il y a deux sortes de races, les Bambaras et les Malinkés. Nous qui sommes des familles Kourouma, Cissoko, Diarra, Konaté, etc., nous sommes des Malinkés, des Dioulas, des musulmans. Les Malinkés sont des étrangers ; ils sont venus de la vallée du Niger depuis longtemps et longtemps. Les Malinkés sont des gens bien qui ont écouté les paroles d’Allah. Ils prient cinq fois par jour ; ils ne boivent pas le vin de palme et ne mangent pas le cochon ni les gibiers égorgés par un cafre féticheur comme Balla. Dans d’autres villages, les habitants sont des Bambaras, des adorateurs, des cafres, des incroyants, des féticheurs, des sauvages, des sorciers. Les Bambaras sont parfois aussi appelés Lobis, Sénoufos, Kabiès, etc. Ils étaient nus avant la colonisation. On les appelait les hommes nus. Les Bambaras sont les vrais autochtones, les vrais anciens propriétaires de la terre. L’exciseuse était de la race bambara. Elle s’appelait Moussokoroni. Et Moussokoroni, en voyant ma maman en train de saigner, en train de mourir, a eu pitié parce que ma maman était alors trop belle. Beaucoup d’adorateurs ne connaissent pas Allah et sont toujours trop méchants mais quelques-uns sont bons. L’exciseuse avait un bon cœur et elle a travaillé. Avec sa sorcellerie, ses adorations, ses prières, elle a pu arracher ma maman au méchant génie meurtrier de la brousse. Le génie a accepté les adorations et les prières de l’exciseuse et ma maman a cessé de saigner. Elle a été sauvée. Grand-père et grand-mère, tout le monde était content au village et tout le monde a voulu récompenser, payer au prix fort l’exciseuse ; elle a refusé. Carrément refusé.
Elle ne voulait pas de l’argent, du bétail, de la cola, du mil, du vin, des habits ou des cauris (cauri signifie coquillage originaire de l’océan Indien qui a joué et joue encore un rôle important dans la vie traditionnelle et sert notamment de monnaie d’échange). Parce qu’elle trouvait que ma maman était trop belle ; elle voulait la marier à son fils.
Son fils était un chasseur, un cafre, un sorcier, un adorateur, un féticheur, un cafre auquel on ne doit jamais donner en mariage une musulmane pieuse qui lisait le Coran comme maman. Tout le monde au village a dit non.
On a marié maman avec mon père. Parce que mon père, il était le cousin de maman ; parce qu’il était le fils de l’imam du village. Alors l’exciseuse sorcière et son fils également magicien se sont tous les deux très fâchés, trop fâchés. Ils ont lancé contre la jambe droite de ma maman un mauvais sort, un koroté (signifie, d’après l’inventaire des particularités lexicales, poison opérant à distance sur la personne visée), un djibo (signifie fétiche à influence maléfique) trop fort, trop puissant.
Quand maman s’est mariée, a commencé à conserver sa première grossesse, un point noir, un tout petit point noir, a germé sur sa jambe droite. Le point noir a commencé à faire mal. On l’a percé. Il a ouvert une petite plaie ; on a soigné la petite plaie ; elle n’a pas guéri. Mais a commencé à bouffer le pied, à bouffer le mollet.
Sans perdre de temps, on est entré chez Balla, on est allé chez les magiciens, les voyants, les marabouts ; tous ont dit que c’est l’exciseuse et son fils qui ont jeté le mauvais sort. On est allé dans le village de l’exciseuse et de son fils. C’était trop tard.
Entre-temps, l’exciseuse était morte, bien morte de vieillesse et même bien enterrée. Son fils le chasseur, il était mauvais ; il ne voulait rien entendre, rien comprendre, rien accepter. Il était vraiment méchant comme un vrai adorateur, un ennemi d’Allah.
Maman a accouché de ma grande sœur. Quand ma grande sœur a marché et a commencé à faire des courses et comme la plaie continuait à pourrir, on a transporté maman à l’hôpital du cercle. C’était avant l’indépendance. Dans l’hôpital, il y avait un docteur blanc, un toubab avec trois galons sur les épaules, un médecin africain qui n’avait pas de galon, un infirmier major, une sage-femme et beaucoup d’autres noirs qui portaient tous des blouses blanches. Tous les noirs avec des blouses blanches étaient des fonctionnaires payés par le gouverneur de la colonie. Mais, pour qu’un fonctionnaire soit bon pour le malade, le malade apportait un poulet au fonctionnaire. Ç’a toujours été les coutumes en Afrique. Maman a donné des poulets à cinq fonctionnaires. Tous ont été bons pour maman, tous ont bien soigné maman. Mais la plaie de maman avec la bande et le permanganate, au lieu de guérir, a continué à beaucoup saigner et trop pourrir. Le médecin capitaine dit qu’il va opérer la jambe de maman, couper au genou et jeter tout le pourri aux chiens des décharges. Heureusement l’infirmier major à qui maman avait donné un poulet est venu dans la nuit prévenir maman.
Il lui a dit que sa maladie n’est pas une maladie pour blanc, c’est une maladie pour Africain noir nègre et sauvage. C’est une maladie que la médecine, la science du blanc ne peuvent guérir. « C’est la sorcellerie du guérisseur africain qui peut fermer ta plaie. Si le capitaine opère ta jambe, tu vas mourir, complètement mourir, totalement mourir comme un chien », a dit l’infirmier major. L’infirmier était musulman et ne pouvait pas mentir.
Grand-père a payé un ânier. Dans la nuit, au clair de lune, l’ânier et le guérisseur Balla sont allés à l’hôpital et ont comme des brigands enlevé maman. Ils l’ont amenée avant le lever du jour loin dans la brousse, ils l’ont cachée sous un arbre dans une forêt touffue. Le capitaine s’est fâché, est venu en tenue militaire avec ses galons et des gardes cercle au village. Ils ont cherché maman dans toutes les cases du village. Ils ne l’ont pas trouvée, vu que personne au village ne savait où on l’avait cachée dans la brousse.