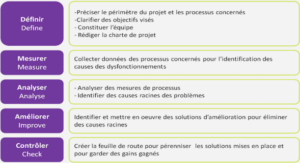Préface à l’édition allemande de 1890
Depuis que j’ai écrit les lignes qui précèdent, une nouvelle édition allemande du Manifeste est devenue nécessaire. Il convient en outre de mentionner ici qu’il s’est produit bien des choses autour du Manifeste.
Une deuxième traduction russe, par Véra Zassoulitch, pa-rut à Genève en 1882 ; nous en rédigeâmes, Marx et moi, la pré-face. Malheureusement, j’ai égaré le manuscrit allemand origi-nal et je suis obligé de retraduire du russe, ce qui n’est d’aucun profit pour le texte même. Voici cette préface : « La première édition russe du Manifeste du Parti com-muniste, traduit par Bakounine, parut peu après 1860 à l’imprimerie du Kolokol. À cette époque, une édition russe de cet ouvrage avait tout au plus pour l’Occident l’importance d’une curiosité littéraire. Aujourd’hui, il n’en va plus de même.
Combien était étroit le terrain où se propageait le mou-vement prolétarien à cette époque (décembre 1847), c’est ce qui ressort parfaitement du dernier chapitre : « Position des com-munistes envers les différents partis d’opposition dans les di-vers pays. » La Russie et les États-unis notamment n’y sont pas mentionnés. C’était le temps où la Russie formait la dernière grande réserve de la réaction européenne, et où l’émigration aux États-unis absorbait l’excédent des forces du prolétariat européen. Ces deux pays fournissaient à l’Europe des matières premières et lui offraient en même temps des débouchés pour l’écoulement de ses produits industriels. Tous deux servaient donc, de l’une ou l’autre manière, de contrefort à l’organisation sociale de l’Europe.
Que tout cela est changé aujourd’hui ! C’est précisément l’émigration européenne qui a rendu possible le développement colossal de l’agriculture en Amérique du Nord, développement dont la concurrence ébranle dans ses fondements la grande et la petite propriété foncière en Europe. C’est elle qui a, du même coup, donné aux États-unis la possibilité de mettre en exploita-tion ses énormes ressources industrielles, et cela avec une énergie et à une échelle telles que le monopole industriel de l’Europe occidentale, et notamment celui de l’Angleterre, dis-paraîtra à bref délai. Ces deux circonstances réagissent à leur tour de façon révolutionnaire sur l’Amérique elle-même. La petite et la moyenne propriété des farmers, cette assise de tout l’ordre politique américain, succombe peu à peu sous la concurrence de fermes gigantesques, tandis que, dans les dis-tricts industriels, il se constitue pour la première fois un nom-breux prolétariat à côté d’une fabuleuse concentration du Capi-tal.
Passons à la Russie. Au moment de la révolution de 1848-1849, les monarques d’Europe, tout comme la bourgeoisie d’Europe, voyaient dans l’intervention russe le seul moyen de les sauver du prolétariat qui commençait tout juste à prendre conscience de sa force. Le tsar fut proclamé chef de la réaction européenne. Aujourd’hui, il est, à Gatchina, le prisonnier de guerre de la révolution, et la Russie est à l’avant-garde du mouvement révolutionnaire de l’Europe.
Le Manifeste communiste avait pour tâche de proclamer la disparition inévitable et prochaine de la propriété bour-geoise. Mais en Russie, à côté de la spéculation capitaliste qui se développe fiévreusement et de la propriété foncière bour-geoise en voie de formation, plus de la moitié du sol est la pro-priété commune des paysans. Il s’agit, dès lors, de savoir si la communauté paysanne russe, cette forme déjà décomposée de l’antique propriété commune du sol, passera directement à la forme communiste supérieure de la propriété foncière, ou bien si elle doit suivre d’abord le même processus de dissolution qu’elle a subi au cours du développement historique de l’Oc-cident.
La seule réponse qu’on puisse faire aujourd’hui à cette question est la suivante : si la révolution russe donne le signal d’une révolution ouvrière en Occident, et que toutes deux se complètent, la propriété commune actuelle de la Russie pourra servir de point de départ à une évolution communiste. »
Une nouvelle traduction polonaise parut, à la même épo-que, à Genève : Manifest Kommunistyczny.
Depuis, une nouvelle traduction danoise a paru dans la So-cialdemokratisk Bibliothek, Copenhague, 1885. Elle n’est mal-heureusement pas tout à fait complète ; quelques passages es-sentiels, qui semblent avoir arrêté le traducteur, ont été omis, et çà et là, on peut relever des traces de négligences, dont l’effet est d’autant plus regrettable qu’on voit, d’après le reste, que la tra-duction aurait pu, avec un peu plus de soin, être excellente.
En 1886 parut une nouvelle traduction française dans Le Socialiste de Paris ; c’est jusqu’ici la meilleure.
D’après cette traduction a paru la même année une version espagnole, d’abord dans El Socialista de Madrid, et ensuite en brochure : Manifesto del Partido Communista, por Carlos Marx y F. Engels, Madrid, Administracion de « El Socialista », Her-man Cortès, 8.
À titre de curiosité, je dirai qu’en 1887 le manuscrit d’une traduction arménienne a été offert à un éditeur de Constantinople ; l’excellent homme n’eut cependant pas le courage d’imprimer une brochure qui portait le nom de Marx et estima que le traducteur devrait bien plutôt s’en déclarer l’auteur, ce que celui-ci refusa de faire.
À plusieurs reprises ont été réimprimées en Angleterre cer-taines traductions américaines plus ou moins inexactes ; enfin, une traduction authentique a paru en 1888. Elle est due à mon ami Samuel Moore, et nous l’avons revue ensemble avant l’impression. Elle a pour titre : Manifesto of the Communist Party, by Karl Marx and Frederick Engels, Authorized English translation, edited and annotated by Frederick Engels, 1888. London, William Reeves, 185 Fleet st., E.C. J’ai repris dans la présente édition quelques-unes des notes de cette traduction anglaise.
Le Manifeste a eu sa destinée propre. Salué avec enthou-siasme, au moment de son apparition, par l’avant-garde peu nombreuse encore du socialisme scientifique (comme le prou-vent les traductions signalées dans la première préface), il fut bientôt refoulé à l’arrière-plan par la réaction qui suivit la dé-faite des ouvriers parisiens en juin 1848, et enfin il fut proscrit « de par la loi » avec la condamnation des communistes de Co-logne en novembre 185214. Avec le mouvement ouvrier datant de la révolution de Février, le Manifeste aussi disparaissait de la scène publique.
Lorsque la classe ouvrière européenne eut repris suffi-samment de forces pour un nouvel assaut contre la puissance des classes dominantes, naquit l’Association internationale des travailleurs. Elle avait pour but de fondre en une immense armée unique toute la classe ouvrière d’Europe et d’Amérique ca-pable d’entrer dans la lutte. Elle ne pouvait donc partir directe-ment des principes posés dans le Manifeste. Il lui fallait un pro-gramme qui ne fermât pas la porte aux trade-unions anglaises, aux proudhoniens français, belges, italiens et espagnols, ni aux lassalliens allemands15 – Ce programme – le préambule des Statuts de l’Internationale16 – fut rédigé par Marx avec une maîtrise à laquelle Bakounine et les anarchistes eux-mêmes ont rendu hommage. Pour la victoire définitive des propositions énoncées dans le Manifeste, Marx s’en remettait uniquement au développement intellectuel de la classe ouvrière, qui devait ré-sulter de l’action et de la discussion communes. Les événements et les vicissitudes de la lutte contre le Capital, les défaites plus encore que les succès, ne pouvaient manquer de faire sentir aux combattants l’insuffisance de toutes leurs panacées et les ame-ner à comprendre à fond les conditions véritables de l’émancipation ouvrière. Et Marx avait raison. La classe ou-vrière de 1874, après la dissolution de l’Internationale, était tout autre que celle de 1864, au moment de sa fondation. Le proud-honisme des pays latins et le lassallisme proprement dit en Al-lemagne étaient à l’agonie, et même les trade-unions anglaises, alors ultra-conservatrices, approchaient peu à peu du moment où, en 1887, le président de leur congrès à Swansea pouvait dire en leur nom : « Le socialisme continental a cessé d’être pour nous un épouvantail. » Mais dès 1887, le socialisme continental s’identifiait presque entièrement avec la théorie formulée dans le Manifeste. Et ainsi l’histoire du Manifeste reflète jusqu’à un certain point l’histoire du mouvement ouvrier moderne depuis 1848. À l’heure actuelle, il est incontestablement l’œuvre la plus répandue, la plus internationale de toute la littérature socialiste, le programme commun de millions d’ouvriers de tous les pays, de la Sibérie à la Californie.
Et, cependant, lorsqu’il parut, nous n’aurions pu l’intituler Manifeste socialiste. En 1847, on comprenait sous ce nom de socialiste deux sortes de gens. D’abord, les adhérents des divers systèmes utopiques, notamment les owenistes en Angleterre et les fouriéristes en France, qui n’étaient déjà plus, les uns et les autres, que de simples sectes agonisantes. D’un autre côté, les charlatans sociaux de tout acabit qui voulaient, à l’aide d’un tas de panacées et avec toutes sortes de rapiéçages, supprimer les misères sociales, sans faire le moindre tort au Capital et au pro-fit. Dans les deux cas, c’étaient des gens qui vivaient en dehors du mouvement ouvrier et qui cherchaient plutôt un appui au-près des classes « cultivées ». Au contraire, cette partie des ou-vriers qui, convaincue de l’insuffisance des simples bouleverse-ments politiques, réclamait une transformation fondamentale de la société, s’appelait alors communiste. C’était un commu-nisme à peine dégrossi purement instinctif, parfois un peu gros-sier ; mais il était assez puissant pour donner naissance à deux systèmes de communisme utopique : en France l’Icarie de Cabet et en Allemagne le système de Weitling. En 1847, le socialisme signifiait un mouvement bourgeois, le communisme, un mou-vement ouvrier. Le socialisme avait, sur le continent tout au moins, ses entrées dans le monde ; pour le communisme, c’était exactement le contraire. Et comme, dès ce moment, nous étions très nettement d’avis que « l’émancipation des travailleurs doit être l’œuvre des travailleurs eux-mêmes », nous ne pouvions hésiter un instant sur la dénomination à choisir. Depuis, il ne nous est jamais venu à l’esprit de la rejeter.
« Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! » Quelques voix seulement nous répondirent, lorsque nous lançâmes cet appel par le monde, il y a maintenant quarante-deux ans, à la veille de la première révolution parisienne dans laquelle le pro-létariat se présenta avec ses revendications à lui. Mais le 28 sep-tembre 1864, des prolétaires de la plupart des pays de l’Europe occidentale s’unissaient pour former l’Association internatio-nale des travailleurs, de glorieuse mémoire. L’Internationale elle-même ne vécut d’ailleurs que neuf années. Mais que l’alliance éternelle établie par elle entre les prolétaires de tous les pays existe encore et qu’elle soit plus puissante que jamais, il n’en est pas de meilleure preuve que la journée d’aujourd’hui. Au moment où j’écris ces lignes, le prolétariat d’Europe et d’Amérique passe la revue de ses forces, pour la première fois mobilisées en une seule armée, sous un même drapeau et pour un même but immédiat : la fixation légale de la journée normale de huit heures, proclamée dès 1866 par le Congrès de l’Internationale à Genève, et de nouveau par le Congrès ouvrier de Paris en 1889. Le spectacle de cette journée montrera aux capitalistes et aux propriétaires fonciers de tous les pays que les prolétaires de tous les pays sont effectivement unis.