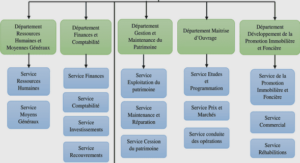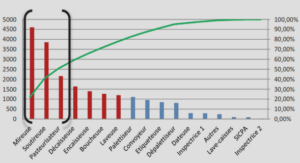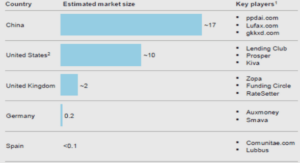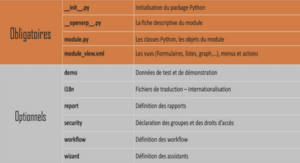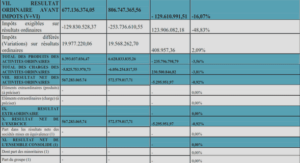Les légitimités égarées
Au moment où j’écris ces lignes, une image me vient à l’esprit, à la fois triviale et inoubliable : celle d’un bureau de vote, en Floride, lors de l’élection présidentielle de novembre 2000. Un scrutateur examine un bulletin à contre-jour pour déterminer, en fonction des pointillés et des torsions de la feuille, à quel candidat doit aller la voix, Al Gore ou George W. Bush.
Comme des millions de personnes à travers le monde, j’étais suspendu à ce dépouillement, ainsi qu’à la querelle juridique qui l’accompagnait. Un peu, certes, par une curiosité de spectateur devant un feuilleton politique palpitant ; mais surtout parce que, dans ces élections, c’est mon avenir et celui des miens qui étaient en jeu. A l’époque je le pressentais un peu, aujourd’hui je le sais avec certitude, ce vote en Floride allait changer le cours de l’Histoire dans mon propre pays natal, le Liban.
J’ai cité cet exemple en premier, spontanément, parce qu’il me concerne de près ; j’aurais pu commencer par tant d’autres, plus amples, et dont les implications pour l’ensemble de la planète paraissent plus évidentes. Ainsi, il est raisonnable de supposer que les attentats du 11 septembre 2001 auraient eu lieu de la même manière si Al Gore s’était installé à la Maison-Blanche plutôt que George W. Bush ; mais il est tout aussi raisonnable de supposer que la réaction de Washington n’aurait pas été identique. On aurait forcément mené une « guerre contre la terreur » ; avec, toutefois, d’autres priorités, d’autres slogans, d’autres méthodes, d’autres coalitions. Il y aurait probablement eu moins de détermination, mais aussi moins de dérapages ; le président n’aurait parlé ni de « croisade » ni d’un « axe du Mal », et l’on se serait abstenu de parquer les détenus à Guantanamo. La guerre d’Irak n’aurait probablement pas eu lieu, ce qui aurait changé bien des choses pour les populations qui s’y sont trouvées embourbées, ainsi que pour les relations des Etats-Unis avec le reste du monde. S’agissant du Liban, il est probable que l’armée syrienne n’aurait pas été contrainte à l’évacuer en 2005, et que les affrontements dont il a été le théâtre auraient pris une autre tournure.
On peut également supposer que si les Démocrates avaient gagné en novembre 2000, plusieurs autres dossiers importants – le réchauffement climatique, par exemple ; ou le droit de pratiquer certaines recherches en génétique ; ou le rôle des Nations unies – auraient été gérés différemment, avec des conséquences significatives pour l’avenir de la planète. Il serait néanmoins hasardeux d’aller plus loin dans les conjectures. Et superflu de vouloir déterminer si l’état du monde en aurait été amélioré ou détérioré. Pour ma part, au fil des années, j’ai médité à diverses occasions sur ce fameux vote de la Floride, le jugeant souvent calamiteux, mais quelquefois providentiel.
Une chose est certaine, en tout cas : ce sur quoi les électeurs de Tampa et de Miami s’étaient prononcés en cette année au chiffre symbolique, ce n’était pas seulement l’avenir de la nation américaine ; c’était aussi, pour une large part, l’avenir de toutes les autres nations.
On pourrait dire la même chose des deux élections présidentielles suivantes, au cours desquelles on a connu des situations extrêmes. En 2004, le monde entier souhaitait que le président Bush soit battu, mais ses concitoyens décidèrent de le réélire ; le désamour entre l’Amérique et le reste de la planète fut alors à son paroxysme. A l’inverse, en 2008, toutes les nations de la Terre s’étaient éprises du sénateur Obama, et lorsque les voix des Américains se portèrent sur lui, ce fut un torrent d’admiration – parfaitement justifié, à mes yeux – pour les Etats-Unis, leur peuple, leur système politique, et leur capacité à gérer leur diversité ethnique. Cette convergence, liée à la fois au discours d’Obama, à ses origines africaines, et à la lassitude du monde envers l’administration républicaine, ne se répétera pas de sitôt ; en revanche, il y a fort à parier que, désormais, chaque élection américaine sera l’occasion d’un psychodrame planétaire.
Ce qui, à l’évidence, pose problème. Il me semble même qu’il y a là, sous des apparences anodines, anecdotiques, l’un des facteurs souterrains de ce « dérèglement » politique et moral qui caractérise notre époque.
Avant d’aller plus loin, il me faut prendre en compte deux objections que mes propos pourraient susciter.
Certes, me dira-t-on, le président des Etats-Unis est aujourd’hui puissant ; ses décisions politiques affectent le sort de la planète entière ; et, de ce fait, ceux qui l’élisent se trouvent investis d’un rôle qui ne leur revient pas de droit, puisque le choix qu’ils font se révèle souvent déterminant pour l’avenir des Asiatiques, des Européens, des Africains et des Latino-Américains. Dans un monde idéal, les choses ne devraient pas se passer ainsi. Mais à quoi bon s’échiner contre un problème qui n’a aucune solution ? On ne va tout de même pas accorder aux Colombiens, aux Ukrainiens, aux Chinois ou aux Irakiens le droit de voter à l’élection présidentielle américaine !
Non, j’en conviens, ce serait absurde ; et ce n’est certainement pas ce que je préconiserais. Quelle autre solution, alors ? Aucune. A cet instant, je n’en vois aucune. Mais le fait qu’il n’y ait pas de solution réaliste ne veut pas dire que le problème n’existe pas. Je suis persuadé que celui-ci est tout à fait réel ; que sa gravité sera de plus en plus apparente dans les prochaines décennies ; et qu’il a, dès à présent, quelques effets dévastateurs.
Je me promets d’expliciter les raisons de cette inquiétude dans la suite de mon propos. Auparavant, j’aimerais écarter une autre objection prévisible. La première était celle de l’éternel « A quoi bon ? » ; la seconde relève du non moins éternel « Il en a toujours été ainsi ! »
Depuis l’aube de l’Histoire, me dira-t-on, certaines nations imposent leur volonté à d’autres ; les puissants décident, les opprimés subissent ; cela fait des générations que la voix d’un habitant de New York, de Paris ou de Londres pèse plus lourd que celle d’un électeur de Beyrouth, de La Paz, de Lomé ou de Kampala ; si l’époque actuelle a apporté des changements, c’est plutôt dans le sens d’une amélioration, puisque des centaines de millions de personnes peuvent désormais s’exprimer librement alors qu’elles étaient jusqu’ici bâillonnées.
Tout cela est vrai, et cependant trompeur. Sans doute les empires d’autrefois étaient-ils vastes et puissants. Mais leur emprise sur le monde demeurait faible ; parce que leur armement et leurs moyens de communication ne leur permettaient pas d’assurer un contrôle effectif loin de leur métropole ; et aussi parce qu’ils devaient toujours compter avec des puissances rivales. Aujourd’hui, l’extraordinaire essor technologique a rendu possible un contrôle bien plus serré du territoire mondial ; et il a contribué à concentrer le pouvoir politique dans un petit nombre de capitales – et même, principalement, dans une seule. Ce qui explique l’émergence, pour la première fois dans l’Histoire, d’un gouvernement dont la « juridiction » couvre la planète entière. Cette situation inédite génère naturellement des disparités tout aussi inédites, ainsi que des équilibres nouveaux – ou plus exactement des déséquilibres. Et des ressentiments suicidaires.
A l’évidence, quelque chose a radicalement changé dans la texture du monde, qui a profondément vicié les rapports entre les hommes, dégradé la signification de la démocratie, et brouillé les chemins du progrès.
Pour examiner de plus près cette altération, pour tenter d’en comprendre les origines et les mécanismes, pour chercher à tâtons une sortie hors de ce labyrinthe meurtrier, la notion qui pourrait servir de « lanterne » est celle de légitimité. Une notion désuète, oubliée, et peut-être même passablement suspecte aux yeux de certains de nos contemporains, mais indispensable dès lors que se pose la question du pouvoir.
La légitimité, c’est ce qui permet aux peuples et aux individus d’accepter, sans contrainte excessive, l’autorité d’une institution, personnifiée par des hommes et considérée comme porteuse de valeurs partagées.
C’est là une définition ample, susceptible d’englober des réalités très différentes : les relations d’un fils avec ses parents, d’un militant avec les responsables de son parti ou de son syndicat, d’un citoyen avec son gouvernement, d’un salarié ou d’un actionnaire avec les dirigeants de son entreprise, d’un étudiant avec ses maîtres, d’un croyant avec les chefs de sa communauté religieuse, etc. Certaines légitimités sont plus stables que d’autres, mais aucune n’est immuable ; on peut gagner en légitimité, ou perdre, selon son habileté, ou selon les circonstances.
On pourrait même raconter l’histoire de toutes les sociétés humaines au rythme des crises de légitimité. Au lendemain d’un bouleversement, une autre légitimité émerge, qui se substitue à celle qui vient de s’écrouler. Mais la persistance de cette légitimité nouvelle dépend de ses succès. Si elle déçoit, elle commence à s’étioler, plus ou moins vite, et sans que ceux qui s’en réclament s’en rendent toujours compte.
A quel moment, par exemple, les tsars ont-ils cessé de paraître légitimes ? Et combien de décennies a-t-il fallu pour que le crédit de la révolution d’Octobre s’épuise à son tour ? La Russie a été, sous les yeux de nos contemporains, le théâtre d’une spectaculaire perte de légitimité qui a eu des répercussions sur l’ensemble de la planète. Mais ce n’est là qu’un cas parmi tant d’autres ! La légitimité n’est immuable qu’en apparence ; que ce soit celle d’un homme, d’une dynastie, d’une révolution ou d’un mouvement national, il arrive un moment où elle n’opère plus. C’est alors qu’un pouvoir remplace l’autre, et qu’une légitimité neuve se substitue à celle qui s’était déconsidérée. Pour que le monde fonctionne de manière à peu près harmonieuse, sans perturbations majeures, la plupart des peuples devraient avoir à leur tête des dirigeants légitimes ; lesquels seraient « chapeautés », puisqu’il le faut, par une autorité mondiale également perçue comme légitime.
A l’évidence, ce n’est pas le cas de nos jours. Et c’est même quasiment l’inverse : beaucoup de nos contemporains vivent dans des Etats dont les gouvernants ne sont ni les gagnants d’un scrutin honnête, ni les héritiers d’une dynastie respectée, ni les continuateurs d’une révolution réussie, ni les artisans d’un miracle économique, et ne disposent, de ce fait, d’aucune légitimité ; et sous la tutelle d’une puissance globale à laquelle les populations ne reconnaissent aucune légitimité non plus. Cette constatation est particulièrement vraie pour la grande majorité des pays arabes. Est-ce un hasard si c’est de là que sont issus les hommes qui commettent, en ce début de siècle, les actes de violence les plus spectaculaires ?
Les questions de légitimité ont toujours joué un rôle majeur dans l’histoire du monde musulman. L’exemple le plus significatif est peut-être celui des factions religieuses. Alors que dans la chrétienté on s’est constamment divisé, et quelquefois massacré, autour de la nature du Christ, de la Trinité, de l’Immaculée Conception ou de la formulation des prières, les conflits dans l’Islam ont habituellement tourné autour des querelles de succession.
Le grand schisme entre sunnites et chiites ne s’est pas fait pour des raisons théologiques mais pour des raisons dynastiques. A la mort du Prophète, une partie des fidèles s’était prononcée pour son jeune cousin Ali, qui était aussi son gendre, un esprit brillant qui avait beaucoup de partisans inconditionnels, lesquels furent appelés « chi’a-t-Ali », le parti d’Ali, puis tout simplement « chi’a ». Mais l’homme avait également beaucoup de détracteurs, qui réussirent par trois fois à faire désigner comme « califes », ou « successeurs », des représentants du parti adverse. Ali finit par remporter la quatrième élection, mais ses ennemis se révoltèrent aussitôt et il ne put jamais régner paisiblement. Il fut assassiné au bout de quatre ans et demi ; puis son fils Hussein fut tué à la bataille de Karbala en 680, drame toujours commémoré avec une immense ferveur par les chiites. Beaucoup d’entre eux espèrent qu’un jour prochain réapparaîtra parmi les hommes un descendant d’Ali, un imam aujourd’hui caché à nos regards, et qui redonnera le pouvoir à ses détenteurs légitimes – un messianisme puissant que le passage des siècles n’a pas terni.
Sur cette querelle dynastique se sont greffées, comme ce fut d’ailleurs le cas pour les querelles théologiques des chrétiens, des considérations d’un autre ordre. Lorsque Rome jadis condamnait comme hérétiques les croyances d’un patriarche d’Alexandrie ou de Constantinople, lorsque Henri VIII d’Angleterre rompait avec l’Eglise romaine, ou qu’un prince allemand prenait parti pour Luther, il y avait souvent des considérations politiques, et même des rivalités commerciales, conscientes ou pas, qui jouaient un rôle souterrain. De la même manière, les thèses du chiisme ont parfois été adoptées par des populations qui voulaient marquer leur opposition au pouvoir du moment. A titre d’exemple, c’est au XVIe siècle, lorsque l’Empire ottoman, implacablement sunnite, connaissait sa plus grande expansion, et qu’il prétendait réunir l’ensemble des musulmans sous son autorité, que le shah de Perse avait transformé son royaume en bastion du chiisme ; c’était pour le monarque une manière de préserver son empire, et pour ses sujets de langue persane un moyen d’éviter de vivre sous la domination d’un peuple de langue turque. Mais alors que le roi d’Angleterre manifestait son indépendance en parlant de l’Eucharistie ou du Purgatoire, le shah marquait sa différence en affirmant son attachement à la famille du Prophète, détentrice de la légitimité.
De nos jours, la légitimité généalogique garde une certaine importance ; mais une autre légitimité est venue s’y ajouter, et quelquefois s’y substituer, que l’on pourrait appeler « patriotique », ou « combattante » : est légitime aux yeux des musulmans celui qui dirige le combat contre leurs ennemis. Un peu comme ce fut le cas pour le général de Gaulle en juin 1940, lorsqu’il avait parlé au nom de la France, non parce qu’il avait été élu, ni parce qu’il détenait le pouvoir effectif, mais parce qu’il portait le flambeau de la lutte contre l’occupant.
Cette comparaison est forcément approximative ; elle représente néanmoins une clef utile, me semble-t-il, pour qui souhaite décoder ce qui arrive dans le monde arabo-musulman depuis quelques décennies ; sans doute même depuis bien plus longtemps, mais je préfère m’attacher à ce qu’a pu noter un homme de mon âge, né au Liban dans une famille d’enseignants et de journalistes puis émigré en France, et qui ne s’est jamais lassé d’observer sa région natale en s’efforçant de comprendre et d’expliquer.
Depuis que j’ai ouvert les yeux sur le monde, j’ai vu défiler divers personnages qui s’estimaient détenteurs de cette « légitimité patriotique », qui parlaient au nom de leur peuple, ou de tous les Arabes, et parfois même au nom de l’ensemble des musulmans. Le plus important de tous fut sans conteste Gamal Abdel Nasser, qui gouverna l’Egypte entre 1952 et 1970, date de sa mort. Je parlerai longuement de lui, parce qu’il me semble que c’est de lui – de son ascension fulgurante, de son échec tout aussi fulgurant, puis de sa brusque disparition – que date la crise de légitimité que vivent aujourd’hui les Arabes, crise qui contribue au dérèglement du monde comme à cette dérive vers la violence incontrôlée et vers la régression.
Mais avant de m’attarder sur le parcours de Nasser, j’aimerais tenter de cerner un peu mieux cette notion de « légitimité patriotique ». A travers un cas particulier, très particulier, et peut-être même unique dans l’histoire moderne du monde musulman, celui d’un dirigeant qui a pu conduire son peuple hors de la débâcle, qui a mérité de ce fait sa légitimité combattante, et qui a remarquablement montré la force d’un tel atout et comment on pouvait s’en servir. Je veux parler d’Atatürk.
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, alors que le territoire de l’actuelle Turquie était partagé entre les différentes armées alliées, et que les puissances réunies à Versailles ou à Sèvres disposaient sans états d’âme des peuples et des terres, cet officier de l’armée ottomane avait osé dire non aux vainqueurs. Quand tant d’autres se lamentaient des décisions iniques qui les frappaient, Kemal Pacha avait pris les armes, chassé les troupes étrangères qui occupaient son pays, et imposé aux puissances de réviser leurs projets.
Cette conduite rare – je veux dire à la fois l’audace de résister à des adversaires réputés invincibles, et la capacité de sortir gagnant de ce bras de fer – valut à l’homme sa légitimité. Devenu, du jour au lendemain, « père de la nation », l’ancien officier avait désormais un mandat de longue durée pour remodeler à sa guise la Turquie et les Turcs. Ce qu’il entreprit avec vigueur. Il mit fin à la dynastie ottomane, abolit le califat, proclama la séparation de la religion et de l’Etat, instaura une laïcité rigoureuse, exigea de son peuple qu’il s’européanise, remplaça l’alphabet arabe par l’alphabet latin, obligea les hommes à se raser et les femmes à ôter leurs voiles, échangea lui-même son couvre-chef traditionnel contre un élégant chapeau à l’occidentale.
Et son peuple le suivit. Il le laissa bousculer les habitudes et les croyances, sans trop rechigner. Pourquoi ? Parce qu’il lui avait rendu sa fierté. Celui qui restitue au peuple sa dignité peut lui faire accepter bien des choses. Il peut lui imposer des sacrifi ces, des restrictions, et il peut même se montrer tyrannique ; il sera quand même écouté, défendu, obéi ; non pas indéfiniment, mais longtemps. Même s’il s’en prend à la religion, ses concitoyens ne l’abandonneront pas pour autant. En politique, la religion n’est pas un but en soi, c’est une considération parmi d’autres ; la légitimité n’est pas accordée au plus croyant, mais à celui dont le combat rejoint le combat du peuple.
Peu de gens en Orient ont vu une quelconque contradiction dans le fait qu’Atatürk se soit battu avec acharnement contre les Européens alors que son rêve était d’européaniser la Turquie. Il ne se battait pas contre ceux-ci ou ceux-là, il se battait pour être traité avec respect, comme un égal, comme un homme, non comme un indigène ; dès lors que leur dignité était rétablie, Kemal et son peuple étaient prêts à aller très loin sur le chemin de la modernité.
La légitimité acquise par Atatürk lui survécut, et aujourd’hui encore la Turquie est gouvernée en son nom. Même ceux qui ne partagent pas ses convictions se sentent contraints de lui manifester une certaine allégeance. On peut se demander néanmoins combien de temps l’édifice tiendra face au radicalisme religieux qui monte, et alors que l’Europe s’apeure. Comment les kémalistes pourraient-ils convaincre leur peuple de s’européaniser si les Européens lui répètent trois fois par jour qu’il n’est pas européen et qu’il n’a rien à faire parmi eux ?
Bien des dirigeants du monde musulman rêvèrent d’imiter l’exemple de la Turquie.
En Afghanistan, un jeune roi de 26 ans, Amanullah, accéda au pouvoir en 1919, et voulut suivre les traces d’Atatürk. Il lança son armée à l’assaut des troupes anglaises d’occupation, et obtint que l’on reconnaisse l’indépendance de son pays. Fort du prestige ainsi acquis, il s’engagea dans des réformes ambitieuses, interdit la polygamie et le port du voile, ouvrit des écoles modernes pour les garçons et les filles, encouragea l’apparition d’une presse libre. L’expérience dura dix ans, jusqu’en 1929, date à laquelle Amanullah fut chassé du pouvoir par une conjuration de chefs traditionnels qui l’accusèrent d’impiété. Il mourut en exil à Zurich en 1960.
Plus durable fut l’expérience tentée en Perse par Reza Khan. Fervent admirateur d’Atatürk, officier comme lui, il aurait voulu reproduire dans son pays la même expérience modernisatrice ; mais il se montra finalement incapable d’opérer une rupture franche, préférant fonder une nouvelle dynastie impériale, celle des Pahlavi, plutôt qu’une république à l’européenne, et tentant de jouer sur les contradictions entre les puissances plutôt que d’imposer nettement une ligne d’indépendance. Sans doute n’avait-il pas les mêmes talents que son modèle, mais il faut dire aussi à sa décharge qu’avec la découverte du pétrole, il y avait peu de chances que les puissances laissent l’Iran vivre sa vie. Pour garder le pouvoir, la dynastie fut contrainte de s’allier aux Britanniques puis aux Américains, c’est-à-dire à ceux que le peuple iranien percevait comme les ennemis de sa prospérité et de sa dignité.
C’est là, face à l’exemple d’Atatürk, un contre-exemple. A celui qui apparaît comme un protégé des puissances adverses, la légitimité est déniée, et tout ce qu’il entreprend est déconsidéré ; s’il veut moderniser le pays, le peuple s’oppose à la modernisation ; s’il cherche à émanciper les femmes, les rues s’emplissent de voiles protestataires.
Que de réformes sensées ont échoué parce qu’elles portaient la signature d’un pouvoir abhorré ! Et, à l’inverse, que d’actes insensés ont été applaudis parce qu’ils portaient le sceau de la légitimité combattante ! La chose est vraie, d’ailleurs, sous tous les cieux ; lorsqu’une proposition est soumise au vote, les électeurs se prononcent moins en fonction du contenu qu’en fonction de la confiance qu’ils accordent, ou qu’ils n’accordent pas, à la personne qui l’a présentée. Les remords, les remises en cause, n’interviennent qu’après.