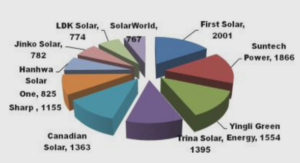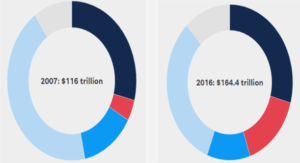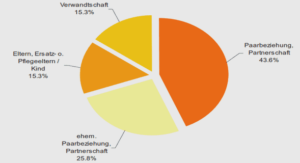L’ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT
Naît-on entrepreneur ? Existe-t’il un entrepreneur africain différent de son homologue européen ou asiatique ? L’environnement social et politique est-il surdéterminant pour l’apparition de la fonction entrepreneuriale ? Peut-on favoriser l’éclosion d’une telle voca-tion ? Ce sont quelques-unes des interrogations qui s’imposent à celui qui s’intéresse à l’entrepreneur en milieu africain.
À regarder de près, il y a effectivement un environnement plus ou moins favorable à l’émergence d’une classe d’entrepreneurs, il constitue le terreau de fertilisation et d’appel. Les options idéologiques, les choix politiques, les contraintes économiques fixent le décor de théâtre susceptible de séduire un nombre plus ou moins conséquent d’acteurs (Richard P., 1983).
Mais les acteurs potentiels ne forment pas un tout homogène. Une véritable typologie entrepreneuriale s’impose, à l’intérieur de laquelle le créateur africain d’entreprise occupe une place à part. Nous nous efforcerons d’en cerner les ressorts, les motivations et la cohé-rence. Combinant la double entité de l’homooeconomicus guidé par son intérêt personnel et d’un individu socialisé par son immersion clanique, l’entrepreneur doit affronter des logiques contradictoires et résoudre les diffractions au regard des butées de l’équilibre éco-nomique. C’est en maîtrisant la grille des referents comportementaux que la logique entre-preneuriale pourra réduire les déviances et canaliser des fonctions qui lui sont extérieures (Papin R., 1995).
L’ENVIRONNEMENT D’APPEL
L’action d’entreprendre s’inscrit dans un environnement caractérisé par un certain degré d’hostilité dû à des interprétations idéologiques restrictives ou par un dispositif concurren-tiel plus porteur. Ce dernier s’exprime à travers les arbitrages nationaux qui orientent la politique entrepreneuriale plus ou moins favorablement pour les opérateurs locaux. Mais entreprendre, c’est aussi accepter les risques qui donnent aux initiatives une plus ou moins grande probabilité de réussite tandis que les contraintes d’ordre structurel tracent les condi-tions objectives d’accès à la création d’entreprises.
L’Afrique subsaharienne et le Maghreb offrent, au gré de la cinquantaine de nations qui les composent, et de l’évolution de leurs choix au cours de plus de trois décennies, une mul-titude d’expériences. Mais, globalement, le continent a évolué d’une suspicion agressive ou tatillonne à l’encontre des entrepreneurs vers un appel à contribution plus ou moins fruc-tueux (Vallée O., 1992).
L’option idéologique
Depuis trente ans, l’analyse idéologique des relations économiques a passablement changé. L’Afrique a fondé ses indépendances sur une trilogie conquérante : l’Industrie, le Plan et l’État (Albagli Cl., 1984). L’Industrie apparaissait comme le symbole du dévelop-pement. Le Plan devait imaginer l’avenir, coordonner les actions et protéger des turbu-lences cycliques. L’État s’imposait comme l’opérateur le plus crédible.
Cette analyse dérapa. L’agriculture fut délaissée tandis que d’énormes bâtisses supposées être les avancées du développement devenaient des gouffres financiers. Les plans s’empê-traient dans des ressources financières fondées sur les cours des matières premières dont la lisibilité ne dépassait pas quelques mois de projection. Les objectifs quinquennaux deve-naient hypothétiques, puis dériver en catalogues d’espérances offerts au bon vouloir des bailleurs de fonds. Quant à l’État tout puissant et référence tutélaire, grâce à sa capacité de dérivation et d’accumulation des ressources, il ne résistait pas à la tentation d’être, non seu-lement le chef d’orchestre, mais aussi l’orchestre lui-même. Alors la démultiplication des partitions s’avérait peu compatible avec la rigidité d’une administration incapable de s’ajuster à la complexité et aux inflexions d’un marché.
Dans les années quatre-vingt, le système s’est effondré. L’industrie offrit ses ruineux « éléphants blancs » et ses « cathédrales du désert » à des opérateurs privés. Le plan ne cher-chait plus qu’à scruter l’avenir au profit d’analyses du marché enfin dépouillé de références idéologiques suspicieuses. L’État « simulateur » des entrepreneurs prit le parti d’en être seulement le « stimulateur » et se délesta d’un appareillage juridico-administratif qui jouait à l’encontre des chefs d’entreprise. D’agent exploiteur, l’entrepreneur devint l’agent du développement. Après avoir jeté tout le dispositif de défiances, l’État mit en œuvre une séduction pressante en offrant conditions fiscales, infrastructures, zones d’implantation à statuts spéciaux… L’Afrique entière était balayée par un regard neuf sur l’entrepreneur. Encore fallait-il que la stratégie nationale concordât au mieux à la démultiplication.
La stratégie nationale
Les modèles d’Harrod-Domar mettent l’accent sur le niveau d’investissements et le coef-ficient de capital pour concevoir la croissance comme un processus mécaniste (Austruy J., 1987). Mais, dans un contexte de rareté de moyens et d’initiatives, la tentation est forte d’opérer un ordre de mise en marche des opérations pour définir une stratégie industrielle ou, plus rarement agricole. Six stratégies sont discernables dans les divers pays d’Afrique ou à diverses périodes pour une même nation. Chacune d’elles n’offre pas le même terreau à l’initiative entrepreneuriale des nationaux.
L’industrie industrialisante
L’objectif prioritaire de l’État est de conduire une structuration de l’appareil de produc-tion à partir du tableau d’échanges industriels. L’État privilégie, en conséquence, la mise en place d’industries lourdes (sidérurgie, pétrochimie, cimenterie…). Ces unités sont réputées faciliter l’émergence d’entreprises en aval, qui seront leurs débouchés naturels. Et ces entreprises de produits semi-finis favoriseraient à leur tour l’éclosion d’un réseau d’entre-prises de bien de consommation, clientes des précédentes. Fortement imprégnée du modèle soviétique, cette stratégie nécessite beaucoup de capitaux, la maîtrise d’une technologie avancée, mais très peu de main d’œuvre (Andreff V. et Hayab A., 1978). L’Algérie en a été le porte-drapeau le plus accompli. Mais les industries industrialisantes n’industrialiseront que les imaginations…
La valorisation des matières premières
L’Afrique a hérité d’un système d’exploitation des matières premières conçu comme une complémentarité productive de la métropole dans le pacte colonial. Elle en a fait, dans sa quête de devises, l’outil décisif pour accéder à la technologie industrielle et à l’importation de machines, voire « d’usines clefs en main ». Elle fut naturellement tentée d’améliorer sa position en n’exportant non pas des matières brutes, mais des produits transformés. Des ini-tiatives de valorisation furent conduites à des degrés divers, se limitant au premier degré de transformation (cf. égreneuse de coton) ou poursuivant jusqu’au bien fini (cf. conserverie d’ananas). Cette stratégie a nécessité des engagements capitalistiques très variables qui se sont ventilés de la raffinerie de pétrole à la conserverie de concentré de tomates… Les résul-tats n’ont pas été homogènes non plus.
La stratégie d’exportation
Ce créneau a révélé l’Asie du Sud-Est avec ses quatre dragons, mais il a été peu opéra-tionnel en Afrique. L’Ile Maurice semble la notable exception. Le continent n’a pas eu les moyens de concurrencer les producteurs asiatiques compte tenu du caractère d’excellence de leur productivité et des très faibles coûts de leur main d’œuvre. Quelques pays, comme la Tunisie ou le Maroc, sont parvenus, en bénéficiant de la proximité européenne, à s’éta-blir sur un segment de production dans le textile pour traiter, par le perfectionnement pas-sif, les opérations nécessitant le plus de main d’œuvre. L’intervention du capital étranger est souvent déterminante pour l’implantation de l’unité de production et pour l’accès aux marchés d’exportation.
La substitution aux importations
Elle est techniquement simple : il suffit d’évaluer le montant des importations d’un pro-duit donné pour connaître la taille du marché solvable. L’évaluation du point mort d’une unité de production permet d’apprécier l’opportunité d’un tel projet national. Les biens sont généralement ceux répondant aux premières nécessités : agro-alimentaires, habillement, équipement ménagers… Des initiatives ont été prises dans toute l’Afrique, mais se sont heur-tées souvent à la taille d’un marché trop étroit dont les consommateurs n’étaient, de surcroît, pas convaincus de l’alternative ainsi proposée et lui préféraient le produit d’importation (cf. les enquêtes à Abidjan ou à Dakar) (Gningue A., Kouessy R. et N’diaye A., 1989).
L’industrie de main d’œuvre
Le parti pris est celui de la création d’emplois. La forte urbanisation démultiplie les demandes d’embauchés et crée une pesanteur sociologique, politiquement explosive. Les unités de production offrant le plus petit investissement par emploi créé et le nombre le plus élevé d’emplois par projet seront donc privilégiées. Les industries de biens de consomma-tion ont souvent l’avantage : habillement, conserverie, conditionnement… Mais ce type d’entreprises bute simultanément sur l’étroitesse des marchés intérieurs africains et sur la concurrence internationale à l’extérieur. Par ailleurs, l’accès à une technologie élaborée est quasi inexistant tandis que la main d’œuvre disponible est loin d’être absorbée.
L’arbitrage de circonstances
Cette catégorie est généralement peu théorisée alors qu’elle éclaire souvent les déci-sions : propositions inattendues d’un bailleur de fonds, valorisations du terroir d’origine d’un responsable politique, résultats de quelques prévarications réussies, montages irres-ponsables d’un projet sans avenir mais fruit d’une collusion d’assentiments partiels… Ils constituent souvent ces « éléphants blancs » régulièrement dénoncés et parsèment la géo-graphie africaine avec, ici une unité pétrochimique incapable de fonctionner (Congo), là une sidérurgie dépourvue de matières premières (Togo), ailleurs, une conserverie de fruits affrontant l’oubli de la mise en place de la production agricole (Centrafrique), ou, ailleurs encore, une usine de conditionnement de poissons sans marché intérieur (Mali)… La liste fait le délice des chroniqueurs et creuse des déficits budgétaires abyssaux.
Il ressort de cet éventail de stratégies des appels plus ou moins pressants aux entrepre-neurs. Plus l’industrie sera capitalistique (industrie industrialisante), moins la variété des initiatives sera sollicitée. Plus le marché sera connecté à l’extérieur, plus le recours à des opérateurs étrangers sera nécessaire. Plus les décisions seront aléatoires, moins les règles de gestion présideront au fonctionnement des dites entreprises. Plus l’arbitrage sera étroit, plus il confinera les opérateurs dans un certain type d’entrepreneurs. Ce contexte déterminé, il reste encore à l’investisseur à apprécier les risques cadrés par les conditions objectives du marché.
La contrainte objective
Les options idéologiques et les arbitrages stratégiques conditionnent l’émergence poten-tielle d’entrepreneurs. Mais les candidats révélés doivent encore apprécier la situation concrète à partir des contraintes majeures : la taille critique du marché solvable, la résolu-tion du financement, l’accès à un marché de l’emploi déterminé, l’intégration au système international (Albagli Cl., Cazenave F.-X., 1984).
La taille critique du marché solvable
Dans les années soixante et soixante-dix, les techniques de production industrielle avan-tagent les grandes séries établies sur les économies d’échelle. Le point mort de production nécessite, en conséquence, de vastes marchés et des niveaux d’investissements élevés, faute de quoi les coûts de production intérieurs sont plus élevés que les prix des produits similaires importés et l’émergence d’un profit s’apparente à une ligne d’horizon fuyante…
La faible taille de la plupart des nations africaines et, a fortiori, de leur marché solvable, impliquait la concession d’un monopole à l’abri de barrières douanières et des prix courants peu favorables amputant bientôt le pouvoir d’achat des ménages.
Depuis la fin des années quatre-vingt, la technologie se combine, de plus en plus avec bonheur, à la segmentation et aux marchés limités (Schumacher E.-F., 1978). Voici l’occa-sion de s’installer dans de nouvelles niches de production pourvu que la technique soit maî-trisée. Ce nouveau contexte bouscule les paramètres de référence et offre de nouvelles opportunités aux entrepreneurs africains…
L’obtention du financement
La taille minimum de l’investissement, en terme de valeur salariale, n’a cessé de s’agran-dir jusque dans les années soixante-dix (Bairoch P., 1971). Les fonds indispensables à toute unité de production devenaient de plus en plus difficiles à collecter. On se heurtait au double verrouillage d’une disponibilité d’épargne insuffisante et de moyens de collecte trop sou-vent inefficaces. L’absence de garanties suffisantes pour les banques et les défaillances du réseau bancaire dressaient des barrières d’accès à la création d’entreprises et suscitaient découragements ou concussions.
La mise à contribution de l’épargne informelle, avec le système des tontines, dans le pro-cessus entrepreneurial donne aujourd’hui de nouvelles possibilités qui, sans être la panacée, offrent des assouplissements et de nouveaux moyens (Mayoukou C, 1994). La réduction de la taille optimale de l’entreprise abaisse le seuil de financement critique et facilite d’autant plus son ajustement.
L’accès à un marché de l’emploi déterminé
La main d’œuvre disponible ne fait défaut ni au Sud, ni au Nord du Sahara. L’ampleur du chômage accompagne dramatiquement l’urbanisation. Au tournant du siècle, la moitié de la population devrait être urbanisée en Afrique Noire. Mais le personnel qualifié fait sou-vent défaut et l’adaptation du personnel à une productivité industrielle reste encore souvent problématique ; ainsi les entreprises oscillent-elles entre une coopération technique étran-gère onéreuse et une fiabilité discutable de leur production (cf. l’expérience Land Roover au Nigeria). La formation insuffisante écourte la durée de vie des équipements dotés d’une technologie trop moderne.
Le choix d’options non capitalistiques ferme l’entreprise à la compétitivité internationale et laisse la voie à des unités de production mieux adaptées au marché, mais techniquement peu performantes.
L’intégration au système international
Compte tenu de la taille des marchés africains, les entreprises de fabrication de machines-outils sont hors de portée, il faut donc importer les équipements, et pour cela, avoir accès aux marchés extérieurs, aux devises, aux informations technologiques… La rareté des devises, les stratégies d’économies autocentrées et l’octroi de monopoles sous protection douanière ont entraîné la sclérose de l’appareil de production. Les ruptures d’approvisionnement achevaient de désorganiser la production.
L’ouverture des marchés est aujourd’hui plus favorable, mais les devises, dont l’alloca-tion tend à reposer sur des critères plus économiques, restent encore rares. Le partenariat se présente souvent comme une solution combinant l’accès à une technologie avancée d’un capital complémentaire et l’accès à un marché extérieur…
L’appréciation de ces données procure au candidat-entrepreneur les paramètres du risque auquel il entend se soumettre. Comme on a pu le remarquer ceux-ci ont passablement évo-lué ces dernières années. L’entrepreneuriat peut donc se nourrir d’un contexte plus favo-rable. À ce cadre d’exercice va correspondre une dynamique entrepreneuriale renouvelée.
LA DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE
La fonction entrepreneuriale peut être remplie par divers agents économiques répartis entre la puissance publique, les agents étrangers et les acteurs nationaux. Il est possible de dresser une typologie entrepreneuriale adaptée aux diverses hypothèses stratégiques précé-demment évoquées. Mais notre étude est plus naturellement focalisée sur les opérateurs africains et les arbitrages spécifiques du continent. Leur comportement n’est pas lié à une seule grille d’analyse. Il s’écarte d’une lecture classique de l’homooeconomicus, sans en être complètement étranger dans la démarche entrepreneuriale.
La typologie des entrepreneurs
On distingue généralement cinq types d’entrepreneurs susceptibles de développer une activité économique. En Afrique, la nécessité pour les futures entreprises de s’ajuster aux arbitrages stratégiques nationaux, a donné une tonalité particulière à cette classification tra-ditionnelle.
U État-entrepreneur
Pendant plus d’un quart de siècle, l’État s’est voulu un « simulateur » de la fonction entrepreneuriale. Il avait apparemment, pour cela, deux séries de solides raisons.
L’État-accumulateur plongeait les traditions de cette fonction dans les sociétés agraires où il dérivait et agrégeait le surplus. Mais il commua cette double action en une fonction modernisée, captant les royalties sur les ventes des produits miniers ou énergétiques, ou capitalisant les ressources dégagées par les Caisses de Stabilisation ou les Marketing Boards des cultures de rente. Aucun autre agent ne parvenait à réunir des fonds compatibles avec les exigences financières des entreprises modernes. Cette fonction fut confortée dans le contexte idéologique des indépendances où les opérateurs étrangers apparaissaient comme l’expression néo-coloniale de l’exploitation et les opérateurs nationaux comme le relais de détournements de fonds. Les codes d’investissements encadraient étroitement toute initiative entrepreneuriale et l’État devint l’interlocuteur privilégié.
L’État ne résista pas à la tentation d’être lui-même l’acteur. Les justifications ne man-quaient pas. Les acteurs nationaux, soit par inclination, soit par carence objective de nature financière ou technique, se sentaient peu attirés par des activités entrepreneuriales en dehors du négoce. Par ailleurs, l’assimilation du chef d’entreprise à un agent exploiteur et, a fortiori, s’il était étranger, conduisait l’État à privilégier l’entreprise publique au nom de la lutte des classes. Ainsi, l’entrepreneuriat n’était-il, le plus souvent, que l’adjuvant rési-duel des initiatives du pouvoir ou le supplétif enrégimenté de son action économique.
Mais l’entreprise publique se fit État dans l’État (cf. la Sonatra en Algérie ou l’O.C.P.M. au Maroc) au mépris des règles élémentaires d’obligation de résultats ; on put alors voir des entreprises mises sous perfusion permanente du budget national pour rééquilibrer leurs comptes. Le secteur étatique tentaculaire avait anémié la vigueur entrepreneuriale (Albagli CL, 1984). Désormais, le secteur est, soit en liquidation auprès des bailleurs de fonds, soit réinséré dans les règles du jeu du marché et de la concurrence.
L’entrepreneur transnational
Ce type d’entreprises symbolise souvent les affres du capitalisme. Les sociétés qui cher-chaient à s’implanter présentaient souvent un chiffre d’affaires supérieur au P.N.B. du pays tout entier (en 1970, le chiffre d’affaires des Galeries Lafayette en France était plus impor-tant que le P.N.B. issu de l’activité de cinq millions de Maliens). Partenaire encombrant pour l’État, on lui reprochait de transférer les profits hors du territoire et de river l’écono-mie nationale à des commandes extérieures (Amin S., 1986 ; Emmanuel A., 1972).
Pourtant lorsque l’État, pour conduire une politique d’indépendance économique, se lança dans un recours à l’emprunt, il entendait bien ainsi affirmer ses choix stratégiques et écarter la menace des rapatriements de capitaux. Dans les années quatre-vingt, il s’avéra que l’État n’avait pas été perspicace dans ses investissements ou que le personnel politique en avait dérivé les flux. L’amortissement de la dette plaçait le pays tout entier à la merci de ses créanciers. Les autorités découvraient alors que les sociétés transnationales pouvaient apporter des capitaux, initier à de nouvelles technologies, créer des emplois et que, pour finir, si elles rapatriaient des bénéfices encore était-il nécessaire d’abord qu’elles en fis-sent ! La charge de la dette, elle, pesait sur le budget de l’État quels que soient les résultats !
L’entrepreneur étranger
L’image classique de l’entrepreneur étranger est celle de l’agent qui s’est implanté durant l’époque coloniale dans une exploitation agricole ou industrielle. À l’Indépendance, une nouvelle vague lui a succédé, attirée par l’ouverture de nouveaux marchés. Mais les deux premières décennies ont été marquées par un climat généralement plein de suspicions. Le Nigeria limitait la détention des parts détenues par les étrangers à 49 %, par exemple. L’heure était non seulement à des codes d’investissements très contraignants, mais aussi à la nationalisation comme au Zaïre, en Algérie ou en Ethiopie.
Considérant cette pénurie des capitaux et des initiatives, la perception que l’on avait de l’entrepreneur étranger s’est radicalement inversée depuis quelques années. Il est mainte-nant activement recherché et l’on procède à mille séductions : avantages fiscaux, régle-mentations spéciales, aménagements privilégiés, statut douanier spécifique. Les pays se concurrencent entre eux, mais cela ne suffit plus, tant la situation économique générale reste préoccupante et délabrée alors que s’ouvrent, en Europe Centrale, des marchés qui, pour être faibles, sont néanmoins considérablement plus solvables qu’en Afrique !
L’entrepreneur national
C’est dans le commerce et les fameuses « sociétés d’import-export » que les initiatives africaines abondaient. La création d’une unité industrielle soulevait davantage de réti-cences. L’entrepreneur, souvent assimilé à un ennemi de classe ou à un relais de l’étranger, disposait d’un contexte difficile et se heurtait à une administration tatillonne ou arbitraire. Les banques, faute de recevoir de solides garanties, n’accordaient ni leur confiance, ni leurs crédits.
Aujourd’hui, l’État mesure qu’il n’a pas la compétence requise pour apprécier les mille facettes d’un marché. De « simulateur » l’État doit convertir son rôle en « stimulateur » pour faire émerger une classe d’entrepreneurs collant au marché, se réajustant à la concurrence, s’immergeant dans les évolutions technologiques. Voici l’État déléguant des initiatives qu’il avait crû devoir s’approprier pour bâtir l’économie, lorsqu’il mesure toute la souplesse nécessaire à la fonction entrepreneuriale. Initiative individuelle, groupe sociétaire, coopé-rative, partenariat avec l’étranger, désormais toutes les formules sont appelées par les auto-rités nationales et internationales.