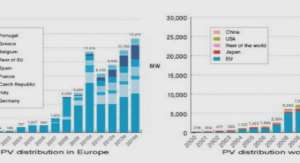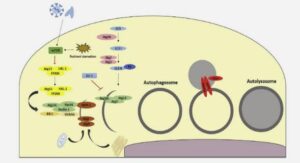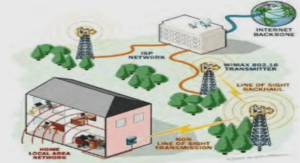Les relations homme/animaux représentations, évolutions et attitudes
Dimension anthropologique
La douleur des animaux ne fait question que pour les humains et tant qu’ils sont en situation de la réduire ou de l’aggraver : les maladies, la prédation et les combats entre animaux tels qu’ils adviennent en contexte naturel ne sont pas ici pris en compte, tant qu’ils ne relèvent pas directement de l’action humaine. D’autre part, la « douleur animale » est fort loin d’être uniforme, tant dans ses causes que dans ses manifestations, comme le montrent les expertises en sciences du vivant, pour lesquelles l’appréciation de la diversité de la douleur (selon les espèces, les contextes et les atteintes) est précisément la principale difficulté (Rey, 2000), voir aussi Chapitre 2, paragraphe 2.4.
Il ne pourra donc être question ici que de la douleur des animaux, comme le propose D. Baldin, et plus précisément des animaux d’élevage, qui se trouvent directement dépendants des humains, dont les comportements et les choix techniques ont des effets sur leur bien-être, mais aussi sur le bien-être des humains eux-mêmes, au point que l’on peut considérer que la notion même de bien-être animal est « une fausse question » (Porcher, 2004), une question mal posée, en ce qu’elle sépare le bien-être des deux ensembles de vivants qui ont à travailler ensemble et, par conséquence, à pâtir (ou non) ensemble.
Contextualisation socio-anthropologique
Le tout premier enseignement de l’anthropologie quant aux relations entre humains et animaux est leur très grande diversité, tant dans les contextes que dans les modalités. Il n’existe pas de société qui n’entretienne des relations avec les animaux. Mais ces relations sont très différentes, selon les milieux naturels, certes, mais aussi – et surtout, puisque c’est précisément ce qui peut faire question – selon les sociétés, dont les mœurs et usages pèsent au moins autant que le milieu naturel sur les relations entre humains et animaux. On observe ainsi que, dans des contextes naturels semblables, et avec des animaux semblables, des sociétés différentes entretiennent des relations fort différentes avec « leurs » animaux (Descola, 1994; Descola, 1999).
La protection contre les animaux dangereux, la chasse et la pêche, le prélèvement de divers produits animaux, la domestication, le compagnonnage de travail ou la compagnie d’agrément, etc. : toutes ces situations instituent entre humains et animaux des relations très diverses, différenciées selon les espèces et, dans bien des cas, selon les individus d’une même espèce. Choisies ou contraintes (y compris pour les humains : choisit-on vraiment de se protéger du lion affamé ou, plus banalement, de la puce également affamée ?) en fonction des circonstances et des aptitudes des uns et des autres, pour le meilleur et pour le pire, il n’y a guère de circonstance qui n’enveloppe des relations avec les animaux, y compris ceux qui vivent à l’état sauvage, la « nature » étant presque universellement anthropisée (Descola, 1999).
Abattages rituels : judaïsme et islam
L’expression « abattage rituel » est ici préférée à celle de « sacrifice », pour trois raisons : • D’abord, parce que la notion même de sacrifice reste, en anthropologie, sujette à discussions, dans lesquelles il n’y a pas lieu d’entrer ici ; en revanche, la notion de rituel, entendue en son sens descriptif de conformité à une norme pratique fixée par une religion, ne soulève aucune difficulté. • Ensuite parce que, dans le cas du judaïsme, il n’y a pas de sacrifice hors du Temple de Jérusalem, mais seulement des prescriptions rituelles, qui n’ont pas valeur sacrificielle (Deutéronome 12, 4-22 ; Nizard-Benchimol, 2001).
Depuis la destruction du Temple, il y a donc dans le judaïsme un rituel d’abattage des animaux (c’est la shechita, effectuée par un shohet), mais pas de sacrifice. • Enfin, parce que les textes professionnels, officiels ou techniques, utilisent fréquemment le terme de « sacrifice » en manière d’euphémisme pour « abattage », manifestement parce qu’il investit d’une dignité religieuse une activité sans cela jugée brutale et dégoûtante. Le judaïsme et l’islam prescrivent explicitement des règles précises, énoncées respectivement dans la Bible (Lévitique, 1-7 ; Deutéronome, 14, 3-21) et dans le Coran (sourate V, La table dressée), définissant les règles et conditions d’une nourriture « permise », « pure » : cacher dans le judaïsme (Bauer, 1996; Douglas, 1971; Soler, 2006), halal dans l’islam (Benkheira, 1996; Benkheira, 1997; Benkheira, 2000; Bonte et al., 1999; Brisebarre, 1998a; Brisebarre, 1998b).
Ces deux codes alimentaires ont en commun de nombreux traits : les catégories d’animaux permis ou interdits ; l’exigence que l’animal soit parfait en son genre ; la compassion soucieuse d’éviter le stress et de provoquer une mort rapide par une saignée sûre et complète ; et enfin l’obligation de prononcer la formule rituelle d’invocation, qui légitime la mise à mort sous la permission et la bénédiction divines. Le judaïsme est particulièrement pointilleux sur tous ces aspects (minutieusement détaillés in Ganzfried, 1987), fixant avec précision l’outil et le geste même de la saignée, et ne confiant cette tâche qu’à des shohets (terme que l’on traduit usuellement, mais improprement, par ‘sacrificateurs’), agréés au terme d’une formation religieuse et technique très rigoureuse.
En France, depuis le décret n°64-334 du 16 avril 1964 et, en dernier lieu, l’article R.214-75 du code rural, cette habilitation est délivrée conjointement par le Ministère de l’Agriculture et par l’un des quatre organismes confessionnels agréés. Enfin, à la différence de l’islam, le judaïsme impose une inspection extrêmement méticuleuse de la carcasse, et interdit la consommation des parties voisines du nerf sciatique (Genèse, 32, 33), ce qui a maintenant pour conséquence la dérivation des quartiers arrière vers le marché non cacher, plus simple et plus rentable que la traditionnelle dilacération des quartiers arrière pour en extraire le nerf sciatique.