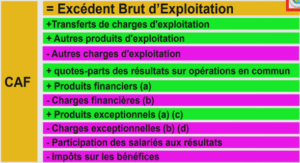L’agriculture malgache doit être développée pour lutter contre la pauvreté de la population qui atteint 74,1% au niveau national, 54,0% en zone urbaine, et 80,0% en zone rural. Le secteur agricole a ainsi besoin de financement pour permettre aux paysans de mobiliser les innovations techniques, et d’acheter les intrants et les équipements nécessaires à leur exploitation. Souvent, ces producteurs manquent de capacité d’autofinancement pour appuyer cette modernisation. De plus, les paysans sont handicapés par l’insuffisance de l’accès aux produits financiers que peuvent leur offrir les établissements de crédit ainsi que le secteur informel.
Comme toute institution financière le réseau CECAM n’échappe pas à cette règle. Institution à vocation agricole, sa structure complexe lui a permis de devenir la première institution de microfinance ayant actuellement la plus grande couverture dans le monde rural. Sa réussite dépend toutefois de la pérennité des diverses des unités régionales qui la constituent .
Le réseau CECAM, depuis sa création jusqu’à nos jours, développe leurs interventions en milieu rural en consentant de ligne de crédits aux paysans et au ménage de faible revenu. Ceux-ci sont souvent incapables de faire face au remboursement de crédit à l’échéance. En effet, beaucoup des microfinances constatent, à la fin d’un exercice, des crédits classés en retard ou des clients abandonnés assez élevés. Soulignons qu’un tel risque nécessite une meilleure gouvernance de l’institution. Des théoriciens, des praticiens pensent qu’une bonne gouvernance nécessite une bonne gestion financière. Pierre Conso, dans son livre intitulé la gestion financière de l’entreprise, dit que : « la gestion financière a toujours occupé une place privilégiée dans la gestion de l’entreprise car elle concerne la politique générale de la firme : sa naissance, sa croissance, son autonomie et sa survie ». Selon lui le problème financier est lié à la vie de l’entreprise en tous ses moments et sous tous ses aspects.. La fonction financière est ainsi un rôle déterminent dans la gestion de l’entreprise toute entière. Elle détermine comment l’entreprise gère ses ressources rares pour satisfaire la demande de ses clients, tout comme les actionnaires (les bailleurs) cherchent une meilleure rémunération de ses capitaux ou un chef d’entreprise voir tout le personnel qui se contente que leur entreprise connaît une meilleure rentabilité. C’est pourquoi il apparaît souvent que les critères financiers gouvernent les choix de la vie de l’entreprise.
LE RESEAU CECAM de MADAGASCAR
Il est un système financier décentralisé le plus important à Madagascar. Son originalité est plutôt d’avoir développé ses activités principales exclusivement vers les besoins de l’agriculture et de l’élevage. Mais, avec la croissance et la diversification de leurs membres, le Réseau a commencé à s’ouvrir à d’autres catégories professionnelles, la rentabilité plus grande et surtout plus rapide des activités non agricoles et la capacité d’influence plus forte des commerçants. Alors que, dès sa création jusqu’à sa forme actuelle, le Réseau CECAM a parcouru un long chemin en traversant plusieurs obstacles. Son processus d’institutionnalisation progressive et ascendante conditionne leur ressort à travers lequel le réseau devient un véritable intermédiaire financier.
Historique et Institutionnalisation du Réseau
L’histoire du Réseau CECAM marque en générale trois (3) étapes : tout d’abord, une institution fondée des associations d’agriculteurs, ensuite une extension soutenue par les pouvoirs publiques et divers partenaires, et enfin les CECAM deviennent le premier fournisseur de crédits aux agriculteurs. Tandis que, son institutionnalisation formelle n’a débuté qu’après neuf (9) ans de sa création.
Historique
Le Réseau CECAM, pour atteindre sa forme actuelle, n’était qu’au début une petite organisation des associations d’agriculteurs, fondée dans le cadre de partenariat entre deux ONG (AVEAMM et FERT) qui cherchait le financement de leurs projets. Ces deux ONG, après avoir franchir plusieurs étapes durant des années, se développaient, puis devenaient de plus en plus une véritable institution financière mutualiste. L’histoire du Réseau, que nous allons décrire ci-dessous, est tirée dans les statuts de l’URCECAM. Cet historique ne reflète tous les événements de la vie du Réseau CECAM, il est ici décrit d’une manière à apparaître uniquement les points de repère de leur histoire.
▶ Une institution financière fondée par des associations d’agriculteurs
Au milieu des années 1980, des groupes d’agriculteurs constitués dans le cadre d’un partenariat entre deux ONG, l’une malgache (AVEAMM) et l’autre française (FERT), ont commencé à rechercher des solutions à leurs problèmes de financement.
Entre 1986 jusqu’à 1989, ils ont tout d’abord créé des groupes de caution solidaire auxquels l’AVEAMM accordait des prêts, principalement pour financer des dépenses de production (crédits à court terme pour l’agriculteur ou l’élevage) puis pour l’achat de matériel (crédits à moyen terme pour des charrues, charrettes, herses, bœufs de trait). La pratique de cette expérience était un fort ressort des agriculteurs, au niveau local, pour sélectionner les membres dignes de confiance et pour étudier des projets. Un Comité Local des Crédits, constitué dans chaque village, a permis d’initier une cinquantaine de leaders paysans aux principes du crédit et l’analyse des dossiers de demande de prêts.
Ces groupes d’agriculteurs se sont ensuite réunis pour constituer une association paysanne régionale (FIFATA, 1989) qui a décidé de mettre en place les premières caisses villageoises d’épargne et de crédit du pays (1990). Cette expérience a suscité l’intérêt de plusieurs donateurs (Banque Mondiale, 1992) et agences d’aide (FAO, 1990 ; BIT, FRASLIN, 1991). Ceci a permis aux agriculteurs de financer leurs projets.
▶ Une extension soutenue par les pouvoirs publics malgaches et divers partenaires
En 1991, le Ministère de l’Agriculture de Madagascar a invité les promoteurs de cette expérience à l’étendre dans de nouvelles régions. Ceci permet, à partir de 1992, l’accès à une ligne de crédit liée à un projet de développement de la culture de maïs (PMMO/FED) jusqu’alors confiée à la banque publique de développement agricole (BTM) qui ne parvenait pas à l’utiliser.
A partir de 1993, les Caisses Villageois de FIFATA s’organisent de manière plus autonome et prennent le nom de CECAM (Caisses d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuels). Leur développement continue à être soutenu par FERT, avec l’appui du BIT/ILO grâce à des ressources du Ministère Allemand de la coopération (BMZ/RFA). En 1995, la Commission Européenne devient le principal partenaire financier des CECAM et le reste jusqu’à maintenant.
Fin 1996, après la promulgation des lois bancaires et mutualistes, les CECAM se regroupent en six Unions Régionales pour se constituer sous la forme d’Institutions Financières Mutualistes : Amoron’i Mania (Ambositra), Vakinankaratra (Antsirabe), Ivon’ Imerina (Ambatolampy), Itasy (Miarinarivo), Bongolava (Tsiroanomandidy) et Sofia (Antsohihy). Elles reçoivent des appuis techniques et financiers de banquiers mutualistes agricoles européens de RABOBANK (NL, 1995) puis du Crédit Agricole Mutuel (FR, 1997-1999). L’Etat malgache sollicite l’extension du Réseau CECAM dans de nouvelles régions et l’élargissement de ses activités en faveur de l’Elevage. Ces nouvelles actions sont financées par des crédits de la Banque Mondiale (PSE, PATER, PMF) et des subventions européennes (FED), françaises (AFD) et allemandes (GTZ).
▶ Les CECAM deviennent le premier fournisseur de crédits aux agriculteurs
En 1999, le Réseau CECAM est ainsi devenu la première institution de financement agricole à Madagascar : avec 137 caisses locales réparties dans 8 régions (sur les 28 que compte le pays), ils regroupent environ 25 000 membres individuels (dont plus de 90% d’agriculteurs) et une centaine d’associations paysannes ou de coopératives agricoles comptant elles-mêmes. Il a octroyé des crédits pour environ 18 milliards de FMG.
Processus d’institutionnalisation du réseau
En 1996, après avoir été prises sous formes de groupements de producteurs et d’associations paysannes, les CECAM commençaient à être impliquées dans la loi bancaire malgache. Leurs activités ont été appuyées par des partenaires étrangers et le Gouvernement malgache sollicitait l’intervention du réseau dans les différentes zones du territoire.
Au cours de cette année, une nouvelle loi bancaire vient d’être mise en application suivie d’une nouvelle loi relative sur les activités et organisation des institutions financières mutualistes ont rendues le réseau comme une « banque agricole mutualiste de crédit ». C’est ainsi qu’à partir de 1996, les CECAM se sont structurées en Unions régionales (URCECAM), organisations mutualistes dotées d’une personnalité juridique. Les caisses villageoises ne sont que des guichets pour les opérations de caisse. De plus, aucun décaissement de fonds n’a été effectué sans accord du Comité Local de chaque caisse.
Mais à un certain niveau d’octroi de crédit, la décision passe à l’échelon supérieur (au niveau régional). En 1999, un plan de développement a été élaboré. Il prévoit la constitution, au cours du premier semestre 2000, d’une Union Interrégionale des CECAM, UNICECAM, organe politique qui aura pour but de représenter les CECAM et de définir les orientations stratégiques du réseau.
Un établissement financier spécialisé, dénommé INTERCECAM, a été constitué pour assurer les services techniques et financiers nécessaires à l’ensemble du réseau. Son équipe animait des sessions de travail interrégionales regroupant des élus et des salariés des différentes mutuelles régionales.
Dans le but de protéger le patrimoine, de sécuriser les crédits à la clientèle, un Fonds Interrégional de Garantie Mutuelle (FIGAM) a été mis en place associant les six mutuelles. Ce fonds couvre en partie les risques de crédit qui ne peuvent pas être supportés par une mutuelle régionale, compte tenu de ses fonds propres disponibles. Le FIGAM constitue ainsi le mécanisme interrégional de solidarité financière assurant la solvabilité de chaque CECAM affiliée.
Introduction générale |