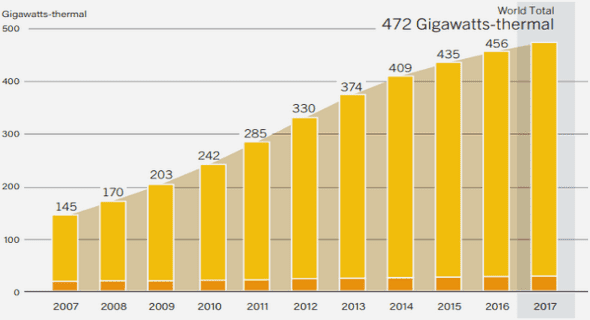Arrangements Institutionnels et Cohérences d’un Dispositif PSE Communautaire
Origines et Choix des PSE
Emergence de la notion de service environnemental
De la conceptualisation des fonctions des ressources naturelles aux services environnementaux Suivant Gòmez-Baggethun et al. (2009), la conceptualisation des fonctions des ressources évolue différemment selon les courants de pensée économique. Allant de l’économie classique et néoclassique, aux perceptions modernes des fonctionnalités de la nature, on constate une longue évolution de cette conceptualisation traitant initialement les fonctionnalités de la nature comme accessoires du champ d’analyse aux concepts modernes qui leur attribuent des rôles spécifiques à la variation du bien être et où elles sont qualifiées progressivement de services environnementaux, appropriables et échangeables.
Perceptions classiques et néoclassiques : de la valeur d’usage à la valeur d’échange
Pour les classiques, les ressources naturelles étaient seulement utiles pour créer la valeur. Elles ne perçoivent pas en ce sens la contribution intrinsèque des bénéfices issus de la nature dans la formation de la valeur (d’échange) elle même puisque ces bénéfices sont « gratuits (Say, 1829 ; cité par Gómez-Baggethun et al. 2009, p. 3) et non-appropriables (Gómez-Baggethun et al. 2009) ». Ce point de vue attribuait seulement la formation de la valeur au seul facteur travail et excluait complètement de l’analyse les ressources naturelles, notamment le facteur terre. A ce propos, Ricardo (1821, p.1), expliquait que : La valeur d’une marchandise, ou la quantité d’autres marchandises qui s’échange avec, dépend de la quantité relative de travail qui est nécessaire pour sa production […] L’eau et l’air sont abondamment utiles, ils sont en effet indispensables à l’existence ; jusqu’ici, sous des circonstances ordinaires, rien n’est obtenu de leur échange. (traduction de l’auteur) Malgré cette exclusion peu apparente, le facteur terre demeura dans les champs d’analyses classiques, notamment sa non-substituabilité qui imposait une certaine limite à la croissance. Divers résultats témoignaient de ce constat comme ceux de Ricardo sur la loi du rendement décroissant, de Malthus sur la croissance de la population et la limite des ressources, ou sur les prédictions de Mill sur la possibilité d’un état stationnaire (GómezBaggethun et al., 2009). Hors mis cette brève remarque, l’oeuvre d’Adam Smith sur la 15 richesse des nations venait confirmer le fait que l’origine de la valeur d’un bien était essentiellement déterminé par la quantité de travail nécessaire à sa fabrication (Smith, 1909 ; cité par Gómez-Baggethun et al, 2009, p. 3) et d’ajouter que : Les objets qui ont une grande valeur d’usage ont fréquemment peu ou aucune valeur d’échange ; et pareillement, ceux qui ont une grande valeur d’échange ont peu ou aucune valeur d’usage. (traduction de l’auteur) Au regard de Smith, les fonctionnalités et les biens dérivés de la nature étaient qualifiés de « productions de la nature ». Les seules valeurs qu’on pouvait en retirer provenaient seulement des rentes obtenues de leur appropriation (Smith, 1909 ; cité par Gómez-Baggethun et al, 2009, p. 3). Du côté des marxistes, les points de vue bien que légèrement différents, aboutissaient à la même conclusion selon laquelle la seule origine de la valeur était le facteur travail. A cet effet, Marx soulignait que la valeur provenait de la combinaison du facteur travail et de la nature en distinguant le fait que la nature était la source de la valeur d’usage ; mais étant donné que la valeur d’échange était définie socialement par la quantité de travail contenu dans un objet, la nature ne pouvait contenir rien de social (Marx (1867), 1887 ; cité par Gómez-Baggethun et al. 2009, p. 3). Les progrès technologiques et la croissance industrielle ont peu à peu changé les arguments de l’économie classique sur les ressources naturelles, en laissant de côté celles-ci de la sphère d’analyse et en avançant le concept de substituabilité. Cela marqua d’ailleurs la fin de l’ère classique. Gómez-Baggethun et al. (2009) identifient trois principales raisons qui expliquent ce changement : – La substitution progressive et longue du facteur terre vers les facteurs : capital et travail, – Un champ d’analyse qui se concentre sur l’aspect monétaire en laissant de côté les caractères quantitatifs, et le plus important qui marqua cette transition, – Le passage de l’analyse de la valeur d’usage vers la valeur d’échange. Ce dernier point a été favorisé par la révolution marginaliste qui avait permis de pousser en profondeur les théories néoclassiques de la substituabilité [des facteurs] (Naredo, 2003 ; cité par Gómez-Baggethun et al. 2009, p. 3) et la dominance de la monnaie en tant que principale mesure de la valeur (Gómez-Baggethun et al., 2009.). On pouvait ainsi avancer que le facteur terre pouvait se substituer avec le capital, donc évaluable en termes monétaires. D’autre part, la consommation accrue des ressources naturelles de l’après seconde guerre, poussée par le développement industriel et l’innovation technologique, soulevait des débats sur leur éventuel épuisement et les possibilités offertes par les technologies pour les substituer. Des études menées par Barnett et Morse (1963, cités par Smith et Krutilla, 1979, p. 395) avaient conclu l’improbabilité d’une augmentation des coûts des ressources naturelles (suite à leur raréfaction -diminution en quantité) en se basant sur 4 principes : (1) la disponibilité continuelle de ressources de classe inférieure quand celles de la classe supérieure sont épuisées, (2) le progrès des recherches sur la localisation de nouveaux dépôts induits par l’augmentation des prix actuels ainsi que le recyclage des résidus, (3) le changement technologique réalisé de manière à réduire les coûts d’obtention des ressources à travers la diminution des coûts d’extraction ou l’introduction de nouvelles méthodes qui valorisent les ressources précédemment inutilisées, et (4) le rôle régulateur du marché à favoriser la substitution des ressources raréfiées par d’autres plus abondantes ; mais en admettant par contre la détérioration de la qualité physique de l’environnement comme le paysage, l’eau, l’atmosphère (Barnett et Morse, 1963 ; cités par Krutilla, 1967, p. 778). Ces constats semblaient aussi soutenir certains modèles néoclassiques de la croissance qui assumaient de même l’absence de contraintes du système productif liées aux quantités 16 de matières premières provenant des ressources naturelles. Solow (1974) par exemple avançait que les améliorations technologiques favorisent la substitution des ressources naturelles au capital ce qui permettraient aux ressources de base de s’accroître. Ces constats suscitaient néanmoins des questionnements sur la validité des théories et des modèles néoclassiques de la croissance, en abordant les notions de services environnementaux. Smith et Krutilla (1979) soulignaient vis-à-vis de cela que ne pas tenir compte de ces services biaisait ces modèles en excluant la limite de la capacité d’absorption des résidus issus des processus de production par le « capital naturel ». D’ailleurs, d’après Smith et Krutilla (1979), la principale critique des travaux de Barnett et Morse était le fait qu’ils n’ont tenu compte que des ressources qui ne s’échangeaient que sur le marché des matières premières, excluant complètement celles qui n’ont pas de prix, comme les services environnementaux. Les ressources naturelles étaient même définies à l’époque comme étant celles qui s’échangent sur le marché des matières premières. Ainsi, le rapprochement des fonctions des ressources naturelles avait été réalisé de manière indirecte avec les défaillances du marché pour aborder les problèmes d’externalité qui sont non seulement associés à une modification de la qualité de l’environnement mais aussi liés aux divergences entre les coûts/ bénéfices privés et les coûts/ bénéfices sociaux, concepts introduits par Pigou (1920, cité par Pearce et Sturmey, 1966, pp. 152-3). Dans la détermination de ces coûts et bénéfices, deux sous-disciplines du courant néoclassique se sont oeuvrés à développer différentes techniques de valorisation afin de les internaliser dans des transactions.
Perceptions modernes
Elles se distinguent de celle du courant néoclassique par le développement d’outils servant à valoriser les SE afin de les inclure dans les champs des décisions économiques. Reconnaissant les limites du marché à refléter fidèlement les valeurs réelles d’un bien comme les SE, ce courant avait introduit de nouveaux méthodes pour identifier et évaluer les préférences des individus pour les SE. Deux sous disciplines se distinguèrent du courant néoclassique (Gómez-Baggethun et al., 2009) : – Celle de l’économie des ressources et de l’environnement qui s’est développé vers les années 60. Elle s’est beaucoup spécialisée dans le développement d’outils servant à valoriser et à internaliser les impacts économiques des dégradations des SE dans les processus de décisions en adoptant une vision utilitariste de la valeur, puis celle de – L’économie écologique dont l’apparition se serait située bien avant la première discipline, vers le XIX siècle (Martinez- Alier, 1987 ; cité par Gómez-Baggethun et al., 2009, p. 4). Elle se distingue essentiellement de l’économie de l’environnement sur la définition des liens entre les ressources naturelles et le capital manufacturier. Si la première avance la substituabilité entre ces facteurs, la seconde souligne la complémentarité. Etant données les lacunes des théories néoclassiques sur la prise en compte des rôles économiques des ressources naturelles et des services qu’elles rendent, l’économie de l’environnement considérait les SE comme étant des économies externes et en étant valorisées monétairement, elles peuvent être intégrées dans les décisions économiques. Elle s’est penchée pour cela sur le développement de techniques visant à intégrer ces biens et services dépourvus de prix dans les transactions comme la méthode des valorisations contingentes, des prix hédoniques, … (Farber et al., 2002 ; Chee, 2004). L’économie de l’environnement distinguait à cet effet l’existence de multiples facettes de la valeur qui 1. Smith et Krutilla (1979) définissaient le capital naturel comme étant « l’ensemble des dotations initiales en ressources naturelles de la planète incluant les services environnemenatux ». 17 additionnées entre elles constituaient la valeur économique totale (Heal et al. 2005, cités par Gómez-Baggethun et al. 2009, p. 4). L’économie écologique quant à elle allait démontrer les insuffisances des analyses effectuées par l’économie de l’environnement. Elle argumentait le fait que les décisions, abordées selon les points de vue utilitaristes, se heurtaient à des conflits de valeurs, en ce sens qu’on ne pouvait attribuer une unité de mesure commune/ unique (problème d’incongruité) à des valeurs complexes et multiples, qui varient selon l’étendu, le contexte ou encore la variation du niveau de connaissance sur l’objet en question (Fisher et al. 2009). Elle proposait de ce fait de nouveaux outils tels que les méthodes délibératives ou les analyses multicritères pour baser les choix décisionnels. D’un autre point de vue, elle soulignait aussi le fait que le capital naturel et le capital manufacturier sont complémentaires. A ce propos, Georgescu-Roegen (1986, cité par Gómez-Baggethun et al. 2009, p. 5) avançait l’idée que la reproduction du capital ne pouvait se faire sans intrants issus des ressources naturelles, tout comme la production requiert des inputs provenant des structures des écosystèmes (e.g. services écosystémiques) (aussi Daly et Farley, 2004). Reconnaissant les apports des fonctionnalités de la nature sur les activités économiques, les recherches antérieures avaient mis en évidence le besoin de développer des moyens nécessaires pour s’approprier ces services. Parmi ces moyens sont les marchés et les paiements.
Marchandisation des Services Environnementaux
-paiements et mobilisations sur les marchés Avec l’apparition de l’article de Costanza et al. en 1997 (repris partiellement dans Costanza et al. (1998)) qui évaluait la valeur monétaire du capital naturel et des services écosystémiques 2 à des trillions de dollars, des outils sont progressivement apparus pour « encaisser » ces trillions de dollars sur un marché ou au moyen des paiements, et ainsi protéger es ressources qui les génèrent. Le développement de ces mécanismes financiers avait été motivé en effet par le besoin de relier les sphères économiques distantes des phénomènes écologiques. Ainsi, la marchandisation des SE s’est développée progressivement depuis les années 60 où parallèlement, les recherches sur les techniques de valorisation des SE ont débuté. Suivant Kosoy et Corbera (2009), la marchandisation (appropriation et échange) comprend trois étapes bien distinctes que sont : (1) la caractérisation des fonctions de la nature en tant que services, (2) l’établissement d’une unité d’échange standard pour le service ainsi défini et (3) l’établissement de l’Offre, de la Demande et des structures d’intermédiation entre les fournisseurs et les demandeurs de ces SE, c’est à dire un marché.
Traduction des fonctions de la nature en tant que services
Cette étape correspond à l’introduction des concepts écologiques dans les décisions économiques afin de susciter les intérêts de ceux qui en bénéficient à préserver les ressources qui les génèrent. Elle définit en outre et à priori une approche utilitariste qui met en évidence les liens incontestables des « bénéfices » tirés des fonctionnalités de la nature sur le bien-être. Cette approche permettrait notamment d’atténuer les conflits de valeurs 2. Costanza et al. (1997, cités par Peterson et al. 2010, p. 114) avaient éstimé les valeurs monétaires de 17 SE issus de 16 communautés écologiques aux alentours de 16-54 trillions USD par an, avec une valeur moyenne de 33 trillions USD. 18 entre les intérêts environnementaux et les intérêts économiques : si le fait de ne pas défricher les forêts par exemple devient plus qu’économiquement souhaitable pour ceux qui gèrent ces forêts par rapport au fait de les défricher, il n’y aurait aucune raison pour eux de les défricher ! C’était suivant ce même raisonnement, rendre économiquement profitable la préservation des ressources naturelles, qu’on avait instauré des marchés pour les différents types d’effets externes générés par ces ressources. Comme Goulder et Kennedy (1997, p. 24) l’avaient évoqué : Une majorité de types d’approche de valorisation est représentée par des points de vue anthropocentriques : les éléments de la nature sont valorisables dans la mesure où ils servent le bien-être humain d’une manière ou d’une autre. (traduction de l’auteur) Partant de cela, la traduction des fonctions écologiques en termes économiques durant les années 70 et 80 était motivée essentiellement pour communiquer la dépendance des hommes vis-à-vis des écosystèmes (Gómez-Baggethun et al., 2009). Daily (1997, p. 3) définissait d’ailleurs les SE comme étant les structures et les processus par lesquels la nature et les espèces qui les constituent, soutiennent et satisfont l’existence de l’homme. Daly et Farley (2004) soulèvent un point de vue plus global en avançant que, non-seulement les fonctions de la nature sont et seront utiles pour l’homme mais aussi pour les ressources qui les produisent ; c’est à dire, ces fonctions permettent aux ressources de se renouveler.
Une unité d’échange standard
Le déploiement des études des valorisations monétaires des effets externes a permis d’instaurer une unité d’échange standard qu’est la monnaie étant donné que les SE sont maintenant considérés comme des externalités. Les analyses coûts-bénéfices étendus par exemple peuvent montrer les coûts engendrés (ou les bénéfices perdus) par la perte/ ou la diminution des flots des SE sur une certaine activité économique (agriculture par exemple). Les autres techniques utilisées pour valoriser les SE renvoyaient d’ailleurs l’unité de mesure à la monnaie. Par exemple, pour le cas de la provision de facteurs de production, la méthode par les coûts évités est la principale référence (Goulder et Kennedy, 1997).
Paiements et Marchés
La mobilisation sur le marché correspond à l’étape final de la marchandisation des SE. La notion de droit de propriété initialement établie par Coase (1960) et puis introduite dans le domaine de la dégradation des ressources naturelles par Hardin (2009 (1968)) a concrétisé l’appropriation des SE. Coase (1960) avançait l’idée que les problèmes d’externalité peuvent être abordés via des négociations « marchands » entre les parties, indépendamment de l’attribution du droit de propriété (zéro coûts de transaction) ; tandis que Hardin (2009 (1968)) suggérait que les problèmes de surexploitation des ressources peuvent être solutionnés par la privatisation de celles-ci. Ces deux points de vue suggèrent l’existence d’une distribution initiale des droits de propriété (coûts de transaction nuls) à la fois sur les effets externes et les ressources qui les génèrent. Ainsi, il ne reste plus qu’à établir les institutions qui mobiliseront les transactions entre les parties (relier l’Offre à la Demande, le plus souvent au moyen des intermédiaires). Les paiements pour les services environnementaux ou PSE Le Costa Rica fut le pionnier de l’application des paiements à l’échelle nationale, lancé en 1997, et connu sous 19 la dénomination de PSA (Pago por Servicios Ambientales). Ce programme national ciblait 4 SE rendus par la forêt que sont : (1) la séquestration de carbone par la biomasse et les sols, (2) la protection de la biodiversité, (3) la provision de l’eau et (4) la protection des paysages (Pagiola, 2008). Pour ce pays, l’existence de diverses institutions 3 déjà en place avait favorisé le lancement du PSA. De plus, la législation du pays intègre (et valorise ainsi) les services rendus par la forêt (Loi forestière no. 7575 adoptée en 1996) ce qui facilita l’instauration et la mise en oeuvre du PSA (Pagiola, 2008.). Cette loi permettait également aux fournisseurs de SE d’être payés de manière légale pour les SE sécurisés. Les marchés pour les services environnementaux ou MSE Les MSE ont connu une expansion rapide chez les pays développés. Favorisés par l’établissement des politiques de régulation environnementales, et des institutions collectives, les promoteurs des MSE argumentaient le fait que le marché permet l’usage efficient des ressources naturelles (Daily, 1997). Dans ses débuts, le principal fonction de ces marchés consistait à l’obtention et à l’échange de permis d’investissements productifs en contre partie de la réalisation d’autres investissements qui permettraient d’annuler les déséconomies externes provoquées par ces investissements productifs. Tel est par exemple le cas du WMB (Wetland Mitigation Banking) établi aux Etats-Unis en 1991 dans le but d’achever les objectifs du CWA (Clean Water Act). Le WMB consistait à accorder des permis permettant d’allouer les terrains humides sujets à la régulation à des particuliers à condition que ces derniers restaurent d’autres terrains antérieurement exploités. Ce mécanisme est connu sous le nom de mitigation compensatoire (Robertson, 2004). L’objectif principal de l’instauration du WMB était de mitiger la dégradation des terrains humides. Les marchés carbones quant à eux virent le jour vers le tout début du XXIème siècle. Ils consistaient à établir des dispositifs d’échange et de négociations de crédits d’émission. Chapeautés par la Convention sur le Changement Climatique, chacun des gouvernements des pays concernés édifiaient à cet effet les institutions nécessaires aux différentes transactions. Ces institutions généralement permettent à ceux qui entrent dans ces formes de transaction de sécuriser les services qu’ils achètent 4 . Tel est le cas par exemple du Royaume-Uni à travers le ETS (Emission Trading System) ou pour le Chicago -le CCC (Chicago Climate Exchange) mais cette fois-ci, lancé par une compagnie privée (Gómez-Baggethun et al., 2009). Les MSE atteignirent la scène internationale avec le lancement du système de marché de permis européen en 2005 (Gómez-Baggethun et al., 2009).
I Implications Institutionnelles d’un dispositif PSE |