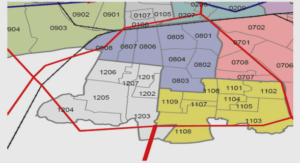Modélisation de la stabilité des blocs rocheux isolés sur la paroi des excavations souterraines
La série télévisée : un (mauvais) objet sociologique ?
De quoi parle-t-on ? Aujourd’hui couramment mobilisée dans les conversations ordinaires et les médias, l’expression « série télé » est une expression générique renvoyant à une diversité de programmes. Fondamentalement, la série renvoie à toute forme de fiction plurielle séquencée en épisodes, produites par et pour la télévision. Selon Stéphane Benassi, comme son nom ne l’indique qu’à moitié, la série télé oscille en réalité entre les deux formes « naturelles » : la « mise en feuilleton » et la « mise en série » 5 . L’auteur s’appuie sur la définition qu’en a donné avant lui Noël Nel : la première est une « opération de dilatation et de complexification de la diégèse ; étirement syntagmatique du récit qui conserve l’écoulement inéluctable du temps ». La mise en série est quant à elle une… « …opération de développement diégétique par déploiement de nombreux possibles d’un héros permanent ou d’un horizon de référence, cadre mémoriel constant ». (…) « Un regroupement sous un même titre générique de microrécits (ou épisodes), qui sont autant de formes fictionnelles narratives possédant chacune leur propre unité diégétique, mais dont le(s) héros et/ou les thèmes sont récurrents d’un micro-récit à l’autre. » 6 À la suite de Nel, Benassi va chercher à dégager toutes les formes syntaxiques des téléfictions présentes en France pour les constituer en genres et ainsi élaborer une classification générique des fictions télévisées. Il va ainsi construire ses catégories selon deux sortes de classifications génériques, la logique de programmation et la logique spectatorielle, en examinant autrement dit les instances émettrices et les instances réceptrices. L’auteur construit sa typologie à partir de « la triple rencontre des logiques spectatorielles propres à la réception des feuilletons et séries, d’une approche sémiologique basée sur la distinction, opérée par Noël Nel, entre invariants et 5 Benassi, Stéphane (2000), Séries et feuilletons TV. Pour une typologie des fictions télévisuelles, Éd. du Céfal, Liège. 6 Nel, Noël (1990), « Téléfilm, feuilleton, série, saga, sitcom, soap opera, telenovela : quels sont les éléments clés de la sérialité ? », CinémAction, n° 57, Corlet/Télérama, p. 64-65. CHAPITRE 1 — 52 — variations dans les fictions télévisuelles et de l’inscription de ces genres dans la logique de flux propre à la télévision » . De là, il établit un répertoire sophistiqué composé d’une dizaine de genres téléfictionnels, du « feuilleton de prestige » à la « série classique » en passant par le « feuilleton AB » (du nom de la société de production éponyme à qui l’on doit notamment Hélène et les garçons ou encore Premiers Baisers) et la « série de la quête composée de micro-récits à séquences finales proleptiques »… Jean-Pierre Esquenazi distingue pour sa part entre « séries immobiles » et « séries évolutives » et privilégie un principe de classification reposant sur l’ajustement des séries à leur fonction et « leur gestion narrative du principe pragmatique qui les définit comme des « séries » » 8 . Ainsi, les séries immobiles impliquent la répétition d’une même structure narrative éludant le passage du temps historique (e.g. le héros toujours égal à lui-même à l’image d’un Columbo ou d’un Mac Gyver). Elles comprennent la « série nodale », le « soap opera » et le « sitcom » : « La narrativité nodale de Columbo ou de Law & Order, la logorrhée persistance du soap, les plaisanteries dupliquées du sitcom sont autant de façons différentes de retenir le temps narratif et de construire ces chaînes narratives qui n’ont de clôture que fictive » 9 . Les séries évolutives quant à elles accompagnent inversement « le mouvement du temps qui rythme la vie humaine en en faisant une donnée narrative » 10 . Esquenazi y distingue la « série chorale » (soit, la biographie d’un collectif : Urgences, NYPD Blues, Ally McBeal) et la « série feuilletonnesque », cette dernière elle-même composée du « feuilleton pur » (24 heures chrono), de la « série à énigme » (Lost, Le Caméléon) et de la sériefeuilleton marquée par « une fatalité ou un poids » (The Shield). Le traitement différencié du soap-opera éclaire particulièrement la différence analytique existante entre les perspectives de Benassi et Esquenazi. Pour Benassi, le soap-opera est caractéristique du feuilleton – ce qui le situerait plutôt du côté des formes évolutives – tandis que pour Esquenazi, sa capacité à alentir l’action l’inscrit au rayon des fictions immobiles – et donc des séries selon la terminologie de Benassi. Le genre donne à voir, selon Esquenazi, « le paradoxe d’un récit suspendu, interminable, en perpétuel devenir et opérant pourtant une répétition continue du passé » 11. Jean Mottet livre une vision analogue : « Sans mémoire, avec peu de préoccupations quant à l’avenir, les personnages sont ainsi dispensés de réagir. Aussi détestent-ils prendre des décisions et il leur faut parfois plusieurs mois pour savoir s’ils vont tomber amoureux, se fiancer, se marier – pour finalement ne rien décider ».
La série comme mauvais genre culturel ?
Constatant le récent engouement français pour les séries depuis une décennie, Esquenazi souligne toutefois la relative méconnaissance, mère de mépris, toujours en cours à leur égard17. Symbole du phénomène mass media et de ses écueils supposés, la télévision et ses programmes ont fait ordinairement en France l’objet de frondes d’autant plus vives qu’elles se basent en général sur une relative ignorance. La sociologie française au premier chef, très empreinte d’une vision critique et légitimiste des productions issues des industries culturelles, a traditionnellement fait peu de cas des séries télévisées, sinon pour en souligner leur médiocrité. Fort d’une grande érudition cinématographique et télévisuelle – conférant d’autant plus d’autorité à son propos –, Esquenazi invite à reconsidérer la valeur esthétique, sociale et politique des séries et, partant, à les envisager avec toute la rigueur propre à l’appréciation d’autres formes culturelles supposément plus « pures » : « nous avons voulu rétablir ce qui n’aurait jamais dû cesser d’apparaître comme une évidence : les séries sont fabriquées selon un processus peu différent de toute production culturelle ou artistique » . À contrepied d’une inclinaison hexagonale à déconsidérer a priori et par défaut toute fiction télévisuelle, Esquenazi montre combien elles peuvent constituer d’authentiques projets esthétiques. Comme un symptôme de cette dépréciation, il note l’absence de pendant français au terme anglais mediacy, désignant nos compétences en matière de télévision, nos savoirs acquis au contact prolongé des programmes télévisés. Dans une autre démarche, Benassi porte une ambition similaire19 . Il souhaite clarifier, à partir d’une analyse narratologique et pragmatique, l’hétérogénéité des formats de fiction et ainsi établir une classification plus fine des genres téléfictionnels. Cette clarification contribuerait à l’émergence d’un regard critique sur le média télévision et, finalement, à la formation d’une « téléphilie ». Bien que distinctes, ces deux contributions militent en faveur d’une juste considération des séries. Esquenazi d’affirmer : « Il est, semble-t-il, grandement temps de ne plus négliger la place qu’a prise pour de très nombreux publics le genre [sériel] et de se donner l’appareil méthodologique afin de pouvoir la mesurer » 20. Benassi questionne pour sa part : « Où sont les Cahiers de la télévision, gardiens de l’esthétique télévisuelle ? ». Cette ambition ressortie moins des récentes évolutions en matière de séries (bien qu’elles soient aussi considérées, comme la hausse des investissements et donc de la qualité générale des séries contemporaines chez Esquenazi ; et le phénomène d’hybridation des formes sérielles chez Benassi) que d’une position de principe vis-à-vis de la télévision en général (d’hier et d’aujourd’hui) et de ses différents programmes (sans préjuger de leur qualité)21. L’un et l’autre répliquent, chacun à sa manière, au front ordinaire de mépris, de jugements approximatifs et de raccourcis simplistes qui entourent selon eux trop souvent le petit écran. En d’autres termes, la télévision et les séries méritent mieux que des réquisitoires expéditifs dénués de véritable argumentation ; elles requièrent au contraire un examen minutieux et averti de la part des sociologues. Très empreinte d’une vision critique, spéculative et normative, issue des tenants de l’École de Francfort et de la théorie des effets forts des mass-médias sur leur public, la tradition sociologique française s’est longtemps montrée réticente à investir l’expérience télévisuelle. La dénonciation des effets d’aliénation et de mystification du public inhérents à la montée des industries culturelles22 aura abouti à une tendance à la dénégation sociologique des publics mass-médiatiques. « Ce qui grève en général la prétention des séries à accéder au rang de « huitième art », ce sont les conditions avilissantes de leur réception. »
La série à la croisée des mondes
Plus largement, le projet de Buxton de mettre au centre de l’analyse le statut marchand des séries comporte le postulat – discutable – que celles-ci, par les modalités industrielles de leur production (comme si le cinéma ou la musique ne relevaient pas de telles logiques marchandes !?), ne peuvent prétendre au statut d’ « œuvre ». Elles seraient de plus dépourvues de tout projet social et arboreraient au contraire une « passivité idéologique », dont l’avènement de la série feuilletonnante aurait d’ailleurs selon Buxton conforté la tendance. On le voit, tout dans les séries, de leur production à leur réception en passant par leur contenu et leur format, contribueraient aux yeux du sociologue à rendre les séries étrangères au monde de l’art – reconduisant par là-même la fable d’une sphère artistique pure, c’est-à-dire débarrassée de toute considération et coercition extérieures. Mais, s’il ne propose pas d’éléments concrets pour soutenir sa thèse d’une réception sérielle avilie, il démontre à l’inverse une grande connaissance de l’histoire économique des séries. Il néglige pourtant quelques travaux d’histoire culturelle majeurs ayant mis en lumière les relations étroites et complexes qu’entretiennent les sphères artistique et marchande depuis des siècles25 . Interrogeant les contrats liant les peintres du Quattrocento avec leurs clients, Michael Baxandall a par exemple montré que la valeur artistique d’une œuvre et les conditions de production marchandes ne sont pas exclusives l’une de l’autre, au contraire. Et, bien que l’art contemporain se soit progressivement établi sur un principe de rupture26 et d’innovation27, l’idée selon laquelle le « véritable » artiste se voit dégagé de contraintes extérieures a été mise à mal : qu’un artiste souhaite diffuser et même vendre le fruit de son activité et il devra se plier à un ensemble de règles dictées par d’autres (marchands, critiques, conservateurs, etc.) et conformer en partie au moins son « art » à la demande. De diverses manières, cela valait pour le peintre français ou italien à l’époque de la Renaissance, cela a valu pour le romancier populaire du XIXe siècle28, cela vaut de nos jours encore concernant les scénaristes de télévision29 . Dominique Pasquier justement, au gré de son enquête auprès des scénaristes français, met en exergue une problématique centrale de l’activité des industries culturelles, à savoir : comment concilier le caractère artistique des œuvres télévisuelles (la créativité) avec des exigences de rationalité économique (les bénéfices financiers). Le scénariste est en ce sens symptomatique de la tension inhérente aux industries créatrices d’être à la délicate croisée de deux mondes, les mondes « industriel » et « inspiré » auraient dit Luc Boltanski et Laurent Thevenot30. Il est ainsi confronté à l’injonction paradoxale d’avoir à répondre simultanément à des attendus industriels et culturels, qu’il lui incombe de faire tenir ensemble à l’intérieur de son activité. Les tenants de l’histoire culturelle ont par ailleurs souligné l’importance de s’intéresser aux usages, aux pratiques réceptives, à la formation des goûts car ils sont une composante au moins aussi prégnante de la valeur et des significations des œuvres. Loin d’être des objets stables, les œuvres, leur sens, leur forme et la valeur qu’on leur confère ne cessent d’être reconfigurés31. Pour en saisir les contours, il nous faut examiner donc de façon concomitante l’œuvre et ses publics, ses processus de production comme de réception (voir l’introduction). Malgré cela, Buxton exclut de ses considérations le récepteur qui, tel qu’envisagé par la théorie des effets, disparaît ainsi noyé dans une foule passive et mythifiée.
Des séries en vue : un « âge d’or » venu d’Amérique |