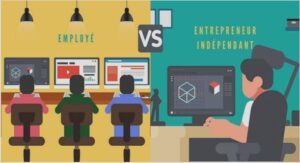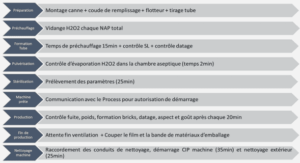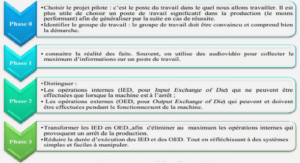Mutations du politique et nouvelles formes de
légitimités
L’Ambivalence des discours
Communication politique, actes de persuasion Les rituels ont été amplement étudiés dans le contexte religieux ou dans celui du mythe44 . Mais d’autres courants, notamment portés par les anthropologues américains « post-modernes » Marshall Sahlins ou encore Clifford Geertz , permettent une approche de la dynamique culturelle et sociale de la société et offrent la possibilité d’appréhender le poids des rituels dans la symbolisation culturelle et la communication sociale. D’autres auteurs, tels que Pierre Bourdieu ou Richard Schechner développent l’aspect pratique et performatif de la mise en scène des rituels. Dès lors, l’ambition est d’observer « les formes de l’agir rituel qui permettent aux communautés de se former, de se maintenir, de négocier leurs conflits » (Wulf, 2005 : 11). De nombreuses disciplines se sont intéressées au rituel en tant qu’action symbolique, sa définition demeure cependant très complexe, le rituel étant un concept polysémique. L’apport de ces différentes sciences humaines : science politique, sociologie, histoire, psychologie, anthropologie, permet malgré tout d’interroger une réalité essentielle à toute société humaine. Il est de plus intéressant de cerner la définition étymologique du terme, qui renvoie au latin ritus, c’est à dire au culte religieux mais également aux coutumes fixées traditionnellement. Le rituel possède une dimension collective et en instaurant une coupure entre temps quotidien et temps ritualisé, il marque la vie sociale et les périodes importantes d’une société (Yannic, 2010 :12). L’apport de la sociologie de Pierre Bourdieu a été essentiel, le rituel étant pensé chez l’auteur en relation avec une théorie de la représentation et de la reproduction sociale. Le sociologue met en avant une vision du rituel qui consacre et institue une différence en tant que propriété sociale et symbolique (Bourdieu, 1982 : 24). La représentation politique est pour Bourdieu d’abord affaire de croyance, le système n’est maintenu que par la croyance partagée, le rituel devient un acte de « magie sociale ». Le pouvoir que l’on décèle chez les acteurs de la politique locale à travers l’exercice de la parole est efficace grâce à leur position sociale : « Le pouvoir des paroles n’est autre chose que le pouvoir délégué du porte-parole, et ses paroles — c’est-à-dire indissociablement, la matière de son discours et sa manière de parler — sont tout au plus un témoignage et un témoignage parmi d’autres de la garantie de délégation dont il est investi » (Ibid : 105). Pour Yves Winkin (2001), la communication peut être perçue comme un système à multiples canaux auquel les individus participent par une communication verbale et non verbale. Chaque individu va ainsi faire partie d’un orchestre culturel. La communication est composée de deux racines : cum et munus signifiant mise en commun, partage, communion. La communication est alors perçue par l’auteur comme un échange symbolique. Cette notion s’est révélée essentielle à l’appréhension des échanges lors des pratiques rituelles rencontrées sur le terrain. Je compte par la suite analyser cet aspect sous la perspective proposée par Erving Goffman présentant la vie sociale sous l’angle d’une théâtralisation, au sein de laquelle les acteurs jouent le rôle qui leur est imparti (Goffman, 1974). Les cérémonies par exemple sont organisées de telle manière que l’on peut évoquer la notion de rites, grâce à la présence d’une multiplicité de séquences et une certaine dimension religieuse. « Nous avons bien affaire ici à des rites dans toute l’acception du terme. Morcellement, répétition, d’un autre côté ; dramatisation de l’autre : tout concourt à produire le « piège à pensée ». De même, nous retrouvons à l’oeuvre les quatre ingrédients, sacralité, territoire, primat des symboles et valeurs collectives » (Abélès, 2007 : 53). La cérémonie en hommage aux enfants héros morts pendant la guerre contre les ÉtatsUnis (1846-1848) est tout à fait révélatrice de cette ritualisation fonctionnant comme le « piège à pensée » développé par Marc Abélès. Il s’agit ici d’un rite cérémonial semblable aux rites religieux réglé par la coutume, appréhendé comme une confirmation d’appartenance avec des 129 activités très formalisées possédant ses propres codes et symboles. Quelques jours avant le 13 septembre, on me prévient de la nécessité absolue d’être devant le palais municipal à huit heures précises ne devant louper pour rien au monde la levée de drapeau en hommage aux enfants « du castillo de Chapultepec ». Je me suis dès lors renseignée sur cette bataille qui semble rallier tous les habitants de cette commune avec ferveur. La bataille de Chapultepec s’est déroulée le 12 et 13 septembre 1847 durant la guerre entre les États-Unis et le Mexique au château de Chapultepec qui garde l’approche ouest de la ville de Mexico. Ce château était une académie militaire dans laquelle étudiaient plusieurs centaines de jeunes ayant participé à la bataille. Six d’entre eux auraient refusé de fuir devant l’ennemi alors que le général ordonnait la retraite et le dernier encore en vie se serait enroulé dans le drapeau mexicain avant de se jeter de la muraille. Il n’existe pas d’éléments concernant cette période historique mais elle possède ici une force symbolique incroyable. Je comprends à travers le discours du président face au drapeau mexicain qu’elle est même utilisée pour justifier l’importance de défendre corps et âme, les valeurs ancestrales et les coutumes de la commune en hommage à ces enfants. J’arrive donc à huit heures du matin sur la place face au palais municipal alors que de nombreuses personnes sont déjà présentes. Des dizaines d’enfants en uniforme scolaire sont invités à se ranger correctement, en file bien droite, à un bras de distance les uns des autres. Dans un silence solennel, de nouveaux enfants entrent en « scène », six jeunes filles portent un uniforme différent et précèdent le reste du groupe, elles ont le visage figé et ferme, marchent au pas militaire, scandant des ordres au reste du groupe sur le même ton. Derrière le groupe, une fanfare d’enfants avance également d’un pas militaire. Deux classes différentes semblent se faire face, les six jeunes filles reçoivent alors le drapeau mexicain face aux membres de la présidence municipale et de l’alcaldía (bureau du juge). Elles avancent, drapeau tendu et font le tour de la place, puis l’attachent au mât sur lequel il est habituellement accroché. Les membres de la présidence et de l’alcaldía débutent alors de longs discours sur l’importance de la défense de la patrie, le courage de ces enfants face à l’envahisseur étranger, sur l’importance du nationalisme et des hommages et de finir sur un « viva San Sebastián Tutla », tout à fait étonnant en ce jour de commémoration nationale. A travers cette observation de terrain, on saisit toute la pertinence pour les détenteurs du pouvoir de permettre aux enfants de la communauté d’intérioriser les valeurs liées à l’organisation des systèmes de pouvoir. « Ce substrat de valeurs très tôt intériorisées, (…) délimite également les frontières du plus ou moins admissible socialement, du plus ou moins aisé à transgresser, des 130 Cet exemple, comme tous les actes de communications culturelles de la part des membres du palais municipal de San Sebastián Tutla souligne l’interprétation que nous pouvons faire du renforcement d’un lien identitaire double, national et local. En effet, la cérémonie de los niños heroes, célébrée dans tout le pays comme symbole de la puissance nationale est également ici l’occasion d’appartenir à une communauté indigène valeureuse. fidélités ou des ruptures (qualifiées, le cas échéant, de reniements) et constitue ainsi la fondation d’un habitus au sens où l’entend Pierre Bourdieu » (Martin, 2003 : 93).
Un quotidien loin des considérations indigénistes
J’arrivais donc armée de mes plus beaux ouvrages sur l’indigénisme mexicain, les luttes zapatistes et les réformes ayant conduit à l’avènement de ce que les acteurs locaux et internationaux ont nommé « la démocratie communautaire ». L’idée principale en arrivant était de trouver de quoi me restaurer. En effet, il me semblait évident que le partage d’une assiette, d’un verre avec des habitants locaux ou même quelques discussions avec une serveuse ou serveur me permettrait un premier point d’ancrage et sans doute trouver un logement plus intéressant pour la recherche que mon petit hôtel du bord du périphérique. Ce fut chose faite et l’inspiration était la bonne. Me voilà donc dans le restaurant de Mikaëla, de nombreuses fois citée dans ce travail, qui sera une interlocutrice privilégiée et une amie. Comparée au reste du village observé, on pourrait dire que la famille de Mikaëla vit relativement à l’aise. Il en existe de plus riches mais plus excentrées du village. Les maisons du centre sont conformes à la conception de l’espace de l’architecture espagnole traditionnelle. Elles sont ainsi préservées de l’extérieur et les petits blocs de logements ou sanitaires de la famille sont construits autour d’une cour centrale avec un mur assez haut entre la cour et la rue. Une autre partie du logement de cette famille a été construite comme une annexe, correspondant à une sorte de garage situé sur la droite de leur cour et permettant d’ouvrir le seul petit restaurant de la place centrale. Je reste ainsi quelques heures à entrer en communication avec quiconque entre se restaurer ou avec les enfants de la responsable. Cependant, mon principal soutien dans ce premier jour d’approche restera Mikaëla. Je m’amuse de la voir m’observer quand je mange et tourner la tête dès que je veux la regarder ou sourire. Mais après quelques temps, n’y tenant plus, elle s’approche et nous discutons un très long moment sur les raisons de ma venue, mon pays d’origine, la couleur de mes cheveux ou mon absence d’enfant. Ses deux enfants deviendront de petits élèves disciplinés et attentifs à mes besoins avant même que je n’ai eu le temps d’en exprimer et je vais rapidement me sentir ici comme chez moi. Cet endroit me permet de comprendre le fonctionnement d’une famille centrale de San Sebastián Tutla et sa situation me donne à voir un grand nombre d’habitants du village sans avoir à trop arpenter les rues. J’aurai donc ici l’occasion de retrouver un peu de chaleur familiale et de comprendre le vécu des « indigènes en lutte » avec lesquels j’étais venue comprendre les mutations politiques en cours. 138 Alors évidemment, j’ai été quelque peu déçue lorsqu’à mes multiples questionnements sur le fonctionnement d’une mairie « indigène » ou sur les pratiques communautaires, Mikaëla me répondait invariablement : « Je ne sais pas Marjo, je ne suis pas d’ici moi et arrête avec ces pratiques communautaires ou indigènes, ils ne respectent rien ici ». Je décidai alors d’observer plutôt que de questionner. Mais force était de constater que le quotidien n’avait rien de bien différent de ce que j’avais pu observer dans les ruelles de la ville de Oaxaca ou de celles de Puebla, y ayant vécu pendant un an l’année précédente. Les enfants se lèvent à 7h et enfilent leur uniforme scolaire, semblable à tous ceux des alentours, ils déjeunent téléphone posé devant un bol de céréales et un verre de jamaica47 . Puis ils partent main dans la main pour rejoindre l’école du village, bariolée de lettres géantes de toutes les couleurs, de toboggans et de cabanes en bois. Le retour se fait en début d’après-midi et si j’ai rapidement pris l’habitude de les attendre pour prendre le repas en famille seulement vers 15h, les matinées me permettaient de dialoguer avec les femmes du village. Dans ce petit bourg paisible, ce sont les femmes qui font tourner l’économie locale. Chaque garage semble avoir été transformé en zone de commerce temporaire, épicerie, laverie, restauration, etc. J’ai donc ainsi passé plusieurs semaines à partager ce simple quotidien, me permettant malgré tout une fine connaissance des rythmes journaliers et rassurant les habitants sur ma présence parmi eux. Lors des matinées, je n’ai pu côtoyer que très peu d’hommes, travaillant principalement hors du village. Les femmes ont mis en place tout un système d’entraide et je m’amuse de voir les petits derniers des fratries qui ne sont pas encore à l’école, déambuler d’une maison à l’autre en toute sérénité. Pour mes deux derniers séjours, j’étais avec ma fille de 6 mois, puis de 18 mois et cela a permis d’approfondir nos liens et les femmes avec lesquelles je dialoguais m’ont clairement annoncé la couleur : « te voilà enfin femme, nous allons pouvoir parler ». L’intimité créée grâce aux multiples séjours effectués et à la présence de mon enfant a en effet développé des relations étroites et nous sommes avec un grand nombre d’entre elles devenues assez proches. Le terrain est ainsi devenu au fil des semaines, un second foyer et je me suis sentie suffisamment à l’aise pour aborder la complexité de leur rapport à l’identité ou à leurs identités. Assise près des machines à laver de Paula que j’observais quotidiennement prendre les commandes, j’analysais les tenues apportées et les dialogues entamés. Un verre à la main, le 47 Boisson à base de fleur d’hibiscus, très présente dans tout le Mexique. 139 soir, en compagnie de Mikaëla et de sa famille, j’appréhendais les rituels alimentaires, les discussions familiales informelles et l’éducation des petits. Avec Josefina, la vendeuse de fruits et légumes, je guettais les paniers, les achats et les discours des femmes portant leurs petits, sacs à la main, pouvant ainsi rester des heures sur un même sujet de discussion. Il me fallut un temps incroyable pour saisir les relations de parenté entre toutes. Elles semblaient ainsi toujours évoquer en parlant de la voisine, « la tante », « la cousine » ou « la marraine ». Être parmi elles, c’était faire partie d’une immense famille aux limites floues mais dont l’étroitesse des relations permettait un confort dans les déplacements et les discours. Mais malgré tout ce quotidien vécu, les repas partagés, les discussions et les rumeurs entendues, pas de traditions mises en avant, pas de pratiques indigénistes évoquées. Il fallait donc demeurer humble face à ma quête et mes évidences préalables. Leurs journées étaient rythmées par les heures d’école et les tâches ménagères et pour tout dire celles-ci demeuraient très familières à la mère que j’étais devenue. Même les aliments choisis pour les petits : soupe de légumes et galettes de maïs ou encore les sucreries distribuées aux plus grands rentrant de classe ne m’étonnaient guère. Les tenues vestimentaires quotidiennes étaient calquées sur les modes américaines et nous pouvions amplement divaguer sur les tailles basses de nos jeans respectifs. Les télévisions perpétuellement allumées scandant des spots publicitaires et autres séries américaines à l’eau de rose ne m’apprendraient rien des cultures locales. Dans la famille de Mikaëla, je côtoyais la grand-mère, une femme de plus de soixantedix ans, fière et solide qui portait à bouts de bras toute une famille de femmes et trois petits enfants dynamiques. Ses deux filles étaient parties aux États-Unis quand leurs enfants étaient petits et c’est donc « l’abuela » (grand-mère), qui a géré tous les enfants. Pour être tout à fait honnête, je n’ai jamais su son prénom, tous l’appelaient abuela et ce fut également mon cas. Elle était toujours en jupe longue, de longues nattes grises tombant sur les épaules, ses mains vous contaient tout un monde à elles seules. Assise autour de la même table à longueur de journées, elle savait tout du village, des rumeurs, des anciennes et des nouvelles pratiques, elle menait ses troupes à la baguette et le respect qui lui était voué semblait sans limite. Pas une seule fois je ne pus m’arrêter sans être invitée à manger et elle en profitait pour me garder auprès d’elle durant des heures pour me raconter tous ses souvenirs. Ce furent là sans doute les moments les plus agréables de mes voyages. Ainsi, elle me raconta les histoires de sa mère préparant à la main les tortillas de mais, le temps qu’il fallait pour moudre les grains au moulin du village. Elle me conta les rires des enfants et son père, cet homme robuste travaillant au champ 140 et tuant les poules à la main. Les tenues confectionnées par les grands-mères du village. Finalement, tout ne semblait pas avoir changé. J’observais toujours les mamies tuer les poules dans les cours pour les vendre et les hommes partir au champ. Mais ces constatations lui déplaisaient fortement. D’après elle, si, tout avait changé. Les tenues dites traditionnelles s’achetaient dorénavant sur des marchés touristiques de Oaxaca, sans qu’on ne connaisse les lieux de fabrication, les tortillas étaient achetées et les hommes partaient pour la plupart aux États-Unis ramener de l’argent, seuls les anciens travaillent aux champs. Cette douce nostalgie qu’elle évoquait ne faisait cependant jamais mention d’une quelconque culture indigène à part entière. Elle parlait alors de la « culture des anciens ». Figure 23 : l’abuela qui s’amuse avec ma fille (Source : photo personnelle) 141 J’ai rapidement choisi d’évoquer avec elle, les pratiques politiques locales, qui me semblaient sans doute être les plus représentatives d’une culture revendiquée comme étant indigène. Mais là encore, outre sa nostalgie de véritables pratiques traditionnelles, le système de charge et le vote communautaire n’avaient pour elle rien de luttes politiques mais correspondait simplement à une logique traditionnelle. Elle ne voyait par le passé pas d’enjeux politiques dans ce fonctionnement, c’était une façon de faire « tourner la machine », de permettre à tous les habitants du village de jouir d’un quotidien agréable et de responsabiliser chacun au bien-être de tous. Elle était en revanche d’accord avec le fait, qu’aujourd’hui les discours autour des pratiques communautaires s’étaient politisés et que les dynamiques de pouvoir n’étaient plus les mêmes. Elle déplorait ses conflits violents mais d’un autre côté, considérait malgré tout que donner le droit de vote ou intégrer les habitants du quartier d’El Rosario reviendrait à dissoudre toutes leurs traditions. J’évoquais alors assez librement, le choix des représentants politiques de San Sebastián Tutla produisant des discours indigénistes et réifiant la culture zapotèque pour évincer les opposants politiques. La réponse formulée par l’abuela est à elle seule révélatrice des ambivalences locales, je cite : « Que veux-tu, il faut bien qu’on s’en sorte, et puis après tout c’est dans la constitution, on se bat avec les armes qu’on nous a données »
« Jour d’élection » : le recours aux indigénistes
Puis vint le jour des élections avec leurs lots d’angoisses locales et de tensions. Il a fallu distribuer les tracts pour prévenir de la date, des rencontres, des débats. Il a également fallu que le véhicule équipé de mégaphone fasse le tour du village pour annoncer toutes les manifestations à venir. Seulement voilà, les acteurs politiques en charge de la communication n’avaient paraît-il pas le temps de passer par le quartier d’El Rosario. Nous étions alors en décembre 2016, j’avais ma petite fille de quelques mois et mes relations avec les habitants de San Sebastián Tutla étaient très cordiales. Faire part de mon étonnement était devenu chose familière pour la plupart d’entre eux et ils s’amusaient même de me voir entrer chez eux avec l’envie de parler. A peine arrivée, nombreux étaient ceux m’interpellant directement par un « que pasa de nuevo48 », familier et bienveillant. Je formulais alors en ces jours de tensions politiques, mes incertitudes quant à la non-information des habitants du quartier à loyers modérés des élections 48 Que se passe-t-il encore ? 142 à venir. Chacun me répondait alors, qu’il ne fallait pas que j’en sois troublée, il était apparemment évident qu’ils ne se souciaient pas de ces élections et qu’ils n’avaient pas leur mot à dire, ne partageant pas les charges communautaires et le quotidien des débats publiques. De l’autre côté de la frontière symbolique séparant les habitants du centre du village et ceux du quartier d’El Rosario, le discours était différent et les plus engagés se préparaient déjà à la lutte à venir, s’armant de textes de lois pour judiciariser ces oppositions. La judiciarisation du conflit électoral de San Sebastián Tutla est précisément ce qui m’intéresse pour saisir la variabilité des discours. L’ambivalence saisie est alors fondamentale pour qui veut comprendre la construction des identités locales et le recours aux grands récits historiques. Comme précisé en amont, le quotidien partagé ne permettait jamais l’évocation d’une culture indigène et aucun habitant avec lequel j’ai pu partager mes journées n’avait évoqué au cours de nos échanges le fait d’être un membre d’une grande famille zapotèque ou d’un groupe ethnique trop longtemps marginalisé qui entendait défendre ses droits en tant que tel. Aucun n’affichait des pratiques différenciées du reste de la population mexicaine avec laquelle j’avais pu avoir de très nombreux contacts après plus de quatre ans à aller et venir dans ce pays. En revanche, face aux procès annoncés par les membres du collectif des habitants unis d’El Rosario, les discours devenaient soudain ceux d’un militantisme indigène exacerbé en lien direct avec les nouvelles dynamiques constitutionnelles proposées par l’État. L’émergence des « us et coutumes » dans l’État de Oaxaca ne peut être saisie sans une prise en compte fondamentale des relations entre les communautés et l’État. Le processus de construction identitaire que je choisis ici d’interroger comme réalité objective de manière ethnographique nous renvoie nécessairement aux interactions avec l’État et aux relations de pouvoir. Comme le soulignent Carlos Agudelo et David Recondo, la volonté n’est pas de nier le rôle majeur des acteurs sociaux et politiques, locaux, nationaux et transnationaux dans les processus d’interaction au sein desquels se construit l’ethnicité comme instrument politique mais de montrer la place centrale qu’occupe l’État dans cette construction (Hoffmann, Rodriguez, 2007 : 75). Le précieux intérêt de leur analyse est de démontrer l’importance que dans les sociétés mexicaines et colombiennes contemporaines, « les identités ethnico-culturelles sont amplement définies par et en relation avec l’État » .
A – Définir les enjeux autour des notions de souveraineté et communauté |