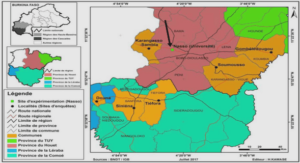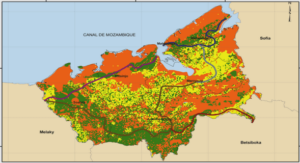Le sujet politique du féminisme, de l’ontologie à la pratique
LE FÉMINISME ET SON SUJET
UNE COURTE HISTOIRE DE L’ESSENTIALISME COMME ANTIFÉMINISME INTRODUCTION DE LA PREMIÈRE PARTIE. Introduction de la première partie. L’objectif de cette première partie est de retracer la manière dont la critique de l’essentialisme s’est peu à peu imposée comme une étape incontournable de la réflexion féministe. Dans l’introduction de cette thèse, j’ai fait le constat d’une convergence étonnante. Dans les théories féministes contemporaines, il est devenu évident de recourir à des termes philosophiquement chargés, tels que celui de sujet ou d’essence, afin de désigner la crise de représentativité du féminisme. Ainsi, le féminisme exclut ses marges en raison de son caractère essentialiste, une affirmation qui ne surprend plus aucun·e théoricien·ne féministe. Il y a pourtant de quoi : à quel moment, et sur quelles bases, cette étrange alliance de l’ontologie et de la métaphysique, d’une part, et de la théorie politique, de l’autre, s’est-elle forgée ? Comment, d’une crise de la représentation politique, en est-on parvenu à une théorie sur les essences, à cheval entre épistémologie et métaphysique ? Depuis les années 90, la thématique de l’essentialisme, et la nécessité de sa critique, apparaissent dans les théorisations féministes comme une évidence, un passage obligé dont l’on ne se donne même plus la peine de justifier la nécessité. À l’inverse, certain·e·s voient dans l’anti-essentialisme et dans la « déconstruction » un énième symptôme des dérives identitaires d’un néo-féminisme qui n’en finit pas de sombrer dans ses propres contradictions1 . À rebours 1 À titre d’exemple, le prestigieux Collège de philosophie a organisé et accueilli, en janvier 0, un colloque intitulé « Après la déconstruction ». Ce colloque affiche d’emblée sont opposition à « la pensée décoloniale, aussi nommée woke ou cancel culture », reprenant ainsi sans recul critique des éléments de langage issus de l’extrême droite. Voir la page de présentation du colloque, sur le site du Collège : « Colloque “Après la déconstruction : reconstruire les sciences et la culture” 7 et 8 janvier 0 », sur Le Collège de Philosophie, 6 décembre 01 (en ligne : https://collegedephilosophie.blogspot.com/01/1/colloque-apres-ladeconstruction.html ; consulté le 1 juin 0). Cet événement était éminemment politique, ne serait-ce que 5 Aux origines d’un tournant ontologique d’un discours enchanté et contre le retour de bâton des antiféministes et de leurs intellectuel·le·s, je propose une généalogie critique de cette panique ontologique, en remontant à ses origines. Je tâcherai, tout d’abord, d’élucider quelques termes associés à ce tournant ontologique – ou plutôt, anti-ontologique – des théories féministes : le post-structuralisme, le postmodernisme, la French Theory, le French Feminism, et la déconstruction. Dans le premier chapitre, j’adopte une approche qui est celle de l’histoire des idées. Ce faisant, je reconstitue le contexte intellectuel qui a favorisé le développement de l’idée suivante : la critique de la métaphysique constitue un modèle adéquat pour la critique sociale. Dans les deux chapitres qui suivent, je propose des monographies consacrées à deux des philosophes parmi les plus influentes dans ce tournant antiessentialiste : Elizabeth Spelman (chapitre ) et Judith Butler (chapitre ). Toustes deux ont pour particularité de prendre comme point de départ le thème de la représentation politique – au nom de qui le féminisme s’exprime-t-il ? – pour le déplacer sur le terrain de l’épistémologie, pour la première, et de la métaphysique, pour la seconde. Dans un cas comme dans l’autre, ce déplacement permet de faire de l’essence le problème principal sur lequel achoppent les prétentions féministes à représenter toutes les femmes. Elizabeth Spelman critique les méthodes de certaines théoriciennes féministes, qui conduisent à un déficit de représentativité de leur catégorie « femmes ». Elle en déduit que le problème vient du fait que notre épistémologie est fondée sur une ontologie défectueuse : nous appréhendons les catégories sociales comme des essences. Judith Butler affirme que l’exercice de la représentation politique repose nécessairement sur ce qu’elle appelle une « métaphysique de la substance » : l’illusion selon laquelle le sujet représenté existe antérieurement à sa représentation, lorsqu’en réalité, il est créé par ce processus. Ainsi, Spelman comme Butler placent l’enquête ontologique au cœur de la théorisation politique. parce qu’il fut ouvert par une conférence de l’ancien ministre de l’éducation nationale Jean-Michel Blanquer, connu pour ses prises de positions particulièrement réactionnaires. Je m’intéresserai dans ce chapitre aux raisons contextuelles du tournant anti-essentialiste des théories féministes, à savoir la cristallisation des théorisations du sujet féministe autour d’enjeux ontologiques et/ou métaphysiques. Au sein des universités étasuniennes, un courant intellectuel émerge à la fin des années 60 et gagne rapidement de nombreux/ses émules : celui des théories dites postmodernes ou post-structuralistes, fruit d’un dialogue entre les contextes culturels français et étasunien. Dès le milieu des années 80, par le biais parfois indirect d’une autre création transatlantique, le French Feminism, ce courant devient un acteur central dans le renouvellement des études féministes. Je montre que cette dynamique reconfigure profondément le vocabulaire de la critique sociale. Pour de nombreux/ses intellectuel·le·s, il est désormais évident que l’essence est un outil conceptuel indispensable pour penser la crise du sujet féministe. Ce chapitre explique la centralité de ce concept, à l’aune d’un contexte intellectuel qui le rend signifiant et pertinent : celui du développement du courant dit postmoderne (ou poststructuraliste) aux États-Unis, et son appropriation par les théoriciennes féministes. Dans ce cadre, la métaphysique est amenée à jouer le rôle de contre-modèle pour la critique sociale, et la terminologique qui lui est associée devient peu à peu celle que l’on utilise consensuellement afin de désigner ce qui doit être critiqué. Comment le postmodernisme est-il devenu, au tournant des Conversations et troubles transatlantiques années 90, le lieu privilégié des controverses théoriques féministes ? Comment ce contexte intellectuel a-t-il contribué à reconfigurer le vocabulaire de la critique sociale ? I. French Theory J’aborderai, pour commencer, le courant dit du « postmodernisme », ou, terme que je considérerai provisoirement comme synonyme, du « post-structuralisme ». Ce courant apparaît de manière conjointe à un autre, appelé « French Theory », terme désignant à la fois un canon de références philosophiques et littéraires et une certaine manière de faire de la théorie. Pour comprendre comment se constitue le féminisme post-structuraliste, il faut d’abord s’intéresser à ce phénomène : l’invention, aux États-Unis, d’une certaine manière de faire de la théorie en référence à un ensemble de textes français. A. Postmodernisme, post-structuralisme : des théories françaises made in USA François Cusset a identifié derrière le terme de « French Theory » un courant de pensée qui naît outre-atlantique, pendant les années 70, d’un « malentendu » à la fois « créateur » et « structural » entre « textes français et lecteurs américains ». Il y a « malentendu » car la « French Theory » produite dans les universités aux États-Unis n’a pas grand-chose à voir avec les réception et la lecture, dans leur propre pays, des auteurs/ices français-e-s qui en constituent le corpus. Parfois, cet effet de décalage provoque, littéralement, des quiproquos : ainsi lorsqu’en 97, Alan Sokal et Jean Bricmont publient la première édition de leur ouvrage Impostures intellectuelles, pour y dénoncer le caractère antiscientifique des inspirateurs/ices, principalement français-e-s, du « postmodernisme », ils tiennent à ce qu’elle paraisse d’abord en France – la Selon les contextes d’usage, ces termes peuvent renvoyer à des choses très similaires ou au contraire radicalement distinctes. Pour une étude précise des différences entre ces deux catégories, leur émergence historique et leurs liens, voir A. Huyssen, « Mapping the Postmodern », dans L. Nicholson (éd.), Feminism/Postmodernism, New York ; Londres, Routledge, 90. Dans la littérature qui m’intéresse ici, à savoir un certain type de théories féministes, qui émergent aux États-Unis, à la des années 80 pour se prolonger dans tout le courant de la décennie 90, la différence n’est pas signifiante. J’opterai donc ici pour l’indistinction, et traiterai les deux termes comme des synonymes ; je prends cependant la précaution de souligner que cette synonymie est contextuelle et qu’elle n’est pas forcément généralisable. . version anglaise ne sera publiée que l’année suivante aux États-Unis. L’ambition était sans doute de combattre le « mal » à la racine, dans le contexte français qui, supposément, avait rendu possible l’émergence d’un tel courant de pensée et l’avait porté aux nues. Pourtant, les intellectuel·le·s et les thèses visées par les deux physiciens n’ont en France, dans les années 90, qu’une influence relativement faible. Si bien que, comme le montre François Cusset, la réception en France est partagée entre nationalisme anti-américain – il s’agit de réagir à cette « déclaration de guerre à nos grands penseurs » – et réactions conservatrices à « l’idéologie préet post-soixant-huitarde5 ». En d’autres termes, la réception française tout aussi bien que les auteurs de l’ouvrage peinent à saisir qu’il ne s’agit pas tant d’attaquer des auteurs/ices français·e·s ou un moment de l’histoire de la pensée politique en France que l’usage sur le sol des universités américaines de ce corpus venu de France. À la suite de François Cusset et de Cornelia Möser, pourtant, je ne souhaite pas parler à propos de ce « malentendu » d’un effet de « distorsion », comme le propose Jérôme Vidal, ou pour le dire autrement d’une déformation des textes originaux par le transfert de théories dans un autre contexte institutionnel et national. Je préfère à leur suite parler du caractère créateur ou « producteur6 » d’un tel transfert : la « French Theory » n’est pas une lecture « erronée » de Foucault, Derrida, Deleuze, etc. ; elle est une production théorique originale sur la base de leurs textes. Cet aspect producteur me permettra de souligner l’originalité de ces théories et ce qu’elles apportent à la pensée féministe. J’adopterai, plus loin dans ce chapitre, la même démarche en ce qui concerne la catégorie de « French Feminism » : l’enjeu, en effet, n’est pas d’insister sur le fait que les lectrices universitaires de Luce Irigaray, Julia Kristeva et Hélène Cixous ont « mal » compris le mouvement féministe en France, mais plutôt d’interroger les raisons de leur intérêt pour ces autrices et la manière dont leur lecture construit un cadre théorique pour la critique féministe aux États-Unis. L’un des principaux acteurs dans la popularisation du terme « postmodernisme » sur le sol étasunien est Frederick Jameson, dans un article initialement écrit pour la New Left Review paru en 8 et republié sous forme d’ouvrage en 9 . Dans ce texte, à la suite de Jean-François Ibid., p5. 5 Jean François Kahn, « Morgue scientiste contre impostures intellectuelles », Marianne, 1- octobre 97. Cité dans Ibid., p. 6 C. Möser, Féminismes en traductions : théories voyageuses et traductions culturelles, Paris, Éditions des Archives contemporaines, 01. 7 F. Jameson, Postmodernism, or The cultural logic of late capitalism, Durham, Duke University Press, 91. PARTIE 1 – LE FÉMINISME ET SON SUJET. Lyotard dont il contribue au succès grandissant en contexte outre-Atlantique, il propose de désigner par le terme englobant de « postmodernisme » la pensée de la plupart des auteurs qui en viendront à constituer le corpus canonique de la « French Theory ». L’ambition qu’il poursuit est de proposer un diagnostic de la société capitaliste contemporaine, et notamment d’identifier, à partir de ce concept, le « nouveau rôle de la culture au service de la domination marchande8 » – rôle auquel participe pleinement, selon lui, les intellectuels de la « French Theory ». Le terme est péjoratif chez Jameson, et il est destiné à dénoncer ce qu’il perçoit, chez Derrida, Deleuze et Guattari, comme une réinterprétation esthétique et littéraire des théories marxistes et révolutionnaires mises au service d’une nouvelle logique du capital. Pour autant, son essai participe à la popularisation grandissante de ce terme, y compris chez des intellectuel·le·s se revendiquant positivement de ce courant. De fait, son usage oppositionnel du concept, dont la fonction est de construire une figure unifiée de l’adversaire à critiquer, s’accommode particulièrement bien avec d’autres dynamiques institutionnelles et intellectuelles qui contribuent activement à construire l’unité et la cohérence de la catégorie de « postmodernisme » et, par extension, celles du corpus de la « French Theory ». Avant d’analyser plus précisément ces dynamiques, je propose d’exposer brièvement quelques éléments récurrents dans la manière dont le « postmodernisme » (et par extension de la « French Theory » dont il est issu) sont présentés dans le contexte étasunien. Ces éléments constituent ce que j’appellerai ici des nœuds de cohérence : il s’agit de thématiques qui sont fréquemment citées dans les manuels et les ouvrages d’introduction aux théories postmodernes, et qui permettent de comprendre sur quels éléments supposément communs repose cette construction active d’unité de sens prêté au signifiant « postmodernisme ». La philosophie française ou la radicalité de l’obscur Tout d’abord, l’idée de « French Theory » renvoie à l’usage d’un certain corpus, dont la cohérence tient principalement à la nationalité française de ses auteurs/trices (Foucault, Deleuze, Guattari, Derrida et Lacan sont les figures centrales de cet ensemble, aux côtés desquels on trouve parfois Lyotard, Kristeva, Irigaray, Cixous, Baudrillard, Bataille, etc.). L’énumération prolifique, non close, et l’ensemble relativement hétéroclite tient, encore une fois, au fait que ce n’est pas en raison d’une cohérence interne à ces différents types de pensée que ces auteurs/trices 8 F. CUSSET, French theory, op. cit., p. 7. CHAPITRE 1 – UNE QUESTION DE CONTEXTE. sont réunis, mais qu’ils et elles sont plutôt, à l’inverse, réunies à des fins de production théorique. Pourquoi cet engouement pour des philosophes français·e·s ? Plusieurs explications sont possibles : l’une, institutionnelle, insiste sur la place des chercheur/ses en études françaises dans la popularisation de ces textes aux États-Unis, dans un contexte de redéfinition de l’équilibre du pouvoir et de la légitimité académique au sein des universités américaines, au cours des années 60 et 70. Ce processus, que je détaillerai plus amplement par la suite, a permis aux études littéraires et, parmi elles, aux départements de français, d’obtenir une plus grande influence et de plus grandes prérogatives dans le champ des recherches académiques (et notamment dans le champ de la critique sociale). Cornelia Möser, pour sa part, propose une autre analyse. Elle souligne que les philosophes ainsi importés se distinguent souvent par la complexité de leur prose : « ce qu’il y [a] à traduire est ainsi caractérisé comme obscur, flou et incompréhensible par celles et ceux qui s’opposent à sa traduction, comme par celles et ceux qui la promeuvent9 ». Certain·e·s en viennent ainsi à assimiler l’origine française d’un texte littéraire ou philosophique et son haut niveau de complexité et de sophistication théorique ; la sociologue canadienne Michèle Lamont, par exemple soutient que « la sophistication du discours semble être une condition structurelle de légitimation intellectuelle dans la communauté intellectuelle française : la virtusité rhétorique concourt à fixer les statuts et à maintenir des classements parmi les philosophes français·e·s. Pour entrer dans le champ, il faut jouer le jeu de la rhétorique : cette caractéristique due au milieu intellectuel est très présente dans l’œuvre de Derrida . » Ce qui m’intéresse, dans cette analyse, ce n’est pas tant ce qu’elle dit sur la France (je n’en remets pas pour autant en doute la pertinence), puisque la France n’est pas mon objet d’étude ici. Je souhaite plutôt souligner un élément dont témoigne ici ce texte : le fait, comme le résume très bien Cornelia Möser, qu’« [i]ncompréhensible et français semblent converger » auprès du public universitaire étasunien. Or, si ce caractère obscur et complexe sert d’arguments à certain·e·s pour rejeter la validité de ces théories (c’est le cas de Sokal et Bricmont, qui dénoncent un « jargon » mis au service d’une « charlatanerie »), il a chez d’autres l’effet inverse : Edward Saïd souligne ainsi que l’engouement pour la « French Theory » se comprend en raison du fait qu’« [ê]tre 9 C. Möser, Féminismes en traductions, op. cit., p5-. M. Lamont, « How to Become a Dominant French Philosopher: The Case of Jacques Derrida », American Journal of Sociology, vol. 9, n° , 87, p. 59. PARTIE 1 – LE FÉMINISME ET SON SUJET. incompréhensible est devenu un signe de profondeur ». Comment comprendre cette préférence a priori paradoxale pour l’inintelligibilité d’un texte ? Judith Butler, qui, dans l’introduction à la seconde édition de Trouble dans le genre, revendique le fait de s’inspirer du « poststructuralisme français1 », entreprend également de répondre à celles et ceux qui l’ont critiquée sur la complexité de son style : cette complexité, dit-iel, est la clé de la radicalité politique et théorique de son œuvre. « Ce serait une erreur de penser que la grammaire que l’on a apprise est le meilleur moyen d’exprimer des vues radicales, étant donné les contraintes qu’impose cette grammaire à notre pensée, et même à ce qui est simplement pensable. […] Cela demande aux lecteurs et lectrices plus de travail, et ils/elles se froissent parfois de ces exigences. Est-il légitime que les personnes offensées exigent un ‘parler simple’, ou est-ce que leur plainte naît d’une attente consumériste de la vie intellectuelle1 ? » De la même manière, Avita Ronell parle de « l’incompréhensibilité », selon elle « le plus grand reproche que l’on adresse à la French Theory », comme d’une ressource. Selon elle, la « transparence », dont on reproche l’absence dans les textes de la « French Theory », ferme des possibilités plutôt qu’elle n’en ouvre : elle ne met pas en mouvement la réflexion et n’incite pas à penser différemment. C’est la raison pour laquelle elle affirme que « tous les subversifs de ce pays […] ont une dette envers les auteurs français1 ». Pour Ronell et Butler, l’obscurité et la complexité d’une œuvre en viennent donc à être le gage tout à la fois de la pertinence de l’analyse et de son caractère subversif. Dès lors, cette quête de l’incompréhensible dont parle Edward Saïd témoigne de cette idée, selon laquelle l’obscurité de la prose est la clé d’une radicalité à la fois théorique et politique de la pensée. Ainsi, si cet ensemble de théoricien·ne·s français-e-s ne semble pas présenter d’unité auprès d’un public intellectuel français, il en est autrement des États-Unis. Outre-Atlantique, leur nationalité figure volontiers comme l’indice de leur complexité théorique, elle-même lue par ses défenseurs/ses comme le gage d’une radicalité à la fois théorique et politique : elle est signe à la fois de la profondeur de la pensée et de son caractère critique. E. Saïd, « The Franco-American Dialogue », dans I. van der Poel et S. Bertho (éd.), Traveling theory: France and the United States, Madison ; Londres, Fairleigh Dickinson University Press ; Associated University Presses, 99, p5, cité dans C. Möser, Féminismes en traductions, op. cit., p. J. Butler, Trouble dans le genre : le féminisme et la subversion de l’identité, C. Kraus (trad.), Paris, la Découverte, 006, p. 6 Ibid., p. A. Ronell, American philo : entretiens avec Anne Dufourmantelle, « Postmoderne » ? Quelques nœuds de cohérence dans l’emploi du concept Qu’est-ce qu’une théorie postmoderne ? Si la question est beaucoup trop vaste pour pouvoir être traitée dans ces pages, je propose de relever quelques éléments qui lui sont associés de manière récurrente, afin d’apporter des clés de compréhension à l’usage de ce terme. L’ambition, ici, est de rendre brièvement compte des usages du concept, en partant du principe que c’est dans ces usages que réside sa signification. Quels sont ces nœuds de cohérence, quels sont les éléments à partir desquels se dégage une unité de sens suffisante pour rendre compte d’une utilisation aussi répandue dans les universités étasuniennes ? La réponse à cette question n’est pas simple, et ce pour deux raisons. D’abord, comme je le montrerai plus bas, la cohérence de la catégorie de « postmodernisme » est sans doute tout autant due à des effets de contexte qu’à une solidarité interne des thèmes et des idées. Ces effets de contexte créent des quiproquos amusants : certain·e·s théoricien·e·s français·e·s, considérés outre-Atlantique comme le nec plus ultra de la pensée postmoderne, restent tout simplement perplexes lorsqu’on leur parle de postmodernité. Ainsi Michel Foucault, dans un entretien publié en 8, répond la chose suivante à son interlocuteur qui l’interroge sur le sujet : « Qu’est-ce que la postmodernité ? Je ne suis pas au courant ». Et de développer : « Je me sens embarrassé, parce que je ne vois pas très bien ce que cela veut dire ni même […] quel est le type de problèmes qui est visé à travers ce mot ou qui serait commun aux gens que l’on appelle les postmodernes 15 ». L’autrice de cette thèse partage l’embarras de Michel Foucault : j’ai souvent été interpellée par le hiatus évident entre l’omniprésence de ce terme dans la littérature anglophone, et notamment étasunienne, et son absence complète dans la manière que l’on a, en France, de faire de la philosophie. Au point, parfois, de se sentir idiot·e, aux deux sens du terme (la stupidité et l’idiosyncrasie) : particulièrement ignorant·e et absolument singulier/ère dans cette situation. Comment expliquer, en effet, ce sentiment d’être seul·e à ne pas comprendre ce dont tout le monde parle et dont tout le monde semble saisir le sens sans avoir besoin de plus d’explications ? Ensuite, cette cohérence est souvent produite de manière performative par celles et ceux qui l’utilisent : pour rendre compte de leur approche, ils et elles opèrent des rapprochement entre différentes œuvres et différentes analyses qui ne relèvent pas tant d’éclairages internes aux textes que de la construction active et assumée d’une unité de sens5 M. Foucault, « Structuralisme et post-structuralisme », dans Daniel Defert et François . Aussi, je choisis, pour ce faire, d’utiliser principalement des manuels, des anthologies, des ouvrages d’introduction et des readers, portant sur la question du postmodernisme. Ces ouvrages, en effet, font deux choses. Tout d’abord, ils prennent acte de l’usage d’un terme théorique dans certains champs académiques, et en faisant cela, ils consacrent le statut de ce terme comme concept épistémologique central à ce champ. Ensuite, en se proposant d’expliciter ce concept, ils participent activement à le naturaliser auprès des chercheurs/ses de ce champ : par naturaliser, j’entends ici en faire un élément sur lequel on peut communément compter. Cette opération de naturalisation signifie que le public concerné lui prête a priori une certaine unité de sens : en conséquence, le concept de « postmodernisme » devient, en contexte étasunien, une variable pertinente d’explication des phénomènes. Afin de permettre une saisie a minima de la manière dont fonctionne le terme dans le contexte théorique anglo-saxon, je propose ici de développer de manière succincte trois éléments, chacun constituant un des possibles nœuds de cohérence qui fondent l’unité de sens du concept. Cette exposition n’est qu’une proposition, incomplète, parmi d’autres, et n’a aucune prétention à l’exhaustivité ; elle se base sur trois éléments de similarité : fonctionnelle, thématique, méthodologique. a.similarité fonctionnelle : le diagnostic d’une époque Tout d’abord, un certain nombre d’usagers/ères de la notion de postmodernisme l’utilisent, du moins à ses débuts, à des fins similaires : cette similarité de fonction constitue un premier élément créateur de cohérence. Ainsi, pour Jameson, le but est de se donner les moyens de penser la forme contemporaine que revêt le capitalisme. En cela, sa démarche ressemble à celle de Lyotard, dont il hérite de la terminologie : pour l’auteur français, il s’agit en effet de proposer un « rapport sur le savoir » intimement lié au statut des sciences au lendemain des années 50. Il s’agit dans un cas comme dans l’autre d’utiliser le concept en vue de proposer une forme de diagnostic sur sa propre époque. La philosophe féministe Jane Flax, de la même manière, propose d’établir des « conversations » entre trois types de pensée – le postmodernisme, la psychanalyse, et les théories féministes – afin de saisir ce qu’elle définit comme les caractéristiques générales de son époque. Il s’agit pour elle de comprendre la « transformation fondamentale » que traverse selon elle la « culture occidentale », une transformation « aussi radicale (si ce n’est aussi graduelle) que le passage de la société médiévale à la société moderne ». Selon elle, ces sociétés traversent une sorte de malaise civilisationnel, dû à un « état transitionnel » qu’elle caractérise par « la fin du colonialisme, le soulèvement des femmes, la révolte des autres cultures contre l’hégémonie blanche occidentale, des changements dans l’équilibre du pouvoir économique et politique au sein de l’économie mondiale, et une conscience grandissante des coûts aussi bien que des bénéfices du « progrès » scientifique et technologique ». Dans ce contexte, les théories féministes, psychanalytiques, et postmodernes incarnent le « type de pensée qui présentent (ou représentent) le mieux notre propre époque telle qu’appréhendée dans la pensée »
INTRODUCTION GÉNÉRALE |