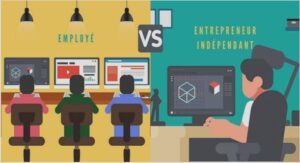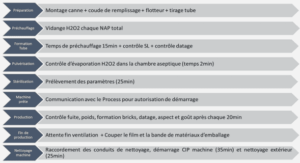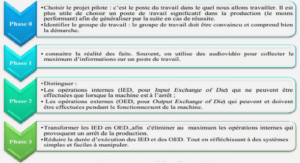Couples ‘métropolitain’ – ‘polynésien’ à Tahiti
L’individu, le social et l’union « interethnique »
Ce premier chapitre présente le cadre théorique de cette recherche articulant différentes échelles du monde social : de l’acteur social12 individuel à la société globale en passant par le couple et la famille. Dans un premier temps, il s’agit de cibler l’objet sociologique de recherche en articulant ses dimensions : l’union matrimoniale, les rapports sociaux de pouvoir et la production de l’altérité – dont la différence ethnique ou « raciale ». Dans un deuxième temps, nous aborderons des théories générales basées sur des tendances macrosociales des unions matrimoniales, suivie des théories qui se basent notamment sur des études quantitatives. Les enseignements – les apports et les risques de fausses pistes – de ces recherches et leurs interprétations sont pris en compte dans l’établissement de la méthodologie et dans la considération de ce que ses résultats pourront nous révéler ou occulter. Enfin, une hypothèse de cette recherche étant que les discours et les interactions des individus et des couples au niveau microsocial sont des indicateurs des rapports sociaux macrosociaux, ce chapitre se penchera sur, dans un troisième temps, le cadrage théorique concernant la liberté de l’acteur social dans des systèmes de contraintes sociétales, et comment l’acteur social reflète et produit le monde social et ses rapports de pouvoir. A. L’union et l’ethnicité La notion de « mariage mixte » est courant pour qualifier ce type de recherche sociologique, et reflète et produit – (re)produit – son usage dans le monde social et sur le terrain. Or, le terme « mariage mixte » est loin d’être suffisamment précis pour définir l’objet de cette recherche. Après avoir abordé les processus sociaux associés au « mariage » ainsi que les terminologies de la « mixité », nous discuterons du soubassement de la notion de « mixité » : la production sociale de la différence. Cette discussion sera débutée par une présentation de l’épistémologie des notions de « race » et « ethnicité ». 12 Le terme « acteur social » sera privilégié à celui d’« individu » afin de mettre l’accent sur le caractère social et interactif de ce dernier, qui agit et interagit au sein de contextes sociaux.
Du « mariage mixte » à l’« union interethnique »
Le mariage est une institution dont les règles sociales sont éternellement reproduites mais évolutives, variables mais toujours présentes dans les sociétés. Si l’institution de mariage est dotée de moins en moins d’importance dans la société française contemporaine comme en Polynésie française, les règlements, cérémonies ou autres actes symboliques qui l’entourent révèlent l’importance du choix du conjoint aux yeux du groupe familial et social. Les théories anthropologiques et sociologiques autour du mariage tentent de révéler ce que peut représenter cette institution sociale, et ce que peuvent révéler les codes sociaux qui portent sur le choix du conjoint et l’arrangement social de l’union matrimoniale. Le « mariage mixte » est une dimension de ces positions des groupes sociaux par rapport à l’union matrimoniale. Or, s’il est souvent pris comme objet de recherches sociologiques, le terme « mariage mixte » ne s’accorde pas à notre sujet pour de multiples raisons, comme nous verrons ici. L’arrangement social du mariage Pour les anthropologues structuralistes, le mariage, compris comme une « alliance » entre deux individus – chacun fourni par une famille ou un groupement social plus large, est la première unité constituant la société. Fondement de la société selon ce courant, le mariage ne peut exister sans l’existence préalable de cette même société, qui influence le sens des échanges et des alliances matrimoniales (Lévi-Strauss 1983). Ces règles structurantes, évolutives et reproduites donnent à la sexualité et à la filiation biologique un sens social, tout en étant une base constitutive du social. La sexualité en soi n’est pas donc propre à l’individu et ses désirs personnels, mais se forme par son interprétation et usage des significations véhiculées par les normes sociales. Pour le dire autrement, « la sexualité est l’un des véhicules principaux des significations culturelles, à la fois par l’opération des normes et par les modes périphériques par lesquels elles se défont » (Butler 2006 : 29). Le choix d’un conjoint désirable est de cette manière fortement influencé par le monde social extérieur à l’acteur social. On peut dire que l’acteur social est partie prenant des normes, des contraintes et de l’imaginaire de la société en ce qui concerne ses désirs et ses choix familiaux. La sexualité est dans chaque société entourée de traditions et de « règles » implicites et explicites, et est l’objet de normes et de marginalisations. C’est par la régulation sociale de cette impulsion – puisque elle revient à contrôler la filiation – que la famille et la société 13 Rappelons qu’une institution peut être définie comme : « Ensemble des structures politiques et sociales établies par la loi ou la coutume et qui régissent un état donné » (Définition du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, 2008, URL : http://www.cnrtl.fr/lexicographie/institution, consulté le 6-02-2010). 18 assurent leurs formes de reproduction sociale à travers la transmission de connaissances et de biens aux descendants. Puisque sont en jeu des éléments de la reproduction sociale, culturelle et économique, tel l’héritage de biens et la transmission aux enfants, les humains « surround mating with sets of culturally invented rules, consciously avoid mating with certain categories of kin, and differentiate casual mating from the stable pair-bond that they institutionalize in marriage » 14. Lévi-Strauss (1967 : 650-651) voit dans le mariage la transformation de la rencontre sexuelle dans un contrat, cérémonie ou sacrement, ce qui fait que la société, pour réguler et reconnaitre cette tâche, construit de nombreuses règles implicites. Ainsi, le mariage est un acte social, socialement reconnu, qui intègre un membre d’une famille au sein d’une autre. Du statut de « simple candidat » dans une « ‘affaire intime’ entre deux individus », le conjoint devient un « membre du groupe », accepté et reconnu comme tel par ce dernier (Barbara 1989 : 35). Jocelyne Streiff-Fenart affirme similairement que la reconnaissance sociale et familiale d’un mariage est un moyen fort d’accepter un échange entre groupes. Selon Bogardus, l’échange matrimonial représente la modalité la plus forte d’interpénétration et de communication interculturelle de toutes les modalités d’échange entre les groupes (Streiff-Fenart 1990b : 124). La célébration ou la sanction des unions, autrement leur acceptation, « interdiction » ou rejet plus ou moins prononcés de la part des entourages sociaux et familiaux, expriment des règlements sociaux des groupes autour de l’institution de mariage. Si l’institution de mariage est de moins en moins suivie dans la société française contemporaine comme en Polynésie française, comme nous verrons un peu plus loin, les règlements sociaux des unions sont toujours aussi présents dans les discours et interactions autour des choix du conjoint et de l’intégration d’un membre dans la famille par le biais d’une union stable. L’anthropologie structuraliste a montré que toute société tente d’imposer deux frontières à l’union matrimoniale, connue comme « l’alliance », nécessairement mais différemment dessinées. Ces frontières définissent la zone de possibilités socialement acceptées dans les choix matrimoniaux, proscrivant certains partenaires considérés comme inappropriés. Ces tabous comprennent non seulement la prohibition générale de l’inceste, qui proscrit une alliance avec un partenaire trop « proche », mais aussi la prohibition de l’alliance avec le partenaire trop « distant », incarné par la notion de « l’étranger ». Alors que la structure de la proscription de l’inceste est généralement clairement définie, le mariage perçu comme « trop distant » – le « mariage mixte » – est, selon Lévi-Strauss, une alliance que les 14 Van der Berghe (1979). Human Family Systems, Elsevier Science Publishing Co., New York, p.13, cité par Marksbury, 1993, p.7. 19 sociétés n’ont pas su codifier de manière satisfaisante (cf. Barbara 1989 : 75). Les codes et règlements sociaux qui entourent l’union matrimoniale étant souvent occultés, un champ d’études sociologiques s’ouvre à leur investigation, des tendances dans le choix du conjoint à la désignation de candidats souhaitables, « interdits », ou moins souhaitables. Malgré les multiples apports des théorisations structuralistes pour penser l’organisation sociale des unions matrimoniales, l’étude de l’alliance chez Lévi-Strauss, étant à la recherche de règles généralisables, « ne pouvait en rester qu’au niveau de la norme » (Amselle 1996 : 46). Ce qui n’est pas pris en compte, et ce qui figure comme objet de la présente recherche, sont les mécanismes sociaux en œuvre quand les normes et les tendances à l’union homogame sont transgressées. Les unions considérées comme déviantes ou labellisées comme « mixte », ainsi que le discours concernant l’acceptation ou le rejet de certaines catégories sociales dans le choix du conjoint, peuvent éclairer les normes et les transgressions des échanges, et de ce fait les rapports sociaux dans une société donnée. Le « mariage mixte » comme objet de recherches On appelle en général « mariages mixtes » les unions matrimoniales qui, en raison des appartenances sociales réunies par l’union et considérées comme distinctes, sont considérés comme déviantes ou « différentes » par une fraction de la société. Le mariage « mixte » a été régulé socialement et même politiquement depuis des millénaires. Un mariage « mixte » (avec un « étranger ») nécessitait une autorisation pour les citoyens d’Athènes par exemple, et à l’époque de Pericles, 450 BC, d’autres régulations de l’alliance et de la filiation étaient en place, tel le fait d’avoir un père athénien pour être un citoyen athénien et donc pour posséder la terre (cf. Barbara 1989 : 38). Dans le contexte des îles polynésiennes des temps anciens, le mariage entre couches sociales était strictement régulé et un enfant issu d’une telle union interdite pouvait entrainer l’infanticide (Oliver 1974 : 456). Après l’arrivée des Européens, une loi de 1837 a interdit les mariages entre les étrangers et les autochtones. De nos jours, le mariage international est encore régulé dans certains pays (Chine) ou entraîne des différences légales en matière de nationalité selon le genre dans d’autres (Liban), et le mariage « mixte » selon la « couleur » était jusque récemment défendu dans encore d’autres pays (Afrique du Sud, Etats-Unis) (cf. Barbara 1989 : 6). Ainsi, le phénomène du « mariage mixte » comme construction sociale, et les réactions et les interdits qui l’entourent, attire l’attention des sociologues depuis les années 40 au moins, à l’instar du travail de Robert K. Merton. En France, le terme « mariage mixte », comme celui de « l’intermariage », est ainsi dérivé du vocabulaire de la sociologie américaine des relations interraciales, ayant succédée au terme 20 « miscegenation », dont les lois d’interdiction n’ont que récemment été abrogées. Nous aborderons ici l’épistémologie des théories portant sur les notions de mixité dans l’union matrimoniale. Déjà dans les années quarante, R.K. Merton (1964 : 130) a défini l’intermariage, « un mariage entre personnes issues de différents groupes », en termes de déviance. Il distingue entre conformité et déviance à travers les règles d’endogamie – selon lesquelles un conjoint devrait être choisi à l’intérieur de son « groupe » social. Merton caractérise la transgression de ces règles comme « mésalliance inter-groupe », en dépit de la connotation négative que cette appellation véhicule (Collet 1998 : 145). Certains auteurs subséquents ont également désigné le mariage mixte comme forme de déviance et comme symptomatique de la désintégration de la communauté (cf. Breger & Hill 1998 : 16), la perception sociale des contextes historiques étant reflétée dans l’analyse scientifique. En effet, les mariages « mixtes » sont toujours « traités avec méfiance précisément parce qu’ils interrogent les frontières entre le Soi et l’Autre » (Breger 1998 : 9, ma traduction). Les chercheurs, comme tout acteur social, étant tributaires des codes et des interactions de leur contexte sociohistorique et culturel, leurs analyses reflètent en partie l’intériorisation des normes de la société environnante socialisante15 . Pour recadrer l’objet de la recherche dans le regard social et l’extraire au maximum du regard subjectif du chercheur, Doris Bensimon et Françoise Lautman (1974) précisent que la notion de déviance s’applique strictement à la réaction du milieu social environnant16 . Définissant la notion de « mixte », elles insistent à juste titre sur la nécessité que le regard social subjectif demeure la raison d’employer ce terme. Pour que le chercheur l’emploie, « le mariage doit être perçu comme mixte, en suscitant une réaction de l’environnement social » (cf. Collet 1991 : 20). Cette définition fait écho à celle de Jocelyne Streiff-Fenart : « Ce qui fait le mariage mixte, ce n’est donc pas la différence entre les époux, mais le jugement catégoriel, toujours sujet à variation et redéfinition, qui s’applique aux unions transgressant les frontières sociales » (Streiff-Fenart 1986 : 5). C’est la perception sociale et non pas le sociologue qui détermine la « mixité » ou les critères de la différence entre conjoints. 15 Comme ont écrit P. Bourdieu, J.-C. Chamboredon, et J.-C. Passeron (1983 : 100), « le code que le sociologue utilise pour déchiffrer les conduites des sujets sociaux s’est constitué au cours d’apprentissages socialement qualifiés et participe toujours du code culturel de différents groupes auxquels il participe ». 16 Quant à elles, elles affirment que, quelle que soit la réaction suscitée par l’environnement social, ces mariages relèvent d’un « phénomène normal » du brassage entre populations (cf. Collet 1998 : 144), s’alignant avec la conceptualisation de Max Weber un siècle plus tôt, pour qui l’existence ou bien l’absence d’intermariage est la « conséquence normale » d’attraction ou de ségrégation entre groupes raciaux (Weber 1968 : 385). 21 Pour faire face à cette notion de mixité relative au jugement social, Beate Collet (1998) propose la notion de « mixogamie ». Cette notion tente de construire une approche de la mixité prenant en compte, non pas ce qui apparaissent comme des jugements de valeur ou des différences concrètes, mais en faisant référence à une conception sociale d’une déviation de la norme. Il s’agit d’étudier l’établissement d’une frontière sociale floue dont émergent des catégories « nous » et « eux », et de la perception sociale de l’alliance qui traverse cette frontière comme aberrante par rapport aux normes. Pour B. Collet, la notion de « mixogamie » serait un outil qui : « peut servir à étudier cette spécificité de l’intermariage, qui est sa relation à la norme sociale […] Il permet en effet de voir dans quelle mesure une réalité conjugale précise est considérée comme allant à l’encontre de la norme d’un groupe social de référence […] dans un système social donné, à une époque donnée, et comment elle s’inscrit ainsi dans le processus de modernisation de la société » (Collet 1998 : 146). Ainsi la perception de la mixité par le groupe social est l’objet central d’étude, et cette perception est soigneusement inscrite dans son contexte socio-normatif, géographique et temporal, contexte qui est en transformation permanente. Pour Jean Poirier (1975), « mariage mixte » et « hétérogamie » sont tout deux des sous-catégories de l’« inter-mariage », la différence en termes de mixité étant que le « mariage mixte » unirait des facteurs de différences considérées comme « naturelles » (race, nationalité, religion), alors que l’« hétérogamie » comprendrait des différences d’ordre socioculturelles ou socioéconomiques (cf. Poirier 1975 : 8, Varro 1998 : 3). Si ces souscatégories de l’intermariage sont considérées comme n’allant que rarement ensemble, puisque les alliances matrimoniales comporteraient pratiquement toujours une certaine forme d’homogamie (Philippe & Varro 1994), nous verrons dans l’analyse de ce travail qu’au contraire, « mixité » et « hétérogamie » s’accompagnent de manière courante dans certaines configurations de couple. La « mixité » est ainsi un terme assez vague, puisque tout couple est mixte sur certains points, que ce soit le sexe, pour commencer, ou d’autre élément de différenciation que ce soit d’ordre ethnique, économique, social ou religieux. Pour expliquer le jugement sociétal de différence, J. Poirier pour sa part appelle le mariage dit « mixte » un « échange inégal », puisqu’il « couple deux éléments que le modèle culturel dominant estime ne pas être appariables ; c’est en quelque sorte une im-parité essentielle qui est mise en cause » (Poirier 1975 : 11). On trouve donc deux 22 notions juxtaposées : la différence et l’égalité17, les différences étant saillantes justement puisque créées au sein de rapports sociaux de pouvoir, qui rend les différences inégales. Rosemary Breger et Rosanna Hill (1998 : 11-12), se basant sur les recherches de nombreux auteurs sur le sujet d’alliances matrimoniales transculturelles, attribuent justement les jugements de valeur portés sur des groupes sociaux à l’existence d’un différentiel de pouvoir social entre les groupes. C’est ce différentiel, écrivent-elles, qui fait que les stéréotypes sont dotés d’émotions fortes, ce qui privilégierait l’homogamie, là où le différentiel de pouvoir entre groupes serait nul. Terminologie : du « mariage mixte » au « couple interethnique » De nombreuses études sociologiques traitant l’union entre deux individus perçus comme appartenant à des catégories sociales considérées comme naturellement différentes font recours au terme de « mariage mixte ». Alors que ce terme a été le terme clé emprunté au départ de la présente recherche, les deux mots le composant se sont avérés imprécis dans le cadre d’une recherche portant sur les choix du conjoint et les familles interethniques contemporaines. En premier lieu, la notion de « mixité » demeure trop vague, comme il a été brièvement évoqué plus haut. La définition qu’en donne B. Collet, qui intègre à la notion de mixité le fait de ressentir des « difficultés » par rapport aux « critères de différence », établis par l’environnement social, ne s’impose pas dans le champ de mes recherches. Ceci dans la mesure où des différences comme des inégalités, surtout quand elles sont normalisées au sein de la société, ne sont pas forcément ressenties comme problématiques ou comme provenant d’autre chose que de différences perçues comme « naturelles », telles les inégalités de genre dans les sociétés occidentales avant les mouvements féministes. J. Kellerhals indique par exemple qu’une domination par assimilation d’un des conjoints est : « librement acceptée par le dominé au nom de l’amour, [et] s’exerce la plupart du temps au profit du conjoint le mieux placé socialement » (Kellerhals et al 1982 : 125). Ce qui nous importe dans le champ de notre étude est donc la perception d’altérité ethnique en soi, et comment elle perdure au sein de la famille, et non pas les difficultés ou les « problèmes » que la différence pourrait impliquer. D’autre part, les caractéristiques de « mixité » en tant qu’objet de recherche dépendent des chercheurs et des pays, certaines études portant sur la religion, d’autres sur la nationalité, 17 C’est cette focalisation sur la différence que dénonce Christine Delphy, qui rappelle que « le contraire de l’égalité n’est pas la différence mais l’inégalité » (Delphy 2001 : 9). 23 d’autres encore sur la construction sociale de « race »18 ou d’« ethnicité ». Alors que les études anglo-saxonnes sur le « mixed marriage », d’où le terme « mariage mixte » trouve ses racines, portent notamment sur les alliances traversant une frontière socialement conçue de « race » ou d’« ethnie », le concept de mixité dans les recherches françaises portant sur le « mariage mixte » fait tantôt référence à une mixité de culture (ethnie, langue ou religion), tantôt à une mixité de nationalité (Collet 1998 : 142). La mixité y est autrement associée à d’autres « critères de différence »19, tels que la religion ou la « race ». En raison de ces imprécisions, la notion de mixité a été modifiée par Augustin Barbara, par exemple, dont le titre de mémoire en 1978, « Mariages mixtes » (EHESS), a été remplacé dans sa thèse d’état (Paris V) en 1987 par le terme « mariage interculturel » (cf. Collet 1991 : 21). Pour ma part, je propose d’employer le terme « interethnique » qui spécifie plus précisément la façon de penser la différence qui intéresse cette étude. Quant au terme de « mariage », il fait référence à un couple stable qui s’établit par une cérémonie officielle religieuse ou administrative. Les termes « couple » ou « union », seront donc plus systématiquement employés, puisque référant à un couple stable mais qui ne sera pas nécessairement officialisée par une cérémonie ou statut publics. « Ce n’est plus le mariage mais le couple, marié ou non marié, qui est valorisé » dans la société française d’aujourd’hui (Schnapper 1998a : xv). En ce qui concerne les tendances des Français métropolitains, les mariages officiels en France sont de moins en moins nombreux. Depuis la fin des années 80, « le nombre de cohabitants ayant augmenté, il devenait impératif d’étudier aussi les ‘couples’ mixtes et les raisons du non-mariage » (Collet 1991 : 20). En effet, selon l’INED, la France comptait 516.900 mariages en 1946, chiffre qui descend à 393.700 en 1970, et qui diminue à seulement 303.500 en 2001. Par ailleurs, le nombre de naissances hors mariages était supérieur à 40% en 2005, alors que le pourcentage de ces naissances environnait 30% quinze ans plus tôt20 . De même, le mariage en Polynésie française demeure peu courant chez les jeunes couples, le mariage y étant perçu, malgré un passé qui comprend un siècle d’influence des missionnaires anglais, plus comme un ultime stade du chemin du couple, ayant passé par 18 Comme nous verrons dans des chapitres suivant, « race » ou « ethnicité », comme le « genre », sont des constructions sociales dont les frontières peuvent se comprimer ou se contracter. Néanmoins, je mettrai des guillemets plus systématiquement autour du mot « race » en raison de « la charge historique du mot » (Kergoat 2009 : 112), et donc afin de rappeler le caractère sociale – et non biologique – de cette réalité. 19 Doris Bensimon et Françoise Lautman (1977). Un mariage, Deux traditions: Chrétiens et Juifs, Ed. de l’Université, Bruxelles, cité par B.Collet, 1991, p.20 20 Cf. Nadine Laroche (2006). Les naissances hors mariage augmentent moins vite en Ile-de-France qu’en province, Ile-de-France faits et chiffres, Insee, n°126, URL : http://www.insee.fr/fr/insee_regions/idf/rfc/docs/numero126.pdf. Cf. également Michel Bozon (1991b). 24 l’épreuve des enfants et du temps. Il est autrement perçu comme le moyen d’accéder aux activités de l’Eglise à un âge avancé, représentant un « véritable rite de passage établissant socialement l’honorabilité des époux dans leur quartier ou district et surtout dans leur Eglise et par là ouvrant à une position d’influence ». Par rapport aux tendances familiales, selon une estimation, « un ménage sur deux seulement sacrifie aux liens du mariage » (Mauer 1972 : 171). Lors d’une étude de 500 naissances à l’hôpital Mamao à Tahiti, moins de 27% des parents des nouveaux nés étaient mariés, alors que plus de 65% vivaient en concubinage (Vaimeho-Peua 2001). Quand on s’y engage, c’est souvent seulement après de nombreuses années de cohabitation et de projets familiaux, puisque : « il est jugé déraisonnable de s’engager d’emblée dans un mariage définitif ‘fa’ipo’ipora’a’ reconnu légalement et religieusement. Il paraît plus avisé de vivre d’abord ‘fa’a’ea’ une union socialement reconnue qui peut se prolonger fort longtemps jusqu’à la naissance de plusieurs enfants et qui, dans un premier temps de mariage à l’essai, laisse aux partenaires la possibilité de se séparer avec un minimum de conséquences. Le mariage est ainsi senti comme un procès graduel » (Langevin 2002 : 10-11). Pour toutes ces raisons, l’institution du mariage apparaît comme un faible indice de la solidité des couples et des unions familiales qui se forment dans la société contemporaine. Les termes « union » ou « couple » seront donc favorisés, au détriment du terme de « mariage », cette pratique institutionnelle étant trop peu courante et trop restrictive pour rendre compte de la réalité sociale des unions et des enjeux du choix du conjoint en Polynésie française.
« Race », « ethnicité » : épistémologies différentes, un même processus social
Considérons maintenant d’autres termes employés dans le domaine des unions « interethniques » : ceux qui caractérisent leur différence dans la perception sociale, au-delà de la différence de genre : les termes et notions de « race » ou d’« ethnicité ». Ces termes renvoient à des concepts différents de par leurs usages sociaux et scientifiques à travers le temps. La différence majeure s’ancre dans le fait que les sociologues ont tenté de se distinguer de recherches précédentes où l’usage de « race » était parfois essentialisant, traitant ces différences, qui sont sociales et construites dans des rapports de pouvoir, comme des données objectives, « naturelles » ou « biologiques ». Mais comme se le demande Eléni 21 Préface par Paul Ottino de l’ouvrage de C. Langevin, 2002, p.11. 25 Varikas, pourquoi marquer cette différence quand, selon le Robert, le terme « ethnique », la racine du terme « ethnicité », est associée depuis 1882 à l’adjectif racial. Elle rappelle : « quelles que soient les catégories qu’on utilise, on ne saurait faire abstraction des rapports de force dans lesquels elles émergent, des enjeux politiques et théoriques auxquels elles renvoient, des présupposés et du sens commun qui tendent à les rendre transparentes et autoréférentielles » (Varikas 1998 : 91, 93). Nous regarderons ici les usages socio-historiques des deux termes avant de justifier le choix de privilégier le terme « ethnicité » dans cette recherche. « Race » : la différence phénotypique Depuis le début de sa construction comme objet d’étude sociologique, « race » renvoie aux caractéristiques physiques et observables. Les premiers usages modernes du concept de « race » étaient hérités des auteurs du 19ème, tel Gobineau (1853), dont la théorie darwiniste des « races » tâchait de démontrer la supériorité de la « race nordique », ou Vacher de Lapouge (1896), qui définissait la « race » comme « l’ensemble des individus possédant en commun un certain type héréditaire » (Poutignat & Streiff-Fenart 1996 : 34). Ce concept primordialiste et génétique de la « race » a fondé les études sur le « racisme scientifique » depuis Lapouge (cf. Simon P.-J. 1999 : 14-15), et a été employée jusqu’aux premières études de l’Ecole de Chicago dans les années 50. Dans ces dernières études, la composition génétique et l’existence de différences considérées innées servaient de base a priori dans les études sur les relations entre les « races ». Ainsi Robert Ezra Park faisait référence à la « mentalité des hybrides raciaux » et à de différents « stocks raciaux » (Park 1950 : 377, 51). L’usage de « race » par les acteurs sociaux renvoie généralement à cette idée de différence « naturelle » et biologique, non seulement en terme de phénotypes ou « couleur » mais également en termes de symboles culturels. « Pour qui pense la diversité humaine en termes de ‘races’, la culture ne s’apprend pas, elle est dans le sang, dans les gènes » (Simon P.-J. 1999 : 12). Colette Guillaumin montre comment ce concept raciste est appliqué dans un néo-racisme en France, le caractère inassimilable et infranchissable associé à la « race » étant transposé au terme de « culture ». Cette transposition dissimule la connotation négative du terme « race » en le remplaçant par un autre terme (culture), tout en maintenant la notion de différences « naturelles » et immuables. Colette Guillaumin (1994). « Un bien vieux néo-racisme… », Pluriel recherches. Si la notion de différence « raciale » est socialement construite, rendue saillante et naturalisée au sein de rapports sociaux de pouvoir, l’usage social de cette notion a des conséquences sociales réelles (Bourdieu 1982 : 135). Il est ainsi important de pouvoir traiter de ce sujet dans la recherche scientifique, tout en se démarquant de l’approche primordialiste, en mettant l’accent sur la construction sociale de la notion de « race ». Car les signes objectifs employés comme indicateurs de différenciation sociale sont arbitraires, établis comme signifiants au sein de rapports sociaux de pouvoir. L’objet de recherche serait, de ce fait, non pas les différences en soi mais comment les acteurs ou groupes sociaux construisent, maintiennent ou attribuent des notions de « race ». « Ethnicité » : la différence culturelle Ayant largement « remplacé » le terme « race », qui est devenu péjoratif en langue anglaise et française, « ethnicité » est employé comme « son substitut ‘civilisé’ » (Simon P.-J. 1993 : 51), mais toujours porteur de mauvaise presse en France en raison de sa proximité avec « race » (Poutignat & Streiff-Fenart 1996 : 45). Absent du dictionnaire général de la langue française avant 1990 (Simon 1999 : 14), radiée des sondages français par les lois sur la liberté et l’informatique (6 janvier 1978), l’« ethnique » n’est encore que difficilement abordée comme objet d’étude en France. En comparaison, ethnicity apparaît aux Etats-Unis dans le Webster’s New International Dictionary dès 1961, et figure encore dans les sondages publics. Tout en soutenant l’argument d’Eléni Varikas selon lequel les notions socialement construites de « race » ou d’« ethnicité » doivent être employées comme des notions dont la seule réalité relève de leur construction et usages sociaux, j’opte plutôt pour cette notion d’« ethnicité ». Ce choix relève d’une autre raison, au-delà de son histoire d’usage moins axée sur le biologique. En effet, les usages scientifiques de l’« ethnicité » précisent plus régulièrement que d’autres facteurs, en plus des facteurs phénotypiques, participent à la construction des identités naturalisées, tels que la langue, l’accent ou des pratiques culturelles et symboliques (cf. Varro 2008 : 210). Pour F. Anthias et N. Yuval-Davis (1993), la notion de « race » ou de « racisation » s’inscrivent dans les catégories et processus plus larges « d’ethnos », et donc les notions d’« ethnicité » et d’ethnicisation. De ce point de vue, l’appel social à la notion de « race » resterait associé à l’emploi de phénotypes ou de « couleur » dans le tracé de frontières sociales, alors que l’« ethnicité » recouvre les processus plus larges de différenciations sociales, comprenant également l’emploi de symboles culturels. L’usage épistémologique du terme « ethnicité » s’est par ailleurs construit dans cette différenciation avec « race », opposant culture et « nature », croyance/ construction et 27 hérédité. Selon Lapouge, premier à introduire le vocable d’ethnie en 1896, l’ethnie renvoie au « groupement formé à partir de liens intellectuels comme la culture ou la langue » (Poutignat & Streiff-Fenart 1996 : 35), alors que la « race » indiquait les caractéristiques héréditaires. Pour l’anthropologue américain William Lloyd Warner (1963), premier de sa discipline à employer « ethnicity », ce terme est interprété comme ce qui rend un groupement social distinctif par ses caractéristiques culturelles, à la différence des caractéristiques physiques qui constituent la « race » (cf. Simon P.-J. 1999 : 7-8). Similairement, Max Weber (1968), dans son chapitre sur « les relations communautaires ethniques », postule que l’ethnie serait fondée sur la croyance en la communauté, fortifiée par la religion, la langue, les relations commerciales ou la communauté politique, tandis que la « race » serait, encore une fois, fondée sur des caractéristiques héritées et transmissibles par hérédité (cf. Poutignat & StreiffFenart 1996 : 40). L’usage scientifique d’« ethnicité » continue à faire référence à la croyance d’appartenance à une communauté, et au caractère culturel et symbolique de sa construction comme modalité de penser l’identité sociale. L’aspect constructiviste de la définition de W.L. Warner, où ethnic fait référence à « tout individu qui se considère, ou qui est considéré, comme membre d’un groupe avec une culture étrangère et qui participe aux activités du groupe , a été repris par maints sociologues. Ainsi, alors que « race » et « ethnicité » sont tous deux des constructions sociales, le caractère plus large – en éléments symboliques culturels – de l’usage de l’« ethnicité » vis-à-vis des constructions d’identités sociales rend ce terme plus utile dans l’analyse des constructions sociales. Le terme de « race » semble se limiter à des sous-processus sociaux qui font également partie de la construction des identités « ethniques », notamment en Polynésie française, c’est-à-dire la mise en saillance d’indicateurs physiques pour établir des différences – et des barrières – entre groupes sociaux, et la croyance que ces différences seraient à la base génétiques et héréditaires. Pour cette raison, le terme « ethno-racial » sera parfois employé, afin de rendre compte de ces appels au biologique ou au phénotype.
INTRODUCTION |