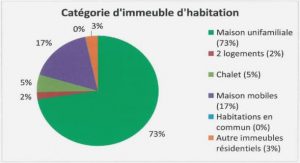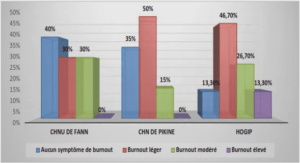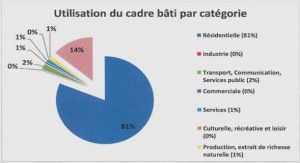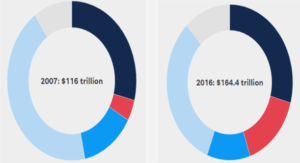Télécharger le fichier original (Mémoire de fin d’études)
LA DOCTRINE MECANISTE : UNE REACTION CONTRE LE FINALISME
« Pour l’essentiel, le mécanisme consiste dans l’explication des propriétés ou caractéristiques de tout objet, par référence non à une fin ou à une fonction (comme chez Aristote), mais à la seule disposition ou configuration de ses parties. L’opposition mécaniste à la philosophie d’Aristote s’exprime, par ailleurs, dans la tentative d’expliquer les phénomènes d’un point de vue quantitatif, et non plus qualitatif »1.
Entre le mécanisme et le finalisme d’Aristote se joue le drame de la philosophie dont l’histoire est caractérisée par un foisonnement de doctrines qui ne cessent de s’affronter et de se nier. Ainsi, le mécanisme, renonçant à l’explication qualitative pour prendre le parti d’une explication quantitative des phénomènes, se pose en s’opposant au finalisme en œuvre dans le système aristotélicien. Aussi, une analyse de celui-ci nous permettra-t-elle de saisir à contrario la démarche mécaniste ; une chose étant définie en même temps que son contraire.
LE FINALISME D’ARISTOTE
On appelle finalisme toute doctrine philosophique qui accorde une importance centrale à la finalité dans l’explication de l’univers et de ses phénomènes. L’explication finaliste consiste à établir que tout mouvement, tout phénomène dans le monde vise à une fin, un but qui en est la cause. Le finalisme a donc en vue non pas le «comment» des choses (c’est-à-dire les mécanismes qu’elles mettent en jeu), mais leur «pourquoi». On parle alors de la «cause finale» comme de l’explication ultime de toute chose.
De l’avis de Raymond Ruyer, la finalité était, à ses origines, magique. Elle consistait « à voir en toutes choses des vertus actives, s’exprimant par des signes, en des correspondances formant des systèmes»1. En effet, l’homme a toujours été confronté aux mystères de sa propre nature et de son environnement. Il se trouve plongé dans une angoisse qui le contraint à chercher le sens de son existence. C’est cette angoisse existentielle qui va engendrer tous les mythes, toutes les religions, toutes les philosophies et même la science. Pour le professeur Monod, depuis «l’enfance de l’humanité»2, l’homme a toujours projeté sur le monde qui l’entoure le sentiment qu’il a de sa propre nature ; s’expliquant ainsi les phénomènes et tentant de dissiper tant bien que mal son mal existentiel.
En fait, nos lointains ancêtres voyaient dans la nature non seulement des êtres semblables à eux (les plantes et les animaux se nourrissant, se défendant et se reproduisant), mais aussi et surtout des objets « bien plus mystérieux » (« des rochers, des fleuves, des montagnes, l’orage, la pluie, les corps célestes »3), toutes choses que nous décrétons aujourd’hui inanimées. Pour en rendre compte, ils procédaient à une « projection animiste » qui consiste à partir d’eux-mêmes, de leur propre fonctionnement à la nature. Or l’activité humaine vise toujours la réalisation d’un projet. La nature tout entière est donc « consciente et projective » : elle a une âme. « L’animisme primitif formulait cette hypothèse en toute naïveté, franchise et précision, peuplant ainsi la nature de mythes gracieux ou redoutables qui ont pendant longtemps nourri l’art et la poésie »4. Telle est l’origine du finalisme.
Aristote régularisera cette finalité primitivement magique en fondant une science finaliste de la nature. Il va rationaliser la nature magique, définir des substances et des accidents classables, des changements réguliers et bien ordonnés. Chez Aristote, bref, la finalité devient une notion scientifique qui fait comprendre toutes choses sur le modèle d’une fabrication artisanale.
La science consiste à saisir la relation de cause à effet qui existe dans le réel. Aussi, comprendre ou connaître un phénomène est-ce en saisir la cause.
Le modèle de la causalité physique est fourni à Aristote par l’analogie d’avec l’art. Sur la question du rapport entre l’art et la nature, il est formel, l’art n’est rien d’autre qu’une imitation de la nature. Il s’agira donc d’étudier la nature à la lumière de l’analyse de l’activité artistique. En quoi consiste alors l’art ?
Il consiste à concevoir le résultat à « produire »1 avant sa réalisation dans la matière. En effet, l’artiste a d’abord une certaine image de l’œuvre future à l’esprit avant de choisir le matériel adapté à sa structure. Toute fabrication présuppose donc l’idée ou le concept de l’objet à fabriquer. Cette manière d’agir qui consiste à prévenir, à calculer avant d’exécuter est la caractéristique de l’homme qui est illustrée ici au plus haut point (par l’activité artistique). Il y a donc toujours une « raison » à ce que fait l’homme ; sans cette raison qui est cause, rien n’arrive. La causalité est, nous dit Gilson, le terme de l’opération ; elle est « sa fin ».
Si l’homme procède ainsi, à plus forte raison la nature dont il participe. Il y a par conséquent dans la nature une finalité à l’œuvre sinon, comment expliquer l’ordre et le plan qui, manifestement, président à la constitution des êtres et les caractères constants des espèces ?
Il existe chez Aristote quatre causes : la cause matérielle (ce en quoi une chose est faite), la cause formelle (c’est le type, l’essence, ce qui donne à chaque chose sa forme déterminée), la cause efficiente (c’est l’antécédent direct qui provoque un changement) et la cause finale (le but en vue duquel tout le reste s’organise). C’est l’ensemble de ces causes qu’il faut connaître pour accéder à la science de l’objet ou de l’être en question.
Ainsi, l’on dira que le marbre est la cause matérielle de la statue, la cause formelle en est l’idée voulue par le sculpteur (le visage de Socrate par exemple). Les coups de ciseau en sont la cause efficiente. Et la cause finale de la statue c’est l’argent, ou la gloire ou encore la réalisation de la beauté.
A ce niveau, il faut remarquer que dans l’enchaînement des causes, la nécessité physique ne correspond pas à la nécessité logique. Si la logique veut que des prémisses soit inférée la conclusion, dans la nature par contre, ce qui est premier, c’est le but, la fin, de laquelle découleront, pour ainsi dire, les conditions nécessaires à son être. « Manifestement dit Aristote, la première des causes est ce que nous nommons la fin ». « Car elle est la raison d’être et la raison d’être constitue le point de départ dans les œuvres de la nature comme dans celles de l’art »1. La cause finale se rencontre donc aussi bien dans les productions artificielles de l’art humain que dans la nature où elle guide tout changement. Seulement, dans l’art humain, la fin est extérieure à l’objet qu’on façonne, dans la nature, elle lui est immanente.
Toute science a ses principes, les premiers, dont Aristote dit qu’ils sont indémontrables mais vrais parce qu’ils rendent intelligible un ordre entier de la nature par la lumière qu’ils jettent sur lui. C’est un ensemble de postulats qui fournissent à la science un cadre théorique nécessaire à son épanouissement. C’est ce que Thomas S. Kuhn appelle un paradigme c’est-à-dire, un ensemble de réalisations scientifiques qui définit les problèmes pertinents ainsi que les protocoles méthodologiques à mettre en œuvre pour arriver à leurs solutions. A quoi il faut ajouter des impératifs moraux et des postulats métaphysiques qui, loin de se limiter aux seuls cadres de la science, produisent au contraire, une vision globale du monde. C’est là un ensemble d’idées reçues sans lequel aucune communauté scientifique ne peut fonctionner. En effet, « la recherche réelle ne commence guère avant qu’un groupe scientifique estime qu’il est en possession de réponses solides à des questions telles que : quelles sont les entités fondamentales dont l’univers est composé ? Comment régissent-elles entre elles et agissent-elles sur les sens ? Quelles questions peut-on légitimement se poser sur de telles entités et quelles techniques employer pour chercher des solutions ? »2.
Pour Aristote, l’univers tout entier est contenu dans la sphère des étoiles fixes, et à l’intérieur de cette sphère, il n’y a que de la matière et point de vide. Il se divise en deux régions (la terre et les cieux) séparées par l’orbe de la lune d’où leurs noms respectifs de sublunaire et de supra-lunaire. La région sublunaire est faite de quatre éléments (la terre, l’eau, l’air et le feu). Dans ce monde-ci, entièrement contingent, règnent toutes les variétés du changement. Quant au monde supra-lunaire, auquel nous n’avons pas accès, il suffisait à Aristote d’observer le ciel pour se convaincre de l’immuable régularité de ses mouvements. Les cieux et les astres sont inaltérables, faits de cette cinquième essence qu’il appelle l’éther. Il va de soi qu’en raison du caractère incorruptible des corps célestes, les concepts physiques qui régissent le monde sublunaire ne valent pas pour le monde supra-lunaire justiciable d’autres normes.
Dans ce monde clos et hiérarchisé, il existe des natures bien déterminées, les choses ne sont pas distribuées d’une manière quelconque : «chaque chose possède dans l’Univers, un lieu propre, conforme à sa nature». Il y a donc un « lieu naturel » pour chaque élément et «c’est seulement dans « son lieu » que se parachève et s’accomplit un être, et c’est pour cela qu’il tend à y parvenir»1, sauf par contrainte. Ainsi, les éléments du monde sublunaire ont tendance à s’ordonner naturellement en une série de quatre enveloppes concentriques. La terre, élément absolument lourd, est portée par son mouvement vers la sphère située au centre géométrique de l’univers. L’eau, élément lourd, constitue une enveloppe sphérique autour de la région centrale de la terre. Le feu, qui est absolument léger, s’élève spontanément pour constituer sa propre enveloppe juste sous la sphère de la lune. Et l’air, moins léger que le feu, remplit la dernière enveloppe entre l’eau et le feu.2
Comment s’explique en définitive l’ensemble des mouvements (changement qualitatif ou quantitatif, déplacements dans l’espace…) dont l’univers est le théâtre ?
Rappelons-nous que, contrairement aux Eléates qui, niant tout changement, ne pouvaient rien comprendre de la réalité visible, Aristote part de la réalité du changement et s’efforce de l’expliquer. Aussi, dans son analyse du sensible le Stagirite dépassera-t-il Platon, puisqu’il n’opposera plus les deux absolus que sont l’être et le non-être, mais les réconciliera en plaçant entre eux un moyen terme qu’il dénomme l’être en puissance. Envisagée dans son sens fondamental, la puissance se réfère au mouvement lequel est nécessaire quant au passage de la puissance à l’acte. Le mouvement est donc un état passager ; il cessera lorsque la puissance s’actualisera. Le monde sublunaire serait en repos s’il n’était pas en contact avec l’orbe de la lune en mouvement perpétuel.
Mais, Aristote explique l’ensemble des mouvements en posant un premier moteur qui meut tout et que rien ne meut. C’est le Dieu d’Aristote qui est Acte pur, éternel, suprême intelligible et suprême désirable. Dans sa perfection, il ignore le monde auquel il demeure transcendant : il le meut sans contact, par amour. Ce Dieu est donc la cause finale de tous les mouvements de l’univers. La nature est un ensemble de puissances aspirant à la réalisation de cet acte, de cette beauté éternelle. Au demeurant, Aristote est un finaliste convaincu, et son univers tendancieux et désireux est régis par un principe d’ordre qui en fait un tout.
NAISSANCE ET EXPANSION DU MECANISME
Selon Thomas S. Kuhn, la science ne commence véritablement qu’avec Aristote qui, le premier, réussit à implanter de façon durable une manière d’étudier les phénomènes à la lumière d’une conception globale de la réalité. Il a établi et fait accepter un «paradigme», c’est-à-dire, un ensemble de « découvertes scientifiques universellement reconnues qui, pour un temps, fournissent à une communauté de chercheurs des problèmes types et des solutions »1.
Pour Aristote, comme nous le disions tantôt, l’univers est fini et hiérarchisé, c’est un ensemble ordonné et finalisé, avec d’une part le monde terrestre ( monde du changement, de la génération, de la corruption et des mouvements rectilignes vers le haut et le bas), et d’autre part, le cosmos qui est au delà de l’orbe de la lune (monde, de la non-physique et de l’éther), où les éléments (corps célestes) ne sont doués que d’un mouvement circulaire uniforme. Ce monde limité et clos a un centre et c’est la terre, rigoureusement immobile, qui y siège comme unique centre des mouvements célestes2. Ainsi, c’est l’homme qui habite au centre de l’univers, dans un lieu où les choses sont de soi ce qu’elles sont avec des « vertus » bien définies : il est de l’essence du léger (l’air et le feu) de s’élever et de celle du lourd (la terre et l’eau) de descendre.
La physique d’Aristote apparaît donc comme une physique des sympathies et des qualités métaphysiques et son astronomie inclut en elle toute la chaleur d’une conviction religieuse. En effet, l’anthropocentrisme (qui fait de l’homme le centre du monde ; il est le corollaire du géocentrisme), sous sa forme théologique pure, est lié au théocentrisme : Dieu a créé l’univers pour l’homme et l’homme pour lui ; pour l’adorer et le vénérer dira-t-on de nos jours.
Voilà fixée l’image du monde pour un bon bout de temps. Elle répond à un besoin psychologique profond de l’homme qui, en s’expliquant la relation de son habitat et le reste de la nature, cherche à intégrer l’univers et à s’y sentir à l’aise. C’est ce que le professeur Monod appelle «l’ancienne alliance animiste»3. Aussi longtemps qu’on gardera cette cosmologie, le système aristotélicien sera tout à fait satisfaisant. Ce qui arriva et l’ aristotélisme fut plusieurs fois séculaire.
En effet, Aristote, qui a vécu en Grèce au IV è siècle avant Jésus- Christ eut une influence sans précédent sur l’histoire des idées. Ses écrits couvrent tout le savoir de l’époque comme en témoignent les principaux titres de ses œuvres : l ’Organon (la logique), la Physique, la Métaphysique, l’ Ethique à Nicomaque, la Politique, la Rhétorique…
Pendant deux millénaires son autorité plana sur le savoir : son propre enseignement [-384 – -322 ] et la façon dont celui-ci a été décliné jusqu’au XVIIe siècle avec notamment la scolastique qui a fini d’en faire un dogme car, l’argument «Aristoteles dixit» (Aristote l’a dit) est sans réplique.
Jusqu’au XVIIe siècle, notons-le bien car ce siècle fut marqué par l’avènement de la pensée moderne à la suite de ce que l’histoire a appelé la « révolution copernicienne». Ce « fut une révolution d’idées, une transformation de la conception que se faisait l’homme de l’univers et de sa propre relation à l’univers »1. Il s’agit en somme de ce que Kuhn nomme un changement de paradigme. Pour mieux comprendre ce qui est ici en jeu, tournons-nous vers la lecture qu’il fait de l’histoire des sciences à travers sa grille paradigmatique.
Jusqu’alors, la science se réduisait à une activité routinière de résolution de petits problèmes à l’intérieur du champ théorique défini par le paradigme aristotélicien ; ce faisant, on prouve la fécondité du dit paradigme. Mais il peut arriver, nous dit Kuhn, que cette activité routinière soit perturbée par l’apparition de phénomènes inédits que le paradigme ne peut résoudre à l’intérieur de son cadre théorique. Ce qui arrivera au péripatétisme du fait d’un astronome polonais.
En fait, avant Nicolas Copernic [1473-1543] (c’est bien de lui qu’il s’agit), l’astronomie était dominée par le système de Ptolémée [ 90-168 ], mathématicien, astronome et géographe grec. Ce système exposé dans l’Almageste (son œuvre fondamentale), qui a pour socle la physique d’Aristote, va élaborer la formule la plus parfaite de la théorie géocentrique. Avec Copernic naquit une nouvelle cosmologie qui va permuter la place et la fonction de deux pièces essentielles du système précédent : la Terre et le Soleil, faisant de celui-ci le centre des mouvements des astres et des planètes dont la Terre qui, perdant son privilège de centre du monde, devient du coup une planète comme les autres. Ainsi, de Ptolémée à Copernic, ce qui change c’est la carte du ciel : la terre n’est plus, mais le soleil, le centre fixe à partir duquel les astronomes vont calculer les mouvements des astres et des planètes.
L’innovation copernicienne va créer ce que Kuhn appelle une «tension essentielle»1 entre les conservateurs qui cherchent à sauver le paradigme d’Aristote et les iconoclastes qui veulent aggraver les difficultés en les exacerbant.
C’est ainsi que Tycho Brahé et Kepler réfutèrent l’incorruptibilité des objets célestes après l’observation qu’ils firent des novae : étoiles qui brillent soudain avec éclat et s’éteignent. A leur suite, Galilée (mathématicien et astronome italien), muni de sa lunette astronomique, observa la lune dont il découvrit le relief accidenté qui s’apparente à celui de la terre, et les tâches du soleil. Il découvrit ensuite des nébuleuses de la voie lactée comme satellites, mais aussi et surtout les quatre satellites de Jupiter(alors que la terre n’en a qu’un à savoir la lune). Le savant florentin sonne ainsi le glas de la physique aristotélicienne et, partant, du géocentrisme, et consacre l’héliocentrisme en lui construisant une nouvelle physique avec le succès et les conséquences que l’on sait.
A partir de ce moment, le paradigme est en crise car toutes ces découvertes scientifiques sont des anomalies qui minent le système de l’intérieur en s’accumulant.
Finalement, la tension devint intenable et il se produisit une sorte de «basculement gestaltien», c’est-à-dire, une rupture radicale avec la vision du monde jusque là en vigueur. Le passage du géocentrisme à l’héliocentrisme fait voler en éclats l’image que l’on se faisait de l’homme et de l’univers. A la notion de cosmos (ensemble clos, hiérarchisé, finalisé, ordonné et incorruptible) se substitue celle d’univers (ensemble ouvert, homogène, indéfini et surtout sans finalité). Sur le plan scientifique, toutes les découvertes en astronomie partiront de ce changement conceptuel qui du reste, aura des conséquences bien au-delà de l’astronomie. « Bien que le mot de révolution soit au singulier, écrit Kuhn, l’événement fut multiple. Son noyau fut une transformation de l’astronomie mathématique mais qui embrassait des changements d’ordre conceptuel en cosmologie en physique et en philosophie aussi bien qu’en matière de religion »2
En effet, avec la nouvelle vision du monde, va naître une nouvelle philosophie, un nouveau «paradigme» qui définira une nouvelle manière d’appréhender les phénomènes. Il s’agit du mécanisme dont les héros sont Galilée et surtout Descartes. Le moment est venu pour nous de nous familiariser avec le nouveau paradigme en en exposant la structure et les principes de bases ou, si l’on préfère mieux, les postulats théorico-métaphysiques.
Le mécanisme est une philosophie de la nature selon laquelle l’univers et tout phénomène qui s’y produit peuvent et doivent s’expliquer par les lois des mouvements de la matière. André Lalande le définit comme une «théorie philosophique admettant qu’une classe de faits, ou même tout l’ensemble des phénomènes, est susceptible d’être ramené à un système de déterminations «mécaniques» »1. Les faits se donnent dans une combinaison d’organes ou parties disposées pour la production d’un fonctionnement d’ensemble. La doctrine mécaniste s’est constituée dans son opposition au finalisme et tient dans le corpuscularisme cartésien qui postulait que «l’univers était composé de corpuscules microscopiques et que tous les phénomènes naturels pouvaient s’expliquer par la forme, la taille, le mouvement et l’interaction de ces corpuscules »2. Si l’univers est exclusivement constitué de corps, il faut se demander ce qu’est un corps.
Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : L’ERE DE LA MECANISATION
I-La doctrine mécaniste : une réaction contre le finalisme
I-1- Le finalisme d’Aristote
I-2- Naissance et expansion du mécanisme
II- L’obstacle de la vie
II-1- Le dualisme cartésien
II-2- Le monisme radical
DEUXIEME PARTIE : LE BERGSONISME OU LE DEVELOPPEMENT DES IDEES «DERNIERES» DU MECANISME
I-Les limites de l’approche mécaniste du vivant
II- L’intuition-mère du bergsonisme : la durée
TROISIEME PARTIE : LE NOUVEL ECLAIRAGE DE LA DUREE
I-La théorie bergsonienne de la vie
I-1- Qu’est-ce que la vie
I-2- L’évolution de la vie
II-Le problème de la connaissance
II-1- De la connaissance scientifique : L’intelligence
II-2- De la connaissance métaphysique : L’intuition
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE