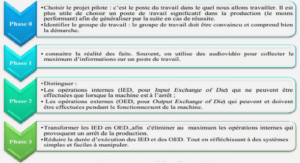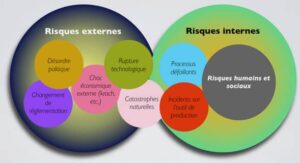Télécharger le fichier original (Mémoire de fin d’études)
L’égalité et le non-égoïsme « Le manque d’égoïsme est ce dont souffre l’humanité. »
Avant Jésus-Christ, certains penseurs, à l’instar de Platon, ont prêché la doctrine de l’égalité et en ont fait le socle sur lequel ils ont édifié leurs systèmes éthico-juridiques. Mais, c’est avec l’avènement du christianisme – un platonisme pour le peuple – que cette doctrine a connu sa plus grande vulgarisation26. Selon l’enseignement sacerdotal chrétien, seul Dieu, le créateur, est l’être suprême qui mérite d’être vénéré au plus haut degré par ses créatures. Les hommes, quant à eux, sont égaux puisqu’ils sont créés à l’image de Dieu27. Au nom de cette égalité, « le christianisme a livré une guerre à outrance, issue des recoins les plus secrets des mauvais instincts, à tout sentiment de respect et de distance d’homme à homme »28. Dans cette perspective, la seule hiérarchie légitime est celle qui place Dieu au-dessus de tout et les êtres humains au même rang. C’est pour rendre compte de cette hiérarchie que Jésus scinde la loi chrétienne en deux commandements et les fait reposer sur la notion d’amour. Le premier recommande l’amour de Dieu : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée »29 ; tandis que, le second préconise à l’homme l’amour de son semblable : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »30
Cet enseignement chrétien détermine notre mode d’être et de penser et, du coup, fait école dans nos institutions et nos instances de légitimation. Ainsi, dans tous les domaines, prévaut l’apologie du droit à l’égalité qui fonde l’égalité des droits. Dès lors, l’humanité elle-même se caractérise par ce que Nietzsche appelle métaphoriquement « la métamorphose en sable »31 qui figure l’indifférenciation absolue entre les individus et la confusion totale des genres, des rôles et des responsabilités. Avec la Révolution française, cette exigence d’égalité atteint son paroxysme. Et « les idées modernes » ne sont rien d’autre que l’acceptation et l’assimilation des thèses de cette révolution : rejet systématique de la hiérarchie et sanctification des principes de l’égalitarisme et du non-égoïsme (altruisme).
Ce passage de la genèse doit être pensé par rapport à celui-ci : « Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ-Jésus. » (La Sainte Bible, « Le Nouveau Testament », Epître de Paul aux galates, 3. 28, p. 215.) Cf. L ‘antéchrist, § 29, p. 78 : « Chacun est enfant de Dieu – Jésus n’exige absolument rien pour lui seul – chacun comme enfant de Dieu est l’égal de chacun… » (C’est nous qui soulignons.)
Or, aux yeux de Nietzsche, la doctrine de l’égalité telle que nous la retrouvons dans nos systèmes théologico-politiques – et qui passait pour un moyen d’instauration de la justice et, par conséquent, de restauration de l’ordre social – n’est qu’un malentendu puisque « les hommes ne sont pas égaux. Et il ne faut pas qu’ils le deviennent ! »32
La justice ne peut reposer sur l’égalité des droits qu’à l’intérieur d’un corps composé d’individus qui ont la même puissance et où prévaut l’esprit de corps. Dans ce corps – où l’équilibre de la force implique inévitablement l’équilibre de la terreur et où les conflits et les rivalités ne peuvent apporter que dommages et périls pour tous – les hommes doivent s’entendre et se garder de s’exploiter mutuellement33.
Mais, quand il s’agit d’établir un code juridique, par lequel il faut déterminer les interactions qui doivent exister entre les individus, ce principe d’égalité devient non opérationnel. Dès lors, toute justice qui fonctionne à partir de ce principe relève du ressentiment et de la vengeance venimeuse propre à la tarentule. Une telle justice n’est qu’un subtil subterfuge par lequel les faibles, les ré-actifs et les ratés promeuvent leur triomphe aux dépens des forts et des actifs. Elle n’est qu’injustice à l’égard de ceux qui adoptent une attitude juste face au tragique de l’existence34.
La véritable justice, puisqu’elle ne peut reposer que sur le droit à la différence et sur la différenciation des droits, doit être pensée par rapport au « pathos de la distance »35. Sa loi la plus fondamentale – qui, par la suite, engendre une poussière de prescriptions et de proscriptions basées sur le solide socle de l’égoïsme sain – est celle-ci : « Aux égaux, égalité, aux inégaux, inégalité […] et, ce qui s’ensuit nécessairement, ce serait de ne jamais égaliser des inégalités. »36 Donc, aux yeux de Nietzsche, l’égalité – considérée comme une valeur morale et un principe juridique recevable – n’est qu’un malentendu. Elle ne fonde rien et rien ne la fonde, si ce n’est le mensonge. Pourquoi affirme-t-on l’égalité ? N’est-ce pas pour mieux « vagabonder » ? A force de répéter « Un comme Tous »37 ne finira-t-on pas par dire « Un pour Tous » ?38
Selon l’enseignement du paragraphe 516 d’Aurore, c’est « fuir et haïr son moi, vivre dans et pour les autres – que l’on a appelé jusqu’à présent, avec autant de déraison que d’assurance, ‘‘ non-égoïste ’’ et, par conséquent, ‘‘ bon ’’ ! »39 C’est cette propension de l’ego à étouffer son égoïté, à se fuir et à se haïr afin de se noyer dans l’inconnaissable intimité de l’alter que Nietzsche appelle vagabondage40. Mais, ce vagabondage a un autre nom, un nom religieux : amour du prochain41. Ainsi, « la vie pour autrui », « l’amour désintéressé », « les motifs ‘‘ désintéressés ’’ » etc., sont autant de formules grâce auxquelles le moi altruiste s’évertue gauchement, comme le ferait une hétaïre, à légitimer son vagabondage. Or ce vagabondage – cette « perversion altruiste »42 que rien ne peut légitimer – est un danger pour le moi. Il constitue sa plus grande objection puisqu’il l’étiole, l’altère et, par conséquent, viole ses principes d’autoconservation. Dès lors, « le moi propre s’enlise dans l’autre, au point de perdre sa propre identité. JE devient AUTRE, le JE individuel est réduit au rang de moyen, d’instrument de l’assomption d’autrui. Le désintéressement prôné par l’alter, conduit au désintérêt, au désengagement pour son propre soi-même ; il entraîne l’absence, la perte de soi, ‘‘ selbstlos. ’’ »43 Qu’est-ce qui oblige l’ego à se nier et à éprouver du plaisir dans cette autonégation ?
Il faut être atteint du virus de la mauvaise conscience – cruelle maladie qui pousse continuellement les faibles à s’autotorturer – pour se faire instrument de sa propre négation44. Seuls la mauvaise conscience et son corollaire l’idéal ascétique peuvent obliger l’ego à se fuir, se haïr et, ce faisant, se faire du mal pour aller « à la rescousse du prochain »45. Donc, « derrière la très belle et très pure façade de l’altruisme »46 se cachent la mauvaise conscience et le ressentiment. Bien plus, le non-égoïsme – reposant sur les mêmes présupposés que l’égalitarisme – présuppose l’indifférenciation des hommes et leur nivellement puisqu’il s’oppose à tout clivage et à toute notion de rang. Voilà pourquoi Nietzsche nous met en garde contre l’altruisme : « c’en est fini de l’homme quand il devient altruiste »47. Mieux, « le meilleur fait défaut quand l’égoïsme commence à faire défaut. »48
Selon Nietzsche, l’ego sain – celui qui n’a pas la maladie de la mauvaise conscience et du ressentiment – est forcément égoïté et égocentrisme. Son rêve le plus fou est d’avoir un pouvoir sur toute chose afin de présider à la perpétuelle (re)création du monde. Autrement dit, l’égoïsme prôné par Nietzsche nous veut créateurs ; il renvoie l’ego à lui-même et à son égoïté afin qu’il puisse (se) créer et (se) recréer continuellement. Bien plus, il « est cette qualité de la vie à se vouloir elle-même pour elle-même, dans l’absolue différence et distance à tout ce qui n’est pas elle, […] il est l’expression de l’égoïté, l’affirmation d’un ego dont la structure n’est plus altruiste. […] Il invente des valeurs qui redonnent à l’individu son rôle créateur, nié par la morale, en libérant les forces de la vie. »49 Un tel égoïsme est un égoïsme innocent qui, en nous voulant créateurs, nous veut seuls et solitaires50 comme une oasis. Nous devons – tout comme l’oasis qui, se situant dans une bande de terre plus basse, ne se déverse pas dans son « alter » : le sable sec du désert – nous garder de vagabonder, en nous retranchant dans notre plus profonde solitude, pour créer. Car aucune création n’est possible au sein du vacarme de la populace qui ne croit ni aux créateurs, ni à la création. Cet égoïsme innocent – qui est d’autant plus « sain et sacré »51 qu’il se distingue de « l’égoïsme malade »52 des souffreteux saints et des faibles53 – nous met en garde contre les oisifs mendiants et les quémandeurs d’amour : le proche prochain ou le Dieu d’amour.
Au terme de cette section, un enseignement fondamental se dégage : les prédicateurs d’égalité et les non-égoïstes ont mené le même combat. Ils se sont donnés pour tâche fondamentale d’arroser, avec le sang sucé aux forts, le vénéneux arbre du ressentiment et de la mauvaise conscience dont l’un des fruits les plus amers est le nivellement des hommes par le bas et le « vagabondage » qui ne fait qu’étioler et effriter l’ego. Un autre fruit – un fruit non moins amer – de cet arbre, dont le feuillage et la floraison couvrent toute l’humanité, est la domestication de la bête-homme.
La domestication de la bête-homme
« Oh, cette bête homme délirante et lamentable ! Quelles lubies la traversent, quelle contre-nature, quels paroxysmes d’absurdité, quelle bestialité en idée surgissent dès qu’elle se voit tant soit peu empêchée d’être bête en acte ! … »
La critique que nous avons faite, dans la section précédente, des prétendues valeurs d’égalité et de non-égoisme a dévoilé le projet qui se cachait derrière la prétention avouée des égalitaristes et des altruistes d’œuvrer pour l’instauration de la justice. En castrant la volonté de l’homme et en étouffant son « insociable sociabilité », ceux-ci voulaient le dépouiller de son caractère iconoclaste afin de faire de lui un être docile, une bête de somme ou un « animal social ». Or ces prétendues valeurs, données à l’homme dès le berceau, n’auraient pas, à elles seules, suffi pour accomplir ce programme. Il a fallu inventer un subtil subterfuge par lequel les prédicateurs de morale – qu’ils soient théologiens ou philosophes – amènent l’homme à s’autoculpabiliser afin de s’autodomestiquer.
Mais les moralistes ne parlent pas de domestication ; bien plus, ils appellent amélioration de l’homme cette domestication54. Or, l’idée d’amélioration présuppose celle d’insuffisance et d’incomplétude ; seul celui qui est en décalage avec sa propre nature – celui qui n’est pas encore ce qu’il est ou ce qu’il doit être – a besoin d’être amélioré. Voilà pourquoi le propre des moralistes est de persuader l’homme qu’il est fondamentalement malade et qu’il a besoin d’une cure radicale55. C’est le christianisme qui a le plus persévéré dans cette voie de la domestication de l’homme56. Par quels moyens est-il parvenu à domestiquer l’homme ? Cette domestication peut-elle rendre meilleur l’homme ?
Ce qui fait le plus souffrir le souffrant ce n’est pas la souffrance, en elle-même, mais l’absence de sens de la souffrance. L’homme « ne dit pas non à la souffrance en elle-même ; il la veut, il la recherche même, à supposer qu’on lui indique un sens dont elle soit porteuse, un Pour cela de la souffrance. »57 Or, à l’homme, épris de ressentiment, qui accusait inlassablement les autres58, le prêtre ascétique donne une indication : « C’est bien cela, mon mouton ! il faut bien que ce soit la faute de quelqu’un : mais ce quelqu’un, c’est toi-même, c’est ta faute à toi seul, – tu es seul fautif à l’égard de toi-même : ! »59 Par ce raisonnement le prêtre donne à la souffrance un sens réactif. Il en fait la conséquence d’un péché – un châtiment – et un moyen de rachat : « Tu as fabriqué ta douleur parce que tu as péché, tu te sauveras en fabriquant ta douleur. »60 Ce raisonnement, même s’il est faux, permet au prêtre d’infléchir « la direction du ressentiment. »61 Dès lors, l’homme qui accusait les autres s’en prend à lui-même et intériorise aussi bien ses instincts de cruauté et de conquête que la souffrance qui découle de cette intériorisation. Sans la mauvaise conscience62 – qui n’est rien d’autre que cette double intériorisation – la domestication de l’homme, qui seule peut faire de lui un être social et sociable, serait impossible. Il a fallu inventer les notions de péché, de châtiment pour faire croire à l’homme qu’il a à l’égard de Dieu une dette qu’il ne peut pas rembourser afin de le lier à son passé religieux dont il ne pourra plus se détourner. Un tel homme devient inévitablement incapable de penser la pluralité de possibilités et de perspectives que renferme le futur. Cette conscience devenue mauvaise conscience n’est capable que d’une chose : accroître sa douleur. Le christianisme profite de cette mauvaise conscience de l’homme – état de maladie dans lequel il l’a plongé – pour le rendre plus malade en lui donnant un mauvais traitement, un traitement inadapté à sa nature : l’idéal ascétique. Il lui fait aimer tout ce qui le débilite et le rend souffreteux afin de faire de lui un membre de la société, un chiffre du grand nombre.
L’homme est la somme de ses instincts63 mais le christianisme – pour faire de lui une bête de somme – lui apprend à mépriser et à maudire ses instincts de liberté, de grandeur, de conquête et de cruauté et, ce faisant, à ne faire valoir que ses instincts grégaires. L’homme est également instinct sexuel mais le christianisme lui apprend à avoir honte de sa sexualité. Le christianisme a livré une âpre lutte contre les passions et les désirs de l’homme mais il n’a pas mené cette guerre de façon intelligente. Il n’a pu adopter que des moyens radicaux comme l’extirpation et la castration64. La formule que Nietzsche cite pour fustiger la radicalité de ces moyens se trouve dans Le Nouveau Testament65 : « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le ; mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu, que d’avoir deux yeux et d’être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt pas, et où le feu ne s’éteint pas. »66 La méthode qu’utilise ici le christianisme pour combattre l’instinct sexuel est celle qui « consiste à associer à l’idée de satisfaction »67 d’un désir ou d’une passion la pénible pensée de la géhenne – feu éternel – au point que la satisfaction devient elle-même pénible68. Cette pratique du christianisme, consistant à lutter contre les instincts et les passions, est, qu’on l’appelle amélioration ou domestication – nuisible à la vie69 et à l’homme. L’homme domestiqué n’est ni amélioré, ni rendu meilleur ; il devient un avorton, un castrat. Bien plus, avec cette cure sacerdotale ou ce sacerdoce curatif, « je crains que les animaux ne considèrent l’homme comme un de leurs semblables qui à perdu le bon sens animal de manière extrêmement dangereuse, comme l’animal délirant, comme l’animal rieur, comme l’animal pleurnichard, comme l’animal malheureux. »70
Alors n’est-il pas temps que l’homme se libère de son passé socioreligieux pour penser les perspectives de l’avenir ?
LA MORT DE DIEU
Le sens de l’événement
« Si nous ne faisons de la mort de Dieu un grand renoncement et une perpétuelle victoire sur nous-mêmes, nous aurons à payer pour cette perte. »
La volonté de puissance, l’enseignement sacerdotal chrétien. Cette interprétation « théologico-apologétique »71 selon laquelle Jésus serait une victime innocente morte sur la Croix pour la rémission de nos péchés et le rachat de l’humanité – ce qui ferait de lui un moyen de nous rapprocher de Dieu – témoigne du génie et de la mauvaise foi de Saint Paul. Elle est, à tous égards, irrecevable : « Dieu lui-même se sacrifiant pour la faute de l’homme, Dieu lui-même se faisant payer par lui-même, Dieu comme la seule instance qui puisse racheter l’homme de ce qui pour l’homme même est devenu impossible à racheter – le créancier se sacrifiant pour son débiteur, par amour (faut-il le croire ? –), par amour pour son débiteur !… »72 Donc, aux yeux de Nietzsche, la crucifixion est le moyen par lequel le Christ voulait « donner publiquement la preuve la plus frappante, la démonstration de sa doctrine »73 mais Saint Paul s’est emparé de cet événement pour en faire un « sacrifice expiatoire ». Ce faisant, il réinterprète négativement la doctrine du Christ74. Voilà pourquoi Nietzsche, dont l’une des tâches les plus importantes est de sauver l’humanité des dérives de cette interprétation qui escamote la vie du sauveur, soutient l’idée fondamentalement subversive selon laquelle ce qui est aujourd’hui considéré comme chrétien découle non pas de l’enseignement du Christ mais de la falsification de Paul : « Paul a compris que le mensonge – que ‘‘ la foi ’’ était nécessaire ; plus tard l’Eglise à son tour a compris Paul. »75
Table des matières
INTRODUCTION GENERALE
PREMIERE PARTIE : CRITIQUE DES VALEURS MORALES
INTRODUCTION DE LA PREMIERE PARTIE
CHAPITRE I : LA MORALE : UNE OBJECTION CONTRE LA VIE
CHAPITRE II : LA MORT DE DIEU
1°) Le sens de l’événement
CHAPITRE III : L’APPROCHE DU DERNIER HOMME
1°) L’immoralité des derniers hommes
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
DEUXIEME PARTIE : L’ETHIQUE DU DEPASSEMENT
INTRODUCTION DE LA DEUXIEME PARTIE
CHAPITRE II : LA VERTU DE L’AFFIRMATION
1°) La nouvelle vertu
CHAPITRE III : LES TRAITS DE LA NOUVELLE « COMMUNAUTE »
1°) L’éternel retour : fondement d’une nouvelle éthique
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE