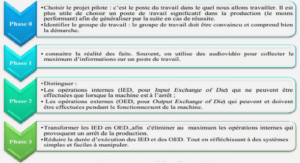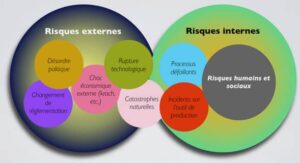Télécharger le fichier original (Mémoire de fin d’études)
Une pensée globale des médiations
Il nous faut tout d’abord préciser la manière dont nous définissons le concept de médiation, car il « renvoie à des réalités très différentes » (Rouzé, 2010, p. 2). Parmi les nombreuses approches communicationnelles sur cette notion 1, notre conception des médiations se situe du côté d’une définition des médias, et se structure à deux niveaux interdépendants l’un de l’autre. Nous considérons tout média (dont le cinéma) comme une « médiation sociale » (Martín-Barbero, 2003, p. 334) et « comme la configuration dynamique et complexe de multiples médiations techniques, économiques, sociales, symboliques » (Gil, 2011, p. 29). Le premier niveau renvoie à la « médiation médiatique » présentée par les sociologues des médiacultures, c’est-à-dire l’idée que « les médias ne sont qu’une forme (une ressource) parmi d’autres de construction de la réalité sociale » (Maigret et Macé, 2005, p. 11). C’est ainsi que le cinéma, tout comme « [l]a presse, la radio, la télévision, au même titre que les romans, les disques ou encore les jeux, font partie des moyens de socialisation et de diffusion culturelle dans lesquels prend forme la représentation que la société moderne se donne d’elle-même » (Kaufmann et Voirol, 2008, p. 14). Comme le précisent Laurence Kaufmann et Olivier Voirol, cette « représentation [sociale] est normative » (ibid., p. 14), et les médias et les objets culturels se déploient dans la sphère politique et « participent d’un dispositif idéologique » (Rueda, 2010, p. 5). C’est dans ce cadre que Jean Davallon définit les médias à la fois comme un « lieu d’interaction [socialement défini] entre le récepteur et les objets, images, etc. », et comme un « lieu de production de discours social 2 » (Davallon, 1992, p. 103). Les médias sont des médiations qui « relie[nt] des acteurs sociaux à des situations sociales » (ibid., p. 102). Il propose donc de les étudier sous l’angle « de leur opérativité symbolique » (ibid.).
Définir les médias comme des discours sociaux permet de relier cette première approche à un second niveau de compréhension des médiations. Jean Davallon s’appuie sur l’exemple de la télévision pour montrer que les médias se structurent à partir de plusieurs relations sociales qui, ensemble, forment « un espace social » (ibid., p. 103) : Au-delà de la technologie de communication, il s’établit donc une véritable relation sociale entre ce qui est présenté et celui (ou ceux) qui sont récepteurs. À un niveau plus large, ce dispositif social s’enrichit d’un grand nombre de pratiques annexes : en amont, ce sont les relations sociales que la production des émissions nécessitent, et en aval, ce seront les relations entre les acteurs (discussions sur l’émission et références à elles, par exemple). 3 (Davallon, 1992, 103)
De ce fait, il s’agit de « rompre avec l’idée d’une chaîne, d’un parcours linéaire allant de l’œuvre ou de l’objet au spectateur ou au visiteur en passant par une série d’intermédiaires (techniques, institutionnels, humains) » (Hennion, 2004, p. 30). C’est plutôt l’idée de circulation qui prévaut ici dans la mesure où les médias sont configurés par une multitude de médiations dont chacune contribuent à le transformer. Dans ce cadre, l’imbrication de ces deux perceptions des médiations nous fait rejoindre l’approche d’Antoine Hennion qui explique que : le mot [médiation] ne désigne pas la simple mise en rapport d’« objets » artistiques ou culturels déjà là (et plus ou moins bien compris, fréquentés, reçus) et de publics tout constitués (définis par leurs propriétés socio culturelles : milieu, origines, revenus, habitat, formation, « pratiques culturelles », etc.). De même, il ne désigne pas un métier, une position parmi d’autres, mais « ce qui se passe » ou ce qui agit, aussi bien dans une œuvre ou une prestation que dans la saisie d’un spectateur ou d’un pratiquant, produisant quelque chose d’irréductible à ce qui existait avant cette rencontre. (Hennion, 2004, p. 30)
Cette définition des médiations détermine une posture méthodologique particulière. Concrètement, il s’agira de saisir le cinéma hatke comme un mouvement culturel configuré par un ensemble de médiations techniques, économiques, institutionnelles, sociales et symboliques. Nous nous appuyons plus précisément sur les travaux de Jesús Martín-Barbero en considérant qu’« il faut envisager les processus de communication du point de vue des médiations et des sujets, c’est-à-dire, du point de vue de l’articulation entre pratiques de communication et mouvements sociaux » (Martín-Barbero, 2002, p. 21). Nous articulerons notre analyse du caractère contre-hégémonique du cinéma hatke à celle des conflits de définition de la réalité sociale indienne existants au sein des médiacultures indiennes. Toutefois, notre approche étant communicationnelle et non sociologique, l’apport théorique des médiacultures demande à être adapté pour pouvoir saisir l’ensemble des médiations. En effet, la méthode proposée par Éric Macé se focalise sur le « point de vue des “usagers” [et les représentations], tout en délaissant les processus complexes de fabrications des produits culturels eux-mêmes » (Rueda, 2010, p. 11). De même, il est nécessaire de tenir compte du caractère géographiquement et historiquement situé de tout phénomène culturel, ce qui implique l’actualisation des concepts employés. Éric Macé prolonge la réflexion d’Edgar Morin sur la définition de la culture de masse. Il en vient à la définir comme suit : compte tenu d’un contexte de production qui comprend tout autant les contextes de réception, l’espace public et les industries culturelles, les médiacultures sont nécessairement ambivalentes (principe synchronique de diversité), syncrétiques (principe de proposition mythologique), réversibles (principe diachronique d’instabilité interne et externe aux industries culturelles) et ambiguës (intégration synchronique des principes de diversité et d’instabilité dans les « textes »). (Macé, 2006, p. 73)
Pour autant, cette « actualisation de cette approche “macro” du phénomène reste insuffisante » (Gil, 2011, p. 424). En effet, « la culture de masse […] accompagne les évolutions techniques et sociales, mais la configuration de la culture de masse elle-même mérite d’être actualisée à la lumière d’études portant sur l’évolution de ses dispositifs médiatiques » (Gil, 2011, p. 424). Cette méthode se retrouve enfin limitée par son : approche globale [qui] tend à masquer la diversité des organisations médiatiques (les dispositifs de la télévision, de l’édition vidéo, d’Internet sont différents et n’offrent pas le même genre de relation à leurs publics) ; les spécificités institutionnelles nationales ; ainsi que les spécificités liées à la diversité des registres de discours médiatiques (information, fiction, jeu). (Gil, 2011, p. 425)
À la suite de Muriel Gil, nous pensons qu’il est « difficile de traiter d’un seul bloc les médiacultures », sous peine de « masquer la diversité des organisations médiatiques […] ; les spécificités institutionnelles nationales ; ainsi que les spécificités liées à la diversité des registres de discours médiatiques » (Gil, 2011, p. 425). Nous retrouvons, une fois encore, l’importance de contextualiser un apport théorique en fonction du terrain de notre étude. C’est pour éviter cela que nous avons souhaité, d’un côté, « questionner les usages des [films] (en production, comme en diffusion et en réception) et leurs représentations, de réinscrire l’objet dans son processus de communication (soit le tissu des activités humaines et médiations qui lui donnent forme) » (Gil, 2011, p. 32) et, d’un autre côté, traiter conjointement l’hégémonie du cinéma hindi et le caractère contre-hégémonique du cinéma hatke. Les propositions méthodologiques de Jesús Martín-Barbero nous ont alors permis de dépasser ces limites.
Il opère, en effet, « un déplacement méthodologique pour re-voir le processus entier de la communication depuis son autre côté, celui de la réception, celui des résistances qui s’y appliquent, celui de l’appropriation envisagée du point de vue des usages » (Martín-Barbero, 2002, p. 20). Son approche communicationnelle s’appuie sur l’idée de la communication comme une relation plutôt que comme un moyen 1. Cette méthode permet de tenir compte « des pratiques et des trajets de consommation complexes 2 » (Rueda, 2010, p. 4), mais également de la matérialité des objets culturels 3 (leurs caractéristiques techniques et leurs logiques de production). Concrètement, analyser les médiations consiste à porter notre attention sur les « lieux d’où viennent les contraintes qui délimitent et configurent la matérialité sociale et l’expressivité culturelle » du cinéma (Martín-Barbero, 2002, p. 178). Les « logiques de production et de réception » (ibid.) ne sont ainsi plus analysées séparément, mais de manière conjointe. C’est dans ce cadre, par exemple, que nous étudierons le cinéma hatke en prenant tout autant en compte le point de vue des acteurs de sa production que celui des différentes communautés interprétatives 4. Nous avons également rapproché les deux axes production et réception à travers une hypothèse que nous avons émise sur l’émergence du cinéma hatke. Nous sommes, en effet, partie de l’idée que les cinéastes sont à la fois acteurs et spectateurs : leur pratique artistique (la réalisation de film) est étroitement liée à leurs expériences en tant que spectateurs de cinéma, et notamment de films bollywoodiens. Autrement dit, le point de vue contre-hégémonique du cinéma hatke s’est construit à partir du statut des cinéastes en tant qu’acteurs au sein des industries culturelles (par une confrontation à un modèle esthétique dominant) et en tant que spectateurs des films bollywoodiens (rejet d’une représentation dominante de la société indienne).
Ce point de vue transversal a donc pour objectif d’appréhender le cinéma hatke dans toute sa complexité. La construction de notre « approche communicationnelle et culturelle des médias » (Rueda, 2010, p. 8) a cependant nécessité un long cheminement théorique. Nous proposons de rendre compte, dans une première partie, de cet effort de conceptualisation effectué dans un va‑et‑vient continu entre la théorie et l’empirique. Il s’agira tout d’abord d’interroger les concepts d’hégémonie et de culture populaire (chapitre I), puis celui de cinéma national (chapitre II), pour délimiter le cadre théorique pour l’étude de la construction hégémonique de Bollywood, puis de la réaction contre-hégémonique du cinéma hatke. Dans un troisième chapitre, nous préciserons notre approche communicationnelle du cinéma hatke ainsi que la méthode d’analyse que nous avons construites à partir de ces premières explorations théoriques (chapitre III). Une deuxième partie sera consacrée à l’exploration des industries cinématographiques indiennes où nous étudierons la construction hégémonique du cinéma bollywoodien (chapitre I) puis sa relation avec l’imaginaire national (chapitre II). Nous expliquerons comment nous avons adopté une approche méthodologique rapprochant et articulant des concepts empruntés aux Cultural Studies mondiales et à l’économie politique critique de la communication (EPC). Cette perspective nous permettra de définir le système hégémonique bollywoodien comme un des lieux de contrainte à l’émergence et à la production du cinéma hatke. Dans le dernier chapitre de cette partie, nous analyserons plus précisément la manière dont un cinéma hatke a pu émerger au regard de ce contexte aussi contraignant (chapitre III). Nous reviendrons également sur notre conceptualisation du cinéma hatke au regard des autres formes cinématographiques alternatives existantes. Enfin, la troisième et dernière partie de cette thèse portera plus précisément sur la construction contre-hégémonique des films hatke du corpus à travers leurs structures énonciatives (chapitre I) leur hybridation, (chapitre II) et leur fonction discursive (chapitre III). Dans une lecture synthétique et transversale de nos précédents résultats d’analyse, nous reviendrons à une conceptualisation de notre objet où nous préciserons les différents termes de la définition du cinéma hatke.
Une approche théorique et méthodologique décentrée
Les concepts d’hégémonie et de culture populaire au cœur des Cultural Studies indiennes
L’Inde connut une longue période d’instabilité politique entre les années 1970 et 1990, marquée par de nombreux conflits inter-communautaires. Le projet politique de construction d’une nation indienne séculariste qui avait été mis en place à l’indépendance en 1947 se retrouva fortement contesté. Il a en effet changé plusieurs fois de lignes directrices depuis les années 1960 lorsque la fille de Nehru, Indira Gandhi, devint Premier Ministre 1. Ce contexte politique et social fortement agité fut accompagné d’une crise épistémologique du côté des sciences humaines et sociales. Les concepts de culture et d’identité se retrouvèrent au cœur des débats. Plusieurs sous-champs disciplinaires 2 — Subaltern Studies, Women studies, Dalit critique —, le plus souvent repérables par le morphème « « studies », firent leur apparition. Leur émergence résulta à la fois d’un mouvement d’opposition à des disciplines universitaires jugées « coloniales », et du développement d’« une critique du nationalisme » (Niranjana, 2012, p. 28) qui s’articula aux mouvements sociaux survenant à cette époque. Ces différents courants furent par la suite regroupés sous le champ des Cultural Studies indiennes dans les années 1990. Le rejet de certaines disciplines et le contexte socio-politique dans lequel se trouvait le pays contribuèrent fortement à la redéfinition des concepts d’hégémonie et de culture populaire.
Avant de regarder de plus près ce travail de reconceptualisation par les chercheurs indiens, il nous semble cependant nécessaire de revenir sur le parcours historique de ces concepts. Ce premier chapitre retrace donc le cheminement théorique des notions d’hégémonie et de culture populaire à partir duquel s’articule notre problématique centrale. Nous retracerons leurs parcours depuis leur définition par Antonio Gramsci, pour ensuite faire un détour par les Cultural Studies britanniques 3 avant de nous arrêter plus précisément sur le travail de redéfinition qui s’est opéré dans le champ des Cultural Studies indiennes. Nous conclurons ce chapitre en explicitant la manière dont nous convoquerons nous-même ces concepts dans le cadre de notre étude. L’approche historique de ces concepts à partir de ces trois moments s’inscrit ainsi plus largement dans un processus de décentrement méthodologique que nous avons présenté en introduction.
De Gramsci aux Cultural Studies britanniques
L’importance des écrits d’Antonio Gramsci dans le champ critique de la culture n’est plus à présenter. Il existe une riche littérature 1 sur la façon dont ses travaux théoriques ont exercé une forte influence sur les approches marxistes de la culture, au point d’avoir suscité un véritable tournant gramscien dans la « problématique du pouvoir » (Mattelart et Neveu, 2008, p. 37). Nous présenterons donc ici quelques-uns de ses éléments définitoires de l’hégémonie puis de la culture populaire. L’un des principaux apports de Gramsci a été de permettre un « déblocage, d’un point de vue marxiste, de la question culturelle et dans la mise en évidence de la dimension de classe de la culture populaire » (Martín-Barbero, 2002, p. 84). Au sein des Cultural Studies britanniques, Raymond Williams et Stuart Hall ont été parmi les premiers à s’inspirer des travaux de Gramsci pour construire leur appareil théorique autour des questions de domination, d’ »effet idéologique » et de culture populaire. Raymond Williams a développé son modèle théorique de la « culture dominante » en repartant du concept gramscien d’hégémonie (Williams, 2005 [1973]). Stuart Hall a consacré plusieurs de ses articles à l’importance de la pensée gramscienne sur ses propres réflexions sur les subcultures, les cultures contre-hégémoniques, ou encore sur les concepts de race et d’ethnicité 2. De son point de vue, les travaux de Gramsci ont joué un rôle essentiel dans le renouvellement du paradigme marxiste des Cultural Studies, « pour le rendre plus pertinent par rapport aux relations sociales contemporaines 1 » (Hall, 2005b, p. 411).
Définition gramscienne de l’hégémonie et de la culture populaire
L’hégémonie est un des principaux concepts repris dans les travaux portant sur la culture populaire, ou la « culture ordinaire » pour reprendre une expression de Raymond Williams (1989, p. 3-18). Antonio Gramsci développa ce concept afin de proposer une alternative à celui d’idéologie. Il conçoit avec Marx que « les idées dominantes sont les idées de la classe dominante » (Mattelart et Neveu, 2008, p. 37), mais si l’idéologie définit une « subordination statique, totalisante et passive » (Forgacs, 2000, p. 424), entraînant une forme d’ »aliénation » des groupes populaires, l’hégémonie :
permet [au contraire] de penser le processus de domination sociale non plus comme une imposition de l’extérieur et sans sujets, mais comme un processus au cours duquel une classe impose son hégémonie dans la mesure où elle représente des intérêts que les classes subalternes reconnaissent aussi, d’une certaine manière, comme leurs (Martín-Barbero, 2002, p. 84).
L’hégémonie, en tant qu’expérience vécue, « est toujours un processus. Ce n’est pas, sauf analytiquement, un système ou une structure 2 » (Williams, 1977, p. 112). Elle n’existe qu’à partir d’une alliance entre plusieurs classes dominantes, formant un « bloc historique » (Forgacs, 2000, p. 424) qui exerce une « autorité sociale totale » (Gramsci, 1978, p. 180). Autrement dit, ces « fractions de la classe dominante […] ne détiennent pas seulement le pouvoir de contraindre, mais
[…] elles s’organisent activement de manière à commander et à obtenir le consentement des classes subordonnées à leur continuelle emprise » (Hall, 2008, p. 42-43). L’hégémonie se distingue ainsi de l’idéologie en ce qu’elle se construit en articulant coercition de l’État et consentement des classes subordonnées. Elle se différencie également en prenant en compte la dimension culturelle dans les processus de domination sociale, et non plus uniquement les dimensions économiques et politiques. Cependant, si l’hégémonie est éthico-politique, Gramsci insiste aussi sur la nécessité de prendre en compte sa dimension économique. L’hégémonie doit « reposer sur la fonction décisive exercée par le groupe dominant au sein du noyau décisif de l’activité économique 3 » (Gramsci, 2000, p. 212). En ce sens, l’hégémonie se définit à la fois comme une domination qui est « culturelle, morale et idéologique » (cultural, moral and ideological) et par le rôle central de la classe dominante sur le plan économique. Elle est toutefois « politiquement sécurisée par les concessions économiques et les sacrifices [de la classe dominante] envers ses alliés 1 » (ibid., p. 422). L’hégémonie prend forme à la fois au niveau de l’État et des superstructures que sont « la famille, le système éducatif, l’Église, les médias, les institutions culturelles » (Hall, 2008, p. 43). Elle se structure aussi sur le plan idéologique, dans la mesure où « les « définitions de la réalité » favorables aux fractions de la classe dominante […], finissent par constituer la « réalité vécue » élémentaire en tant que telle pour les classes subordonnées » (ibid.). De fait, elle conditionne une certaine vision du monde (ce qui inclut les définitions du monde qui s’y opposent) et en fixe les limites. Elle fait l’objet de luttes constantes et nécessite « d’être gagné[e] et assuré[e] activement, [au risque sinon] d’être perdue[e] » (ibid.). Ce caractère dynamique induit plusieurs choses. Tout d’abord, l’hégémonie se caractérise comme un « processus continu de formation et de remplacement d’un équilibre instable » (Forgacs, 2000, p. 422-23). De ce fait, une hégémonie n’entraîne pas la disparition des cultures subalternes puisqu’une « complémentarité réussie relie les classes et les cultures hégémoniques et subordonnées 2 » (Hall, 2008, p. 44). L’hégémonie entraîne alors des luttes permanentes entre classes dominantes et classes subalternes, et un équilibre ne peut être trouvé que lorsque les classes dominantes font preuve de concessions envers les classes subordonnées « pour obtenir [et conserver] consentement et légitimité » (ibid.). C’est en ce sens que l’hégémonie participe aussi aux « intérêts généraux des groupes subordonnés » (Forgacs, 2000, p. 205). Enfin, cette permanente déconstruction et reconstruction de l’hégémonie nécessite de tenir compte de l’existence de « différentes formes d’hégémonie selon les situations historiques différentes et les classes d’acteurs impliqués » (ibid. p. 422-423). L’analyse d’une hégémonie doit ainsi s’inscrire dans ses « conjonctures historiques » (Hall, 2008, p. 44).
Cet élargissement du concept d’idéologie par celui d’hégémonie « redéfinit la notion de pouvoir afin de donner tout son poids à ses aspects non coercitifs » (ibid., p. 45). Autrement dit, l’hégémonie « se fait et se défait, se refait de manière permanente au cours d’un « processus vécu » contenant non seulement de la force mais aussi du sens, de l’appropriation de sens par le pouvoir, de la séduction et de la complicité » (Martín-Barbero, 2002, p. 84-85). Cela induit alors « une réévaluation de la consistance du culturel : [comme] un champ stratégique dans la lutte car espace articulateur de conflits » (ibid.). La réflexion de Gramsci sur la culture s’inscrit dans la prise en compte de la conscience du peuple, c’est-à-dire des « autres conceptions du monde » que sont la religion, le folklore et le langage courant (Gramsci, 2000, p. 323). Le langage y prend toute son importance dans les processus hégémoniques : « tout langage contient les éléments d’une conception du monde » (ibid., p. 324), et de ce fait participe à l’influence de cet imaginaire sur d’autres (et l’élargit ensuite aux influences politiques et culturelles), autant par « un simple contact quotidien ou à travers la médiation d’un système éducatif et d’autres chaînes de communication culturelle » (ibid.). Il est important de noter que Gramsci écrit à une époque de transition culturelle vers la modernité (ibid., p. 363) et ne s’intéresse à la culture que dans « sa conception des changements révolutionnaires en tant que processus où les mentalités et comportements populaires sont transformés » (ibid.). C’est donc dans ce cadre qu’il définit le folklore en tant que culture populaire. Pour lui, le folklore devrait être étudié comme : une « conception du monde et de la vie » implicite, dans une large mesure, aux strates de la société déterminées (dans le temps et l’espace) et en opposition (également dans l’ensemble implicite, mécanique, objective) aux conceptions « officielles » du monde (ou en un sens plus large, aux conceptions des couches cultivées de la société) apparues au cours de l’évolution historique. 1 (Forgacs, 2000, p. 360)
De fait, le « folklore ne peut être compris que comme un reflet des conditions de la vie culturelle du peuple » (ibid., p. 361). Gramsci considère « la culture populaire et le folklore comme contenant les « sédiments » ou résidus de formes culturelles dominantes précédentes qui restent du passé et qui ont été associées aux autres formes » (ibid., p. 364). Il est par ailleurs important de noter que Gramsci est assez critique vis-à-vis du contenu même de la culture populaire. Le folklore est par exemple défini dans son opposition à une culture d’élite (donc dans une formulation négative). Cependant, il insiste sur la nécessité de se départir d’une image du folklore comme « pittoresque » ou « excentrique » et de prendre sérieusement en compte cette culture pour comprendre les conceptions populaires du monde et « entraîner la naissance d’une nouvelle culture parmi les vastes masses populaires, de sorte que la séparation entre la culture moderne et la culture populaire ou folklore » finira par disparaître (Gramsci, 2000, p. 362). Gramsci développe son analyse du folklore à partir de plusieurs concepts comme celui de « national-populaire », qui désigne d’un point de vue culturel, « les formes d’art et de littérature qui aide à cimenter une sorte d’alliance hégémonique : ni « intellectualiste », ni « cosmopolite » mais étant engagée avec une réalité populaire et attirant les publics populaires » (ibid., p. 423-424). Il s’appuie aussi sur la notion de « sens commun », autre terme qu’il donne au folklore et qui est directement lié au concept d’hégémonie, dans la mesure où « les groupes oppressés acceptent la définition du monde des élites en tant que sens commun 2 » (Mukerji et Schudson, 1991, p. 15). Pour Gramsci, le sens commun est un facteur important dans le processus hégémonique car il agit au niveau de la conception du monde de la classe dominante qui s’impose et intègre les multiples conceptions du monde, parfois contradictoires, que chaque groupe social développe. Ce sens commun est alors « accepté et vécu de manière acritique » (Forgacs, 2000, p. 421) par le peuple et contribue à sa subordination en faisant apparaître « les situations d’inégalité et d’oppression [comme] naturelles et inchangeables » (ibid.).
Table des matières
Introduction
Partie I. Une approche théorique et méthodologique décentrée
Chapitre I. Les concepts d’hégémonie et de culture populaire au coeur des Cultural Studies indiennes
I. De Gramsci aux Cultural Studies britanniques
II. Émergence des Cultural Studies indiennes
III. Conclusion
Chapitre II. Le cinéma indien au coeur des constructions identitaires
I. Panorama des Film Studies indiennes
II. Une affinité entre cinéma et nation : redéfinir le national
III. Cinéma national : déconstruction d’un concept
IV. Conclusion
Chapitre III. Définition d’une approche communicationnelle du cinéma hatke
I. Présentation de notre corpus d’analyse
II. Construction d’un point de vue communicationnel sur notre objet de recherche
III. Conclusion
Partie II. Une approche médiaculturelle de l’industrie cinématographique indienne
Chapitre I. Construction hégémonique du Cinéma hindi : Bollywood
I. Construction méthodologique
II. Réorganisation de l’industrie du cinéma indien dans les années 1990
III. Du cinéma hindi à l’industrie culturelle Bollywood
IV. Conclusion
Chapitre II. Bollywood et l’imaginaire national indien
I. L’imaginaire national dominant depuis les années 1990
II. Bollywood : une forme culturelle en constante évolution
III. L’hégémonie de Bollywood au coeur du soft power indien
IV. Conclusion
Chapitre III. Émergence d’une nouvelle forme cinématographique : le cinéma hatke
I. Des formes cinématographiques alternatives
II. Un mouvement culturel hatke au coeur des industries culturelles indiennes
III. Conclusion
Partie III. Le cinéma hatke, un mouvement culturel contre‑hégémonique
Chapitre I. La structure énonciative des films : entre fiction et documentaire
I. Construction symbolique du territoire indien dans les films hatke
II. Représentation fictionnelle de faits sociaux réels
III. Conclusion
Chapitre II. L’hybridation des films hatke en tant que genre cinématographique
I. Appréhender les spécificités génériques des films hatke
II. Discours réflexifs sur une pratique cinématographique hatke
III. Hybridation esthétique des films hatke
IV. Conclusion
Chapitre 3. Construction de discours contre‑hégémoniques : un processus de démythologisation culturelle
I. Discours hatke sur les paradoxes de la modernité indienne
II. Synthèse conceptuelle : définir le cinéma hatke
III. Conclusion
Conclusion générale
Retour sur la recherche
Limites et perspectives
Retour sur la posture de recherche
Bibliographie
Annexes