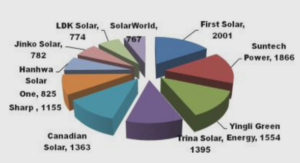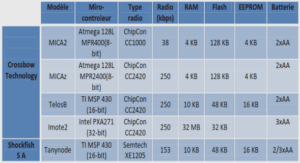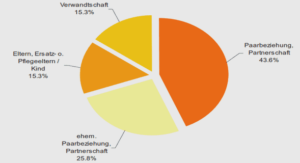DU VOYAGE AU TOURISME
À une époque où l’industrie du tourisme est plus que florissante, il semble opportun de se pencher sur les origines du voyage en Europe, sur le Grand Tour comme sa matrice pédagogique et culturelle. Le déplacement à l’étranger aura mené à l’énigme de la différence des mœurs et le cosmopolitisme à l’éveil des consciences non encore éclairées. Si le tourisme se nourrit de textualités – guides, sites web, etc. –, le voyage s’avère indissociable du récit qu’il suscite, de ce genre littéraire quelque peu hybride (entre document et fiction) qui requiert davantage qu’une approche littéraire, fût-elle géocritique (selon cette discipline que le regain d’intérêt pour les lieux a engendrée), car il mobilise des considérations anthropologiques, historiques et philosophiques. Le voyage, qui a toujours suscité soit l’opprobre soit l’engouement, est-il désormais menacé par l’ubiquité virtuelle et par les flux globalisants ? La villégiature de masse signe-t-elle la fin du sentiment du divers ? Gageons qu’il y aura toujours un recoin propice au dépaysement. Historiquement le voyage fut toujours proscrit comme source de dispersion, de dégradation morale, bref d’égarement, et son récit jugé frivole, inutile, dangereux. À l’instar des utopies, les voyages étaient considérés comme autant de remises en cause de la Providence divine, responsable de l’ordre immuable des choses, et la curiosité du voyageur comme attention accordée à l’inessentiel : « Les pèlerins, mus par la dévotion, sont depuis longtemps invités, lorsqu’ils se déplacent sur les routes, à ne poser leur regard et à ne faire halte qu’auprès des monuments et des reliques liés à leur cheminement de croyants ».
Même la géographie amoureuse de la Carte de Tendre (et non du Tendre, comme on a coutume de le dire, car Tendre est un nom de pays) incitait à suivre un parcours balisé, jalonné de lieux saillants, de villages galants dont on ne pouvait s’écarter sous peine de se fourvoyer, en somme de se perdre (au sens physique et moral) dans la « Mer Dangereuse » ou dans les « Terres inconnues », voire d’aboutir au « Lac d’Indifférence ». Le voyage profane semble à plus forte raison porter en lui le germe de la dissidence : ainsi Montaigne, animé par un but non plus votif mais voulant se faire plaisir et s’instruire, revendique-t-il dans ses Essais l’errance, le vagabondage, la divagation : « Je respons ordinairement à ceux qui me demandent raison de mes voyages : que je sçay bien ce que je fuis, mais non pas ce que je cherche », ce qu’on pourrait inscrire dans une « esthétique de la digression répondant aux exigences du scepticisme » : « Je m’esgare : mais plustost par licence, que par mesgarde. […] mon stile, et mon esprit, vont vagabondant de mesmes » ou, plus prosaïquement : « S’il faict laid à droicte, je prens à gauche ; si je me trouve mal propre à monter à cheval, je m’arreste. […] Ay-je laissé quelque chose à voir derriere moy ? J’y retourne ; c’est tousjours mon chemin. Je ne trace aucune ligne certaine, ny droicte ny courbe ».
Dans son Journal de voyage en Italie (1580-1581), qui n’avait pas vocation à être publié, il récidive, prétendant qu’il n’a « nul project que de se promener par des lieux inconnus », quoiqu’on sache que ce son long périple (de 13 mois) avait un dessein curatif : guérir sa gravelle ou maladie de la pierre, à tel point que ce Journal a été qualifié d’« histoire thermale et diététique » par son préfacier M. de Querlon, deux siècles plus tard. Toutefois, dès lors que le corps est capricieux, le voyage l’est aussi.Le voyage moderne dépasse en effet les métaphores théologiques de l’homo viator comme perfectionnement moral. Une petite révolution épistémologique s’observe à l’époque classique : l’expérience prime désormais sur la connaissance livresque, la pratique sur la théorie. On compte parmi les voyageurs des érudits, des scientifiques, des militaires, des commerçants, qui éprouvent tous le besoin de rendre compte par écrit de cette expérience. Surgit alors le récit de voyage, mais le droit chemin est bien vite écarté.
Or, à l’époque des Lumières un paradoxe s’observe dont le Chevalier de Jaucourt se fait le porte-parole. D’une part, le voyage trouve sa légitimité dans sa fonction expérimentale, ses vertus pédagogiques ou thérapeutiques, d’autre part, le récit de voyage est stigmatisé pour les mensonges qu’il véhicule : « D’ordinaire les voyageurs usent de peu de fidélité. Ils ajoutent presque toujours aux choses qu’ils ont vues, celles qu’ils pouvoient voir ; […] de même qu’ils trompent leurs lecteurs ensuite[1] ». Le voyage ne pêche dès lors plus par manque de rectitude, mais par manque de fiabilité : c’est sa facticité qui est hypothéquée par une sincérité suspecte, engendrant le thème du voyageur menteur et mystificateur, en proie aux « infidélités », « aux tentations de la fiction “littéraire”[2] ». Dans la formule « Ils ajoutent presque toujours aux choses qu’ils ont vues, celles qu’ils pouvoient voir », le pouvoir libérateur (les possibles narratifs) s’oppose au devoir régulateur, comme si avec le pouvoir, qui dans le spectre des modalités s’oppose au devoir, resurgissait la déviance morale (au niveau de l’énoncé) dans un voyage qui n’était plus répréhensible qu’au niveau de l’énonciation.