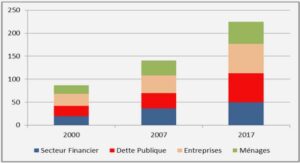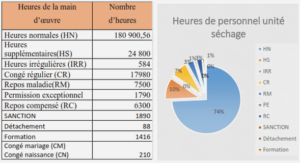Télécharger le fichier original (Mémoire de fin d’études)
La fabrique de l’esprit entrepreneurial.
La notion d’entrepreneur ne décrit donc pas qu’une pratique économique. Elle n’est pas uniquement le fait des entrepreneurs, mais désigne plus largement un objet construit socialement. Elle est donc appelée à être redéfinie constamment par les personnes qui posent un regard sur la pratique entrepreneuriale. Or, comment un ensemble d’émetteurs, issus des Etats-Unis, ont-ils dissipé ces possibilités de représentation sociale en créant un esprit entrepreneurial unilatéral, fondé sur une éthique libertarienne et enraciné dans l’imaginaire du capitalisme et de la réussite ?
a) Une pratique économique enracinée dans l’imaginaire du capitalisme et de la réussite.
D’après un sondage quantitatif de l’institut Think32, mené auprès d’un panel de 1000 Français, une majorité de sondés (47%) définissent l’entrepreneuriat comme « la capacité à créer des emplois et de la richesse économique ». Pour comprendre les significations que l’on attribue à l’action de l’entrepreneur dans la société française, nous avons posé une série de questions, similaires à celle de l’étude citée, à un groupe de 10 français ayant entre 20 et 25 ans33. En explorant la manière dont ils se représentent spontanément la figure de l’entrepreneur, nous remarquons tout d’abord l’abondance d’adjectifs et de noms évoquant la quête de réussite. Selon eux, l’entrepreneur est un individu qui emploie un ensemble de ressources psychologiques (« courage », « persévérance », « audace ») pour s’enrichir personnellement ou pour obtenir un certain pouvoir au sein de la société (« ambition, leadership »). Selon le groupe interrogé, la fin économique de l’entrepreneur – l’accumulation de richesses et le travail – se confond avec ses aspirations personnelles (la reconnaissance sociale, l’ambition). Ces deux éléments de réponse nous permettent de poser l’hypothèse que la figure de l’entrepreneur contemporain est l’agrégation de deux imaginaires sociaux : l’imaginaire du capitalisme et l’imaginaire de la réussite.
Pour Max Weber, l’esprit du capitalisme se forge à travers une éthique protestante du travail34. Pour lui, certains courants du protestantisme ont établi une relation de causalité entre le travail et la notion de prédestination. L’idée centrale de l’éthique protestante est que l’homme peut accéder à la vie éternelle par le travail. Cette sanctification du labeur, que le sociologue allemand appelle beruf, est une injonction divine à laquelle l’homme doit obéir. Le travail n’est plus un moyen. Il devient une vocation, une fin en soi. Or, le capitalisme exige selon lui un dévouement au travail et une vocation à gagner de l’argent. Ce système économique trouve donc une justification morale dans les valeurs du protestantisme, qui sont incorporées dans son éthique : « Le devoir s’accomplit dans l’exercice d’un métier, d’une profession, c’est l’idée caractéristique de l’ « éthique sociale » de la civilisation capitaliste35. » Ainsi, l’éthique protestante du travail dispose l’individu à l’adoption de pratiques économiques et de comportements qui, à travers le goût du travail et la volonté de gagner de l’argent, encouragent le déploiement du système capitaliste. Or, si l’on se réfère au portrait brossé par le panel de jeunes français interrogés, on remarque que l’entrepreneur est, à leur sens, l’individu qui cherche à accumuler des richesses par le fruit de son travail. La représentation qu’ils s’en font semble donc obéir à la théorie de Weber sur l’esprit du capitalisme, puisque l’entrepreneur se définirait selon eux par la valeur qu’il accorde au travail et à l’argent.
L’entrepreneuriat semble donc accolé, dans les représentations collectives des français, à l’imaginaire du capitalisme et de la réussite. Cet imaginaire est stimulé par ce que l’on pourrait appeler une éthique contemporaine de l’entrepreneuriat, issue de la rencontre entre la pensée libertarienne et la psyché de la Silicon Valley.
La naissance d’une éthique entrepreneuriale libertarienne
La rencontre entre la pensée libertarienne, un courant intellectuel et politique qui irradie les Etats-Unis à partir des années 1960, et la nébuleuse économique de la Silicon Valley au début des années 1980, contribue à la naissance d’une éthique entrepreneuriale contemporaine36. Ayn Rand, une écrivaine américaine d’origine russe, est une figure de proue de ce courant. A travers ses romans, l’écrivaine participe à l’expansion de l’idéologie libertarienne. Dans La Grève et La Source Vive, elle narre l’épopée moderne des entrepreneurs américains, et fait de son oeuvre littéraire un manifeste politique de la pensée libertarienne. Le recours à une forme romanesque permet à l’auteure d’atteindre un public large, et de créer une « nouvelle vague randienne37 » à partir des années 1980. Lue par ce que l’on a coutume d’appeler les « pionniers du web » – les entrepreneurs de la Sillicon Valley – la pensée de l’écrivaine se réincarne à travers le discours d’entrepreneurs américains. Nous essayerons de voir dans ce paragraphe comment ses idées, qui irriguent le discours des entrepreneurs de la Silicon Valley, fabriquent une éthique de l’entrepreneuriat.
A travers le concept d’ « égoïsme rationnel », Ayn Rand élabore une éthique de la vertu individuelle où « l’égo est la source vive du progrès humain ». A la fin de son roman La Grève, on peut lire la phrase suivante : « Ma philosophie, par essence, est le concept de l’homme en tant qu’être héroïque, avec son propre bonheur comme objectif moral de sa vie, avec l’accomplissement productif comme sa plus noble activité, et la raison son seul absolu38. » Pour elle, l’homme vertueux est donc un individu égoïste, rationnel et entrepreneur. La conception individualiste du rôle de l’entrepreneur est la profession de foi du courant libertarien. L’oeuvre d’Ayn Rand bouscule ainsi le paradigme schumpetérien, qui fait de l’entrepreneur un vecteur de progrès pour la société, en faisant de l’entrepreneur un vecteur de progrès pour lui-même. Un glissement s’opère donc sur notre objet d’étude : l’entrepreneur n’est plus un agent économique qui change ou qui est changé par la société, mais une fin pour lui-même. Son égoïsme rationnel ne peut s’accomplir qu’à travers des conditions sociales et politiques favorables.
Pour Ayn Rand, le libéralisme est le cadre économique qui favorise le plus son épanouissement car il permet d’atténuer le pouvoir de l’Etat, et d’étendre ses libertés individuelles. L’Etat est, selon elle, une entrave à la liberté d’entreprendre car il favorise la collectivité plus que l’individu39. Peter Thiel, un entrepreneur américain à l’origine de la création de Paypal, radicalise le rejet du collectivisme énoncé par Rand, en appelant au rejet des institutions publiques par la technologie40. Cette rhétorique anti-étatique s’inscrit au coeur de son activité économique, puisqu’il crée la société Thiel Fellowship, qui a vocation à concurrencer les institutions scolaires et universitaires. Les libertariens des années 1960 et les entrepreneurs américains de la fin du XXème siècle envisagent l’économie de marché comme un cadre de référence qui mesure la valeur de l’action humaine et récompense les personnes qui entreprennent. Cette conception du monde oppose les entrepreneurs, qui sont des créateurs et des bâtisseurs, aux « assistés » et aux « pillards 41», c’est-à-dire aux personnes qui n’entreprennent pas. Les uns sont glorifiées car ils font avancer le progrès, les autres sont dévalorisés car ils s’opposent à son avancement.
Or, comment cette dualité morale, entre la figure héroïque de l’entrepreneur et la figure avilie du non-entrepreneur, peut-elle être unificatrice au sein de la société ? Autrement dit, comment l’esprit entrepreneurial, qui célèbre les inégalités entre les hommes, parvient-il à se rendre désirable ?
La fabrique d’un état de nature entrepreneurial.
La naissance de l’homo entrepreneurius
Comme le souligne Silvio Lorusso dans son essai Entreprecariat: Everyone is an Entrepreneur. Nobody is safe42, l’entrepreneuriat affecte l’imaginaire collectif par l’influence prégnante des entrepreneurs américains de la Silicon Valley sur les médias sociaux. Mark Zuckerberg joue, selon lui, un rôle important dans l’expansion de l’esprit entrepreneurial car il détiendrait le plus grand média du monde : Facebook. De la même manière, les 5 entreprises américaines qui dominent le marché du numérique (surnommées les « GAFAM ») forment un continent médiatique influent. Or, comme l’affirme Patrick Sénincourt, « les territoires sont de moins en moins locaux, de plus en plus planétaires, globaux. Le périmètre potentiel d’action des entrepreneurs s’élargit singulièrement, en
particulier lorsque leur marché intérieur est limité en volume43. » Ainsi, la globalisation des échanges, marquée par la mondialisation des flux de marchandises et d’informations, offre un terreau communicationnel propice à l’expansion du mythe entrepreneurial à travers le monde. Mais comment un mythe, dont la fonction est de « fournir une signification au monde et à l’existence humaine44 » (Mircea Eliade), peut-il faire d’une pratique économique singulière un message universel et fédérateur ? L’arôme individualiste, libertarien et rationaliste de l’esprit entrepreneurial, que nous avons identifié précédemment, semble contenir une contradiction majeure. D’un côté, il voit en l’homme un égoïste rationnel à la recherche de l’accomplissement individuel, et de l’autre, l’érige en bienfaiteur du progrès au service de l’intérêt général. Pour réconcilier ces deux postures contradictoires, les entrepreneurs américains, que nous avons identifié comme les figures tutélaires du mythe entrepreneurial, s’attachent à naturaliser la figure de l’entrepreneur. Mohammed Yunus, un entrepreneur et économiste spécialisé dans le microcrédit, affirme45 :
« All human beings are entrepreneurs. When we were in the caves, we were all self-employed… finding our food, feeding ourselves. That’s where human history began. As civilization came, we suppressed it. We became ‘labor’ because they stamped us, ‘You are labor’. We forgot that we are entrepreneurs46. »
On retrouve ici l’idée que chaque être humain détient en lui une fibre entrepreneuriale, qui lui aurait été transmise héréditairement. La société aurait étouffé les velléités entrepreneuriales de l’homme en lui faisant croire qu’il n’est qu’un travailleur. La naturalisation de l’entrepreneuriat étend donc l’acception du terme entrepreneur. Capable de subvenir à ses propres besoins, il est un agent économique qui se suffit à lui-même. Il est sa propre ressource. Or, si tout le monde possède un gène entrepreneurial, cela signifie, d’un point de vue communicationnel, que tout le monde peut devenir entrepreneur. Devenir entrepreneur consisterait à révéler la nature d’homo entrepreneurius (néologisme) qui sommeille en chacun de nous, et dont la société nous écarte. L’entreprise, ou la start-up, est l’hétéropie de l’entrepreneur. Elle est le lieu où il peut accomplir ce passage pour revenir à son état de nature. La fougue entrepreneuriale, comme invariant de la nature humaine, est rationalisée par le discours des entrepreneurs américains. La relativité des sciences économiques, qui élaborent une pluralité de modèles pour saisir la réalité entrepreneuriale, est évacuée par un discours tautologique où chaque être humain devient un homo entrepreneurius. Le caractère particulier et unique de son individualité est essentialisé. Il n’y a plus d’opposition entre les entrepreneurs et les « assistés47 » puisque tout le monde est ontologiquement un entrepreneur. Une posture commune émerge de ce discours : celle de l’entrepreneur de lui-même.
b) L’entrepreneur de lui-même : un creuset communicationnel et une dimension narrative favorables à l’identification.
Dans Naissance de la biopolitique48, Michel Foucault analyse l’idéologie du néolibéralisme américain, et cherche à caractériser ses spécificités. Il ne le réduit pas à un système économique mais à « une manière d’être et de penser ». L’esprit néolibéral américain est porté par les économistes de l’école classique, dont Adam Smith et David Ricardo sont les figures tutélaires. Pour Foucault, un biais méthodologique et idéologique alimente leurs travaux de recherche. Ils véhiculent une vision déshumanisante du travail car ils réduisent le travail au temps de travail. Le travail est envisagé comme une donnée quantitative. Or, on ne peut pas saisir la réalité du travail si on réduit le travailleur à une variable de temps. Il faut le sortir de la posture de l’objet, et l’envisager comme un sujet économique à part entière. En partant du principe que le travailleur est un sujet économique doté d’une compétence, et qu’il produit grâce à elle du capital – qu’il perçoit comme un revenu – on admet que le travailleur est le producteur de son propre revenu, ou plus précisément de ses propres flux de revenus (car son revenu n’est pas ponctuel mais régulier). De ce fait, l’individualité du travailleur ne peut pas être séparée de son travail. A la fois « machine-compétence » et « individu humain 49», il est son propre revenu et le porteur de son propre revenu. C’est un entrepreneur de lui-même : « étant à lui-même son propre capital, étant pour lui-même son propre producteur, étant pour lui-même la source de ses revenus 50». L’entrepreneur de lui-même est l’individu qui cesse d’envisager toute dissonance entre son travail et son individualité. Il met en place des stratégies d’investissement dans sa propre entreprise, lui-même, pour obtenir une amélioration de son capital humain. Foucault affirme que le changement de paradigme de la pensée néolibérale – où le travail n’est plus envisagé comme une variable de temps mais comme une stratégie personnelle qui vise la réalisation de soi – est le passage de la figure impersonnelle de l’homo oeconomicus à la figure personnifiée de l’entrepreneur de lui-même51. Parce qu’il cherche à améliorer sa condition économique ou son capital socio-culturel, l’entrepreneur de lui-même est nécessairement un individu imparfait. Or, nous avons vu que le mythe entrepreneurial se fonde sur une naturalisation de l’entrepreneur. En admettant que l’homme est un animal entrepreneurial, on suppose qu’il est capable de surmonter ses imperfections naturelles par la force de sa volonté et de ses actions. C’est sur cette possibilité de conquête individuelle que se construit le mythe contemporain de l’entrepreneuriat : la conquête de soi, par soi, pour soi. On peut donc penser que le tour de force idéologique des entrepreneurs américains de la Silicon Valley est d’avoir dépolitisé la pensée libertarienne et individualiste d’Ayn Rand, pour en faire un discours universel centré sur l’accomplissement personnel. On peut vérifier cette hypothèse en étudiant le discours de certains entrepreneurs américains influents, comme celui des initiateurs de la hustle culture ». La « hustle culture » est une culture du travail issue des Etats-Unis, qui vise principalement les jeunes américains52. Le verbe « Hustle » peut être traduit en français par le verbe bousculer ou pousser. La forme nominale de ce mot signifiant tumulte, bousculade. Plus précisément, c’est le Moi de chacun qui doit être l’objet d’une bousculade. La « hustle culture » désigne une injonction où l’individu est poussé et encouragé à agir en faveur de lui-même. Le média américain Medium attribut l’origine de ce mouvement à l’entrepreneur américain Gary Varnerchuk53. Sur le site de son entreprise One37pm, on peut lire un bref manifeste du mouvement : « The current state of entrepreneurship is bigger than career. It’s ambition, grit and hustle54. » L’entrepreneuriat est conçu comme une posture qu’il faut intérioriser. Comme le souligne le journaliste américain Eric Griffith, il s’agit de « glorifier l’ambition non comme une finalité, mais comme un style de vie55 ». A travers l’entrepreneuriat, l’individu est donc encouragé à exploiter et à optimiser ses ressources individuelles pour devenir flexible, productif et performant. Par ailleurs, l’intégration du concept d’entrepreneur de lui-même dans le mythe entrepreneurial contemporain semble offrir un cadre énonciatif favorable à l’élaboration de récits de soi. A travers les réponses de notre premier questionnaire56, on constate que les représentations que se font les jeunes français de la figure de l’entrepreneur se verbalisent par l’emploi de formules standardisées de présentation. L’entrepreneur est « son propre patron », travaille « à son compte », élabore un « projet de vie » et crée « son propre métier ». Il ne se définit plus par son entreprise, mais par sa disposition à prendre son destin en main. L’entreprise se dissout dans le Moi de l’entrepreneur. Ce qui semble montrer que la notion d’entrepreneur de soi-même s’incarne dans un langage performatif où sa subjectivité est exaltée. Dans « Transformations et centralité du récit de soi dans la société biographique. Le sujet dans la cité57 », la chercheuse Christine Delory-Momberger soutient cette idée :
« Ces assimilations de l’individu à l’entreprise, loin de constituer de simples métaphores, relèvent d’un nouveau « discours de l’homme » et définissent une nouvelle norme subjective ».
On peut également penser que l’individualisation du mythe entrepreneurial multiplie les possibilités d’identification : personne peut s’identifier à tout le monde, mais tout le monde peut s’identifier à soi-même. La naturalisation de l’entrepreneur et le concept d’entrepreneur de lui-même favorisent donc l’existence d’un espace narratif où l’individu peut se reconnaitre dans le mythe entrepreneurial. Comment un ensemble d’acteurs parviennent à s’emparer de ce mythe et à l’utiliser pour faire de l’entrepreneur une figure désirable et identifiable au sein de la société ? Autrement dit, comment un logos et un ethos entrepreneurial se construisent à travers le discours et la posture des prescripteurs de l’entrepreneuriat ?
Le logos entrepreneurial en France : un discours performatif de l’accessibilité.
Pour comprendre comment ce mythe est relayé au sein de la société française, nous examinerons dans un premier temps le logos des prescripteurs français de l’entrepreneuriat, c’est-à-dire l’ensemble des arguments qu’ils mobilisent pour inciter les jeunes à entreprendre. En particulier, nous analyserons un choix d’éléments de langage émis par les acteurs publics français à propos de l’entrepreneuriat, sur le mode de la citation ou de la petite phrase. La parole publique n’est pas uniforme. L’entrepreneuriat est un sujet de débat public qui génère des clivages politiques et partisans. Notre démarche ne consiste pas à proposer un état des lieux de ces oppositions, mais de dégager les contours d’une parole performative de l’accessibilité, où les individus sont incités à adopter une posture commune. Ensuite, nous proposerons une étude semio-discursive de la marque Koudetat, pour voir comment ce mythe s’incarne dans la parole des entrepreneurs français influents. Le choix de cette entreprise s’explique par l’influence prégnante qu’elle exerce auprès des jeunes français.
De l’Etat-nation à la « start-up nation ».
En mai 2016, Emmanuel Macron, qui occupe le poste de ministre de l’Economie et des Finances, se déplace dans la ville de Lunel pour sensibiliser une classe d’élèves à l’entrepreneuriat58. A cette époque, le climat social est agité. Le débat public français est marqué par des clivages idéologiques et politiques autour de la loi Travail. Deux hommes invectivent le ministre, qui leur rétorque aussitôt : « Vous n’allez pas me faire peur avec votre tee-shirt : la meilleure façon de se payer un costard, c’est de travailler59 ». Cette courte phrase, signe de l’agacement du ministre, contient en elle-même plusieurs indications intéressantes sur la manière dont le gouvernement français élabore son discours sur l’entrepreneuriat. Les vêtements sont significatifs de l’opposition symbolique soulevée par Ayn Rand, que nous avons nommé au cours de notre première partie (les entrepreneurs contre les « assistés »). Il y a d’un côté une France des t-shirts, vêtement envisagé ici comme un symbole de dépouillement et de misère, et de l’autre, une France des costumes, qui incarnerait la réussite et l’opulence. Le travail est ici conçu comme une valeur calviniste permettant à l’individu d’atteindre une position sociale élevée. Cette position sociale est liée à l’obtention d’argent, incarnée par le prix élevé du costume, par opposition au faible prix du t-shirt. On voit donc que derrière cette phrase anodine, prononcée dans un moment de tension, se dessine une vision particulière du travail, sanctuarisé comme la condition sine qua non de l’émancipation individuelle. Elle est la mise en mot d’une injonction sociale. Pour réussir, il faut travailler. Pour travailler, il faut optimiser son capital humain. Emmanuel Macron appelle donc, en creux, la société française à devenir des entrepreneurs d’eux-mêmes, et à retirer le voile déterministe qui obstrue la capacité de chacun à réussir. Ce regard injonctif nous rappelle une phrase prononcée par l’acteur Christian Lude dans le film Le Voleur60, dans lequel il joue le rôle d’un aristocrate. Alors qu’il se promène dans la rue avec son fils, il croise un mendiant qui fait l’aumône sur le trottoir. Il alpague ce dernier, et lui recommande de ne pas demander de l’argent aux passants, mais d’obtenir de l’argent par lui-même : « Ne faites pas l’oiseau, travaillez ».
Cette rhétorique injonctive pose l’idée que le travail est le résultat de la volonté individuelle. Il s’agit de se mettre dans une disposition optimiste pour pouvoir réussir. La célèbre formule de Nicolas Sarkozy « La France qui se lève tôt61 » est une isotopie62 de la petite phrase de Macron. Porter un costume, se lever tôt, ou « traverser le trottoir pour trouver un travail63 », relèvent du même motif. A travers ce type d’énoncé performatif, l’individu est incité à la performance et à la productivité. Une scission unificatrice peut se lire en creux : les élites incarnent la réussite, le peuple incarne la possibilité de la réussite. Ce qui permet de réunir l’élite et le peuple dans un idéal commun est le fait que chacun puisse, par le biais du travail et de l’exigence qu’il s’impose à soi-même, accéder à la réussite. On peut donc penser qu’il existe un discours politique où le peuple, destinataire fictif de la parole politique, est appelé à se mettre en mouvement. Le parti politique initialement appelé « En Marche » est, à cet égard, une métaphore de la démarche entrepreneuriale. Il suggère un mouvement, un élan vers l’avant, qui nous rappelle la définition littérale du mot entrepreneur, entendu comme la personne accomplissant ce qu’elle se donne à faire. On remarque que la récurrence du motif du travail peut avoir un lien direct avec la communication d’influence qui vise à promouvoir l’entrepreneuriat à destination du plus grand nombre. Pour la chercheuse Sarah Abdelnour64, les politiques publiques françaises s’attachent, depuis le début des années 1990, à promouvoir l’entrepreneuriat auprès des classes populaires. Cette incitation à entreprendre s’incarne dans un discours ambivalent. Les politiques récupèrent le mythe entrepreneurial d’inspiration libertarienne et néolibérale, et le croisent avec l’imaginaire de l’insertion professionnelle. L’entrepreneur est à la fois celui qui se meut, par la force de ses ressources personnelles, vers le chemin de sa propre réussite, et celui qui se donne les moyens de s’insérer sur le marché du travail. L’oscillation entre une rhétorique de la liberté d’entreprendre et une rhétorique de l’insertion par le travail trouve son incarnation dans le régime de l’auto-entrepreneur et la figure de l’« entrepreneur occasionnel65 », où l’indépendance et l’autonomie permises par l’obtention de ce statut, s’opposent à la dépendance et l’aliénation promises par le modèle salarial. Comme l’affirme la chercheuse, « cette politique gouvernementale est ainsi symptomatique de nouvelles formes de légitimation de l’entrepreneuriat, au croisement du mot d’ordre « tous patrons » et de l’injonction à « travailler plus pour gagner plus »66. » On remarque donc qu’un discours injonctif, qui s’appuie à la fois sur des arguments libéraux et socialistes, s’immisce au sein de la société française. Il participe à l’élaboration d’un modèle social, à la construction d’une société entrepreneuriale, ou plus précisément, d’une « start-up nation67 ».
On peut lire cette expression, popularisée par Emmanuel Macron, comme un pléonasme ou un oxymore. En admettant qu’elle est un pléonasme, on désigne la volonté politique de créer de la valeur (richesse, emploi) pour le pays en favorisant le développement des start-up françaises. En admettant qu’elle est un oxymore, on pose l’idée que l’univers des start-up constitue une nation à part entière, une utopie où tout le monde pourrait entreprendre. Cette formule résume toute l’ambivalence de la position du gouvernement français sur l’entrepreneuriat : est-ce que la société entrepreneuriale signe l’effacement de l’Etat-nation par la start-up nation ? Ou est-ce que la start-up nation n’est qu’une formule de remplacement ou un adjectif qualifiant l’identité d’une nouvelle nation, enracinée dans un monde globalisé, où tout le monde peut et doit devenir un entrepreneur
?
On constate qu’il existe un décalage entre la vocation universelle de la formule « start-up nation », et la manière dont celle-ci est perçue au sein de la société française. En reprenant les résultats de notre premier questionnaire, on constate que les représentations que se font les jeunes français de la nation entreprenante sont très marquées sociologiquement. En effet, les entrepreneurs sont perçus comme des urbains, disposant d’un capital socio-culturel élevé et de ressources économiques qui peuvent leur permettre de devenir entrepreneur. Pour reprendre l’expression de David Goodhart68, l’Etat oppose dans son discours les entrepreneurs « de partout » aux entrepreneurs de « quelque part ». Les « gens de partout » possèdent un sentiment d’appartenance globale. Ils ne se sentent pas enracinés dans le pays ou le territoire où ils habitent. Leur référentiel n’est pas la communauté locale, nationale ou religieuse, mais la communauté humaine. Or, ce référentiel universel, qui se veut fédérateur, est paradoxalement mis en échec par
les représentations que se font les jeunes français de l’entrepreneuriat69, qui voient dans la communauté des entrepreneurs une bulle ouverte sur le monde économique, mais fermée sur le monde social. En d’autres termes, on lit à travers les réponses de ce questionnaire que l’entrepreneuriat n’est pas un rêve accessible à tous. Il existe bien une dissonance entre le discours tenu par le personnel politique, et la manière dont la réalité entrepreneuriale est perçue par les jeunes français. Les personnes sondées admettent qu’il existe une start-up nation, mais que celle-ci ne produit pas un sentiment d’appartenance national. En d’autres termes, la start-up nation est un lieu de reproduction sociale qui favorise l’entre-soi et la formation des élites.
Table des matières
Introduction
PARTIE 1 : De l’agent économique à l’ « entrepreneur de lui-même », ou la fabrique d’un mythe entrepreneurial
I. Qu’est-ce qu’un entrepreneur ?
a) L’entrepreneur, un agent économique et un vecteur de progrès pour la société
b) L’évolution des représentations de l’entrepreneuriat au sein de la société française
II. La fabrique de l’esprit entrepreneurial
a) Une pratique économique enracinée dans l’imaginaire du capitalisme et de la réussite
b) La naissance d’une éthique entrepreneuriale libertarienne
III. La fabrique d’un état de nature entrepreneurial
a) La naissance de l’homo entrepreneurius
b) L’entrepreneur de lui-même : un creuset communicationnel et une dimension narrative
favorables à l’identification
PARTIE 2 : Comment ce mythe est-il réinvesti par les prescripteurs français de l’entrepreneuriat, qui façonnent par leur discours et leur posture, l’ethos de l’entrepreneur contemporain ?
I. Le logos entrepreneurial en France : un discours performatif de l’accessibilité
a) De l’Etat-nation à la « start-up nation »
b) De l’Etat au « Koudetat » : le softpower d’Oussama Ammar
II. La fabrique de l’ethos préalable de l’entrepreneur contemporain par les entrepreneurs : l’exemple de la marque Koudetat
a) S’identifier à des figures communes : le hacker et le « divergent thinker »
b) La culture de l’échec, le mythe de l’ascension sociale et le culte de l’homme ordinaire, ou la fabrique d’un simulacre de l’entrepreneur ?
III. La fabrique de l’ethos discursif de l’entrepreneur contemporain par les entrepreneurs
a) Le lexique de la présentation de soi
b) Sacralité entrepreneuriale : l’élaboration d’un langage figuratif
PARTIE 3 : Un nouveau champ d’expression de l’entrepreneuriat : un discours entrepreneurial pop-génique, adapté aux codes et aux normes de la culture populaire
I. Le rap, un genre musical qui exalte les valeurs de l’entrepreneuriat
a) Le langage poétique de l’entrepreneuriat
b) « Started from the bottom now we’re here » : l’utilisation de la punchline et de l’imagerie du luxe comme outils de diffusion de l’esprit entrepreneurial
II. Le rap comme relecture du mythe entrepreneurial. L’exemple de Booba
a) La posture du rebelle, un motif du mythe entrepreneurial utilisé par le rap
b) La distorsion du mythe entrepreneurial
III. L’entrepreneuriat porté par la culture populaire, une opportunité pour les marques ?
a) Du mythe au mème entrepreneurial
b) Le concept d’entrepreneur de lui-même et la figure de l’indépendant, ou la récupération
du mythe entrepreneurial par les marques
Conclusion
Bibliographie
Annexes
Résumé du mémoire
Mots-clés