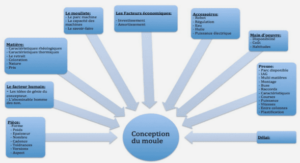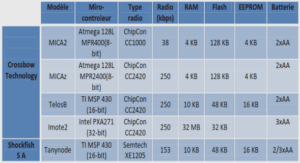Le pôle épistémologique, une exigence de pertinence
Entamer une discussion au sujet de l’épistémologie en sciences de gestion se révèle être une entreprise difficile, tant les points de vue sur le sujet divergent. Il y a d’abord le point de vue de ceux qui insistent sur la nécessité de s’y attarder et qui utilisent des concepts et positions épistémologiques qu’ils empruntent à d’autres sciences sociales (économie, sociologie, etc.) et humaines (philosophie, philosophie des sciences, etc.). Nous retrouvons ensuite le point de vue de ceux imprégnés d’un certain scepticisme, pour qui les sciences de gestion seraient trop jeunes pour s’être établi et pouvoir revendiquer un appareil épistémologique solide (Charreire et Huault, 2001 ; Avenier et Gavard-Perret, 2012 ; Wacheux, 1996). Un survol des contributions théoriques sur ce sujet fait apparaître une littérature particulièrement austère, tant en français qu’en anglais. Quelque part entre ces deux positions nous retrouvons le troisième point de vue, qu’on pourrait qualifier « d’opportunisme méthodique » pour qui la discussion de nature épistémologique n’a que peu d’importance, l’essentiel étant que le chercheur atteigne le but qu’il s’était fixé, sans se soucier trop des moyens qu’il emploie pour y parvenir. Nous nous rattachons à la première position et nous présentons dans cette section une discussion concernant le pôle épistémologique de cette recherche. Nous sommes conscients que se retrouver dans les diverses positions, notions et concepts épistémologiques n’est pas chose facile, et cela pour plusieurs raisons : il y a d’un côté, le manque de familiarité avec une littérature étrangère aux sciences de gestion et de l’autre côté, le faible accent qui est mis en sciences de gestion sur ce type de réflexion au profit de celui mis sur les aspects méthodologiques, plus techniques, de la recherche. Nous nous proposons donc d’expliciter ces éléments d’épistémologie. Dans un sens général et en tant que discipline philosophique, l’épistémologie – la théorie de la connaissance – se penche sur des questions concernant la « the nature, origin and limits of human knowledge » (Moser et vander Nat, 2003, p. 1). Dans ce même sens, elle « est la seule compétente pour décider si les cadres de référence du vrai correspondent, oui ou non, aux cadres du réel… » (Gurvitch, 1963). Dans un sens plus restreint, celui que nous adoptons dans cette thèse, l’épistémologie se réfère aux questionnements qui nous permettent de comprendre la nature du phénomène étudié. Nous sommes plus proches ici du point de vue de Van de Ven (2007) qui considère que le chercheur faisant de la recherche touche, consciemment ou pas, à l’épistémologie et à l’ontologie : « Whether explicit or implicit, we rely on a philosophy of science to interpret the meanings, logical relations, and consequences of our observational and theoretical statements. », en d’autres mots, le chercheur propose une vision de ce qu’est la connaissance, des modalités de sa construction et de la validité de celleci (Avenier et Thomas, 2012). En tant que pilier d’une recherche, l’épistémologie exerce une « fonction de vigilance critique » (De Bruyne, Herman et De Schoutheete, 1974) ; c’est cette réflexion qui permet au chercheur de rester éveillé dans sa démarche de production de nouvelles connaissances, attentif aux questions de rigueur et précision qui s’imposent.
Distinction entre une épistémologie générale et une épistémologie interne
L’épistémologie générale fait plutôt référence à un champ de la philosophie qui s’intéresse à l’histoire de la science. Cette proximité avec la philosophie ou du moins avec une réflexion abstraite, éloignée du travail quotidien des chercheurs autres que philosophes a vu apparaître une tendance qui milite pour son pur abandon : « Mais j’ajouterai aussitôt que la pratique scientifique, à l’échelle modeste qui est la mienne, peut parfaitement se passer de fondements philosophiques. » (Dumez, 2012). Pour notre part, nous nous positionnons du côté de Bunge (1967) qui observe que la relation entre philosophie et science n’est pas une relation d’exclusion réciproque. Pour lui, la philosophie se retrouve dans la base de l’échafaudage scientifique, la recherche scientifique opérant avec des hypothèses philosophiques telles que « the reality of the external world, the multilevel of structure of reality, determinism in an ample sense, the knowability of the world, and the autonomy of logic and mathematics. »18. C’est la prise en compte de cette épistémologie générale qui nous permet ainsi de justifier l’intégration du concept de paradigme dans la section suivante. Il y ensuite ce que (De Bruyne, Herman et De Schoutheete, 1974) appellent épistémologie interne, qui est plus intime à l’activité de recherche du chercheur, qui le guide dans la conception de l’objet de la recherche et dans le choix des méthodes d’investigation. Cette épistémologie interne oblige le chercheur à se questionner sur la scientificité de sa démarche, et l’accompagne tout au long de son entreprise d’élaboration de nouvelles connaissances. Elle permet de légitimer le résultat de son travail (Wacheux, 1996), car cette entreprise est caractérisée par une rupture avec ce qui n’est pas science, que ce soit le sens commun, l’idéologie ou le mythe et elle se produit lorsque le chercheur parvient à autonomiser son objet de recherche et à justifier ses méthodes d’investigation. Les principes de cette épistémologie interne concernent, selon De Bruyne, Herman, et De Schoutheete (1974, p. 47-59), la constitution de l’objet de recherche, de la problématique, la genèse de la théorisation (par induction, hasard, l’analyse comparative, la critique, l’analogie ou encore l’intuition). Les différents éléments de cette épistémologie interne ont été développés tout au long des chapitres précédents cette recherche et nous n’y revenons pas ici par souci de répétition.
Les paradigmes de recherche
La notion de paradigme telle que proposée par Kuhn ([1962], 1972) est l’une des rares développées au sein d’une discipline (l’histoire des sciences) et ayant arrivé à se forger une place pérenne dans le vocabulaire spécifique de la plupart des sciences (Grandy, 2006)19. Dans la présente recherche, nous entendons par paradigme : « une conception de la connaissance partagée par une communauté, qui repose sur un système cohérent d’hypothèses fondatrices relatives aux questions qu’étudie l’épistémologie » (Avenier et Gavard-Perret, 2012) et encore « de modèles, schémas intellectuels ou cadres de référence dans lesquels peuvent s’inscrire les chercheurs en sciences de l’organisation. » (Perret et Séville, 2007). Si le consensus sur l’existence de plusieurs paradigmes épistémologiques est évident en sciences de gestion, le débat quant à leur qualification et leur signification est loin d’être acquis. Ainsi, Perret et Séville (2007) proposent une taxonomie qui distingue entre le positivisme, le constructivisme et l’interprétativisme. Avenier et Gavard-Perret (2012, p. 24) proposent une typologie à granularité plus fine, distinguant cinq paradigmes : le positivisme logique, les épistémologies postpositivistes, le constructivisme radical, l’interprétativisme, et le constructivisme de Guba et Lincoln. Wacheux (1996), prenant comme appui la typologie de De Bruyne, Herman et De Schoutheete (1974), distingue entre quatre paradigmes : le positivisme, la sociologie compréhensive, le fonctionnalisme et le constructivisme. Finissons par dire que pour Le Moigne (1990) une tension existe entre deux paradigmes majeurs : le positivisme et le constructivisme. Nous adoptons ici le point de vue de Avenier et GavardPerret (2012), car c’est le plus explicite en ce qui concerne le positivisme et le postpositivisme et ses variantes, dans lesquels nous nous inscrivons. Sous la dénomination commune de positivisme ou postpositivisme, nous découvrons des prises de position très variées qui se sont développées de manière autonome à partir du positivisme logique du XIXe siècle. Il serait inapproprié de considérer que ces évolutions ultérieures représentent la transformation et la continuité historique du positivisme logique ; il est plus convenable de les considérer comme des courants émergeant dans le sillage du positivisme, qui fut le courant dominant dans la philosophie et les sciences (dont celles sociales) pour une bonne partie du XXe siècle (Hardcastle, 2006). Selon Hardcastle (2006, p. 459), l’expression la plus condensée des thèmes du courant positiviste logique peut être retrouvée dans le manifeste du Cercle de Vienne20. Ainsi, au cœur du projet positiviste demeure le rejet de toute métaphysique et la recherche d’une connaissance fondée sur les faits et non issue de l’intuition ou de la spéculation. Ce type de connaissance trouverait dans la logique un nouveau langage qui assurerait la vérité des énoncés. Pour donner une image la plus détaillée possible d’un paradigme, Guba et Lincoln (1994, p. 108) proposent de le comprendre dans un espace tridimensionnel défini par des coordonnées de nature ontologique, épistémologique et méthodologique et que nous adoptons ici. La dimension ontologique21 se réfère à la réalité du phénomène étudié, à son existence et à sa nature (Guba et Lincoln, 1994, p. 108). Deux grandes postures sont possibles en rapport avec la réalité du phénomène : soit elle existe en tant que réalité distincte, soit cette réalité n’est qu’apparente, elle étant résultante de la perception de l’observateur. La dimension épistémologique est en étroite relation avec celle ontologique et permet de répondre à la question concernant la connaissance que l’on peut avoir du phénomène étudié. En fait, la réponse à la question ontologique implique des conséquences profondes au niveau de la réponse à la question épistémologique : affirmer que le phénomène a une existence objective implique que le chercheur doit essayer de le connaître de la façon la plus objective possible : le rapport qui s’établit entre celui qui veut connaître et ce qui est à connaître est un rapport de neutralité. Il y a ensuite la dimension méthodologique, qui elle aussi dépend des positionnements antérieurs ontologique et épistémologique : comment étudier le phénomène qui nous intéresse? Il convient de dire ici que les choix méthodologiques doivent être cohérents avec les réponses de nature ontologique et épistémologique que le chercheur aura déjà données dans sa recherche (Guba et Lincoln, 1994, p. 108).