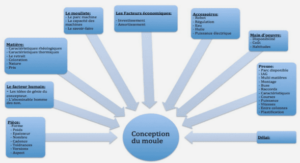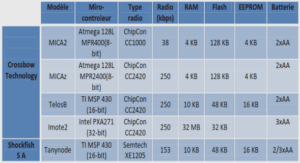L’Escalade et son rapport ambigu au monde compétitif
Une activité singulière
Une Spécificité culturelle revendiquée
Historiquement, l’escalade libre a toujours revendiqué sa spécificité culturelle au sein du Monde sportif. Ainsi, en 1985, 19 des plus influents grimpeurs de l’époque signaient collectivement le Manifeste des 19, où ils clament leur inquiétude face à l’essor des compétitions d’escalade, qui constituait pour eux une rupture avec leur conception commune de l’activité, où la compétition n’a pas sa place, en dehors de l’émulation qui peut naturellement s’instaurer entre grimpeurs qui essayent un même passage. A travers ce manifeste, les auteurs s’inquiètent du risque que l’escalade deviennent un sport en tant que tel, avec des compétiteurs en dossard, un règlement strict, et une retransmission télévisuelle des évènements. Face à ce futur imaginé, ils opposent ainsi « le vrai jeu de l’escalade », en milieu naturel, sans compétition formelle, où les valeurs de partage et de respect de la nature dominent : on retrouve la volonté des grimpeurs, héritée de l’alpinisme où ces valeurs prédominent, de définir eux-mêmes la pratique sociale légitime (Aubel, 2005 ; Guérin, 2013). Nous remarquerons que de nombreux signataires du Manifeste participeront malgré tout à des compétitions, à l’instar de Catherine Destivelle qui remporta la compétition de Bardonnechia (Italie) la même année. Par ailleurs, la prophétie des auteurs s’est réalisée : les compétitions internationales sont désormais retransmises en streaming sur internet et à la télévision, alors qu’une fédération internationale (l’IFSC) a mis au point un règlement précis et contraignant, reconnu partout dans le monde. Cependant, l’idée que l’escalade n’est pas un sport comme les autres, empreint d’une particularité qui est propre à sa nature, semble perdurer au sein de la communauté de pratique. Emergeant en France à la fin des années 1970 en s’émancipant de l’alpinisme, sous l’impulsion notamment de Jean-Claude Droyer, l’escalade libre a été catégorisé en sociologie du sport parmi les sports californiens (Pociello, 1981, 1995). Vecteurs d’une contre-culture émergente dans les années 1970 et 1980, ces sports – on retrouve la planche à voile, le surf, le vol libre, etc. – seraient alors caractérisés par la mobilisation de compétences informationnelles (qu’il oppose aux compétences physiques), et une manière de pratiquer « fun » et alternative, orientée vers la recherche de sensation et non la compétition et la production de performances; les motifs de pratiques se rattacheraient alors à un mode de vie, où la pratique de l’activité est déterminante dans les choix de vie des pratiquants (travail, lieu d’habitation, véhicule, etc.). Dans son espace des sports, Pociello (op cit) indique que les pratiquants de ces activités sont dotés d’un capital culturel élevé: il s’agirait donc majoritairement de personnes issues de professions intellectuelles, participant à travers ces pratiques à un mouvement contre-culturel qui s’oppose au modèle sportif dominant, reposant sur la concurrence, la normativité et la performance, ainsi qu’au modèle économique capitaliste qui sous-tend une rationalisation et une normalisation de la société. Selon Pociello, l’escalade participerait à cette tendance sociétale contre-culturelle ; encore fortement liée à l’alpinisme dont elle est issue, l’activité serait naturellement porteuse d’une conception alternative, tournée vers la non-compétition, la pratique en milieu naturelle.Mais ce serait également une pratique distinctive et socialement élitiste, car peu ouverte aux non-initiés, dans la mesure où elle est – en milieu naturel et à l’époque – peu accessible, et demande de nombreuses connaissances sur le milieu et une prise d’information importante. Cet héritage culturel de l’alpinisme est également mis en avant par l’étude de Gloria & Raspaud (2006, 18), qui ont étudié l’émergence des compétitons d’escalade en France, et soulignent la prégnance des « barrières culturelles du milieu alpin » au sein de l’activité, que le développement d’une offre fédérale de compétitions a contribué à briser, pour aboutir à une plus grande hétérogénéité sociale et une acceptation sociale des compétitons d’escalade. Là encore, si les choses ont beaucoup évolué, cet héritage semble encore bien prégnant aujourd’hui. En milieu naturel, l’étude de De Léséleuc (2004) révèle la volonté, chez les grimpeurs locaux de la falaise de Claret (Héraut), de se démarquer socialement à travers leur pratique de l’escalade, en s’appuyant sur un système de valeurs alternatif et valorisant socialement, où l’engagement, la convivialité, le refus de la compétition sont mis en avant, tout en rabaissant les sports dits classiques, qui n’offrent pas les épreuves et les joies qu’offre l’escalade. Par ailleurs, des études s’intéressant à des grimpeurs français compétiteurs amateurs (Guérin, 2013) ou professionnels (Rogeaux, 20155 ) ont révélé que ces grimpeurs, bien qu’engagés principalement dans une pratique de l’escalade en salle, orientée vers la performance en compétition, témoignent dans leurs discours d’un fort attachement à l’escalade en milieu naturel et aux valeurs qui lui sont associées: émulation, protection et respect de l’environnement, contemplation, diversité et richesse du support. Dès lors, il semblerait que la culture de l’escalade soit encore marquée par ce « particularisme » revendiqué dès les années 1980 et hérité de l’alpinisme, et notamment chez des grimpeurs compétiteurs dans les années 2010, alors que l’escalade serait en pleine mutation sportive.
Médiatisation et économie
La singularité de l’escalade ne se borne pas uniquement à sa culture telle qu’elle est revendiquée par ses pratiquants, et à ses formes de pratiques particulières. Si on en croit Aubel (2005), l’escalade possède une singularité d’un point de vue économique et médiatique, avec l’existence d’un marché propre à l’activité et d’un système médiatique interne et spécialisé, peu tourné vers l’extérieur. Ainsi, cet auteur a étudié dans une première étude (Aubel, 2000) la structuration du système médiatique de l’escalade libre en France. Il a montré que l’escalade n’intéresse pas les médias sportifs généralistes, qui ne lui attribuent pas un fort potentiel médiatique, et que réciproquement, les grimpeurs et les médias spécialisés étaient réticents vis-à-vis des acteurs hors du milieu qui souhaitaient sponsoriser l’escalade et ses compétitons, avec l’exemple d’un master sponsorisé par Pepsi annulé en 1995 sous pression de la FFME. De plus, il démontre comment la presse spécialisée se constitue au sein d’un réseau qui participe à coconstruire, avec les annonceurs et les grimpeurs professionnels, un système de valeurs spécifiques fondé sur le partage, la nature et l’excellence sportive des grimpeurs, en opposition à toute marchandisation – ce qui représente une contradiction manifeste, alors qu’il s’agit de vendre des magazines et des articles sportifs. Dans une seconde étude, Aubel & Ohl (2004) ont étudié la dénégation de l’économie. Malgré l’existence d’une relation triangulaire entre annonceurs, médias et grimpeurs professionnels, à laquelle s’ajoute les flux d’argent issus des compétitions, il régnerait un phénomène de dénégation, c’est-à-dire de rejet et de déni de la dimension économique du professionnalisme en escalade, partagé entre les grimpeurs, les annonceurs et les médias. Cette contradiction manifeste pourrait, selon les auteurs, être inconsciente, et s’expliquerait alors par des dispositions culturelles où le capital économique est rabaissé et dévalorisé au profit du capital symbolique ; ou bien être consciente, et relever d’une stratégie pour masquer un intérêt économique réel. Ainsi, cette dénégation de la dimension économique de l’escalade permettrait aux acteurs qui y sont impliqués de gérer la contradiction qui en émane, et préserver l’ethos de l’activité, et d’avoir malgré cela une attitude qui leur profite symboliquement et économiquement. Les Travaux de Dumont, plus récents, révèlent la nature du professionnalisme de l’escalade contemporaine en milieu naturel, en se focalisant sur les photographes (2015), les stratégies professionnelles des grimpeurs (2017a), notamment la médiatisation via les nouveaux médias – les vidéos en ligne – (2017a), ou encore leur travail pour construire leur réputation (2017b) ou gérer leur relation avec leurs fans qu’ils sont susceptibles de croiser bien plus facilement qu’un autre sportif de haut niveau sur n’importe quel site connu et réputé (2017c). Ces travaux illustrent la spécificité d’un milieu où les grimpeurs professionnels en milieu naturel ont davantage de crédit en termes d’image que ceux qui pratiquent la compétition. On retrouve l’organisation d’un système médiatique en vase clos, comme le décrivait Aubel en 2000, conçu par et pour les grimpeurs. Selon cet auteur, les grimpeurs pratiquant la compétition à haut niveau aspirent à une reconnaissance médiatique extérieure (comme l’indiquait déjà les travaux d’Aubel), mais leur faible crédit médiatique limite la portée de leurs ambitions.
Compétitions
Loin de disparaitre avec la sportivisation de l’activité, la singularité de l’escalade semble perdurer même au sein des grimpeurs qui pratiquent la compétition. Ainsi, Douet-Guerin (op cit), a étudié des compétiteurs amateurs et a montré que malgré une pratique orientée principalement vers la compétition – et un entrainement spécifique, ces grimpeurs revendiquaient la particularité de l’escalade, en indiquant que la compétition était perçue comme un jeu, un prétexte pour s’entrainer et rester en forme ; mais une approche « trop » compétitive, attribuée à certains grimpeurs, était décriée. On retrouve alors l’émulation mis en avant dans le manifeste, envisagée comme une compétition euphémisée, codifiée, qui s’oppose à une « vraie » concurrence et un esprit de compétition affirmé, qui n’ont pas droit de cité dans le milieu de l’escalade. De plus, ces grimpeurs manifestent un véritable attachement à la grimpe en milieu naturel (qu’ils pratiquent cependant très peu), qu’ils qualifient de pratique légitime de l’escalade : grimper dehors serait la finalité ; s’entrainer en salle et participer aux compétitions, le moyen pour se faire plaisir en extérieur. De plus, on retrouve dans le discours de ces grimpeurs l’importance accordée à la préservation des sites naturels, et la peur liée à la massification du nombre de pratiquants – une des conséquences envisagées de l’olympisation de l’activité -, qui entraineraient une dégradation accrue des sites naturels. Cette contradiction apparente se retrouve chez les grimpeurs compétiteurs : les entretiens avec des grimpeurs membres de l’équipe de France (Rogeaux, 20156 ) ont mis en exergue la contradiction manifeste entre d’un côté un discours valorisant la grimpe en milieu naturel, la non-compétition, le partage, la préservation de l’environnement ; et de l’autre une pratique exclusivement centrée sur l’entrainement en salle et la participation aux circuits national et international de compétitions. Ces grimpeurs manifestent également leur scepticisme par rapport à l’olympisme : s’ils y sont favorables, car cela apporterait selon eux d’avantage de reconnaissance médiatique, notamment pour les grimpeurs professionnels, ils en redoutent les conséquences potentiellement néfastes sur l’activité : arrivée de sponsors généralistes aux valeurs non-compatibles avec l’escalade, dégradation des sites naturels liée à la massification des pratiquants, etc. Dans le corpus d’entretien, seule une grimpeuse se démarquait avec un enthousiasme affirmé pour l’olympisme, et une critique acerbe de l' »esprit de la grimpe » sans cesse mis en avant, qui selon elle empêche l’escalade de s’ouvrir au grand public, et qu’elle considère comme une démarche égoïste et distinctive des grimpeurs, qui ne veulent pas partager leur passion, de peur d’être dérangés. Cette vision minoritaire semble cependant être partagée par certains compétiteurs : Aubel (2004) soulignait déjà que certains compétiteurs déploraient le manque de reconnaissance du grand public, lié à la confusion sur leur pratique, trop souvent assimilé à l’alpinisme ou aux « hippies », suite au succès des films de Patrick Edlinger dans les années 1980. Il semble donc y avoir une partie des grimpeurs qui réfutent clairement cette conception alternative de l’escalade, et revendiquent la constitution de l’activité en tant que sport olympique structuré et reconnu socialement. Ce paradoxe que l’on observe dans la littérature indique que les grimpeurs de compétition « nient », à des degrés divers, le caractère résolument sportif de l’escalade – c’est-à-dire une discipline institutionnalisée, codifiée et compétitive – et semblent imprégnés d’une culture « outdoor » de l’activité, quand bien même leur pratique n’a plus rien à voir avec celle des grimpeurs en milieu naturel. Pour reprendre les termes d’Aubel (op cit, 2004), il semble y avoir là une « dénégation » du caractère compétitif de l’escalade; si on reprend ses explications, il pourrait s’agir d’une stratégie plus ou moins inconsciente pour générer du profit symbolique, lié au caractère singulier d’une telle démarche, et pour gérer les contradictions entre un système de valeur valorisé socialement (l’escalade comme sport « à part ») et une pratique qui tend à s’uniformiser avec les autres disciplines sportives. Ce processus d’uniformisation de la compétition, s’il est souvent décrié (tel que l’instauration d’une voie de vitesse standardisée ou le fait de départager les ex-aequo au temps), semble pourtant inévitable dans le processus d’olympisation de l’activité. Wheaton & Thorpe (op cit) indiquent le rôle important qu’a joué la voie de vitesse officielle dans le processus de reconnaissance de l’IFSC par le CIO.
Un processus de sportivisation aujourd’hui accompli
Un Processus historique
Quand l’escalade libre se développe en France dans la deuxième moitié des années 1970, sous l’impulsion entre autres de Jean-Claude Droyer, cette nouvelle pratique s’inscrit dans le courant des sports « californiens » (Pociello, 1981; 1995): témoins d’une contre-culture qui émerge en opposition à la société capitaliste et au modèle sportif dominant qui lui est associé – notamment par Brohm (1976) qui soutient une analogie entre les systèmes économique et sportif – , ces nouvelles pratiques sont caractérisées par l’incarnation d’un mode de vie, et la primauté des sensations sur les résultats normés; de la prise d’information sur les qualités physiques; et du partage sur l’opposition et la concurrence. Cependant, dès les années 1980, cette position alternative sera ébranlée par l’organisation des premières compétitions d’escalade (Gloria & Raspaud, 2006), et la création en 1985 d’une Fédération Française de l’Escalade (FFE) en rupture avec la Fédération Française de la Montagne (FFM), afin d’organiser les compétitions. Malgré le Manifeste des 19 (1985) qui clame l’opposition aux compétitions des grimpeurs les plus influents de l’époque, les compétitions n’ont cessé de se développer et de se structurer. Alors que les codes de la grimpe en milieu naturel se sont progressivement harmonisés internationalement (échelle de cotations, règles d’éthique, etc.), l’escalade en compétition, revenue sous la tutelle d’une fédération unifiée (la FFME), s’est ensuite progressivement structurée autour des trois disciplines que sont le bloc, la difficulté et la vitesse. Il s’agit donc d’un véritable processus de sportivisation qui démarre dans les années 1980 et qui continue encore aujourd’hui, avec son olympisation, ou encore sa « mainstreamization » (Gagnon & al, op cit). L’escalade, en se développant, se pare peu à peu de tous les attributs d’un sport « classique » : des institutions, la mise en jeu d’actions motrices, et un système de règles (Parlebas, 1999). Aubel (2005) détaille ce processus qui s’illustre selon lui selon 3 composantes : l’instutionnalisation de l’activité ; l’avènement d’un système de règles ; l’essor d’un marché de la grimpe. • L’institutionnalisation de l’activité s’illustre par la création d’une fédération spécifique (FFE puis FFME), ainsi que la structuration de celle-ci en comités territoriaux. Cette institutionnalisation concerne les deux facettes de l’escalade : o L’escalade en compétition, gérée par la FFME. La création de l’IFSC en 2007, qui s’émancipe de l’UIAA (fédération internationale d’alpinisme) pour mieux développer et structurer les compétitions d’escalade au niveau international ; ainsi que sa reconnaissance par le CIO et son intégration au programme des JO témoignent d’un processus d’institutionnalisation déjà bien avancé au niveau international. o L’escalade en milieu naturel, avec par exemple la mise en place du Roc Aventure Programme en 2016, qui a pour objectif de constituer une « équipe » de grimpeurs de haut-niveau en milieu naturel pour équiper, ouvrir et répéter des voies dures sportives ou traditionnelles.• Le développement d’un système de règles se retrouve aussi bien en milieu naturel (avec une uniformisation des normes éthiques, et la distinction à vue – flash – après-travail7 ), qu’en compétition, avec des règles fédérales de plus en plus précises et rigoureuses (par exemple sur la distinction entre prise tenue et valorisée8 ), et désormais uniformisées mondialement sous la tutelle de l’IFSC, présente sur les cinq continents. • L’essor d’un marché de la grimpe spécifique, qu’il s’agisse des médias (Aubel, 2000, 2004 ; Dumont, 2015, 2016, 2017a, 2017b, 2017c) ou des équipementiers, qui ont beaucoup évolué depuis les années 1980.
Les caractéristiques d’un sport « moderne » ou « classique »
Avec ce processus de sportivisation, l’escalade serait-elle devenue, à l’instar d’autres sports outdoor, une activité non plus contre-culturelle, mais subculturelle (Soulé & Walk, 2007). Pour ces auteurs, les pratiquants des activités sportives de nature mobilisent des codes et des usages spécifiques en vue de conserver une authenticité culturelle alternative : la manière de se comporter, de consommer certains produits spécifiques à l’activité, etc. Mais selon eux, derrière ce masque se cachent en réalité tous les attributs d’une pratique sportive traditionnelle : normativité des performances, concurrence, et institutionnalisation plus ou moins formelle des pratiques. Dans la même perspective, Suchet (2011) dénonce le paradoxe du terme « sport de nature » : alors que l’on retrouve les quatre composantes d’un sport selon Parlebas (1999) – à savoir la mise en jeu d’actions motrices, un système de règles, des compétitions et des institutions) – on attribue à ces sports le qualificatif de « nature », alors que celle-ci suppose justement la nonintervention humaine. En escalade, il semblerait qu’on retrouve ce même paradoxe entre une dénégation du caractère sportif de l’activité, comme l’a montré Douet-Guerin (op cit) : dans cette étude, les grimpeurs interrogés critiquent les grimpeurs qui prennent trop au sérieux les compétitions, et valorisent les autres dimensions de l’activité (les voyages en milieu naturel, la convivialité, etc.), et rejettent l’idée que l’escalade soit caractérisée comme un sport. Toutefois, on retrouve naturellement les composantes édictées par Parlebas (op cit) au sein de l’escalade : • La mise en jeu d’actions motrices avec le fait de grimper un support, quel qu’il soit : naturel ou artificiel, d’une hauteur variable, encordé ou non. • Un système de règles, qu’il soit formel (dans le cadre fédéral) ou informel (en milieu naturel : standardisation de l’équipement et règles relatives à l’enchainement, au comptage des essais, etc.) • Des compétitions, qui peuvent être officielles, mais également officieuses, comme l’est l’émulation, défendue par de nombreux grimpeurs, qui peut s’envisager comme une compétition euphémisée et codifiée • Des institutions : là encore il s’agit d’institutions officielles (fédérations) qu’officieuses (les pairs, les médias, etc. qui valident ou non les performances) Ainsi, si Gagnon & al (op cit) défendent l’idée que l’escalade indoor constitue la création d’un nouveau sport, il semblerait que l’escalade dans son ensemble présente toutes les caractéristiques d’un sport moderne.
L’olympisme, entre rêve et cauchemar
Une histoire politique
Restaurés à la fin du XIXe siècle par le baron Pierre De Coubertin, les JO modernes ont été pour leur promoteur l’occasion de valoriser une compétition éducative du sport, incarnée par la devise « struggle for life ». Ainsi, De Coubertin voyait dans les JO un moyen de valoriser l’engagement et l’initiative des sportifs – nécessairement des hommes, issus des classes sociales supérieures et amateurs (Andrieu, 2004). Mais également, il attribuait à l’olympisme des finalités humanistes, comme favoriser la paix et l’amitié entre les peuples. Toutefois, Waser (2000) souligne que dès le début du XXe siècle, les idéaux originels sont vite chamboulés par l’essor du sport professionnel. Ainsi, les fédérations sportives internationales les plus influentes, comme la Fédération International de Football Association (FIFA) qui envisageait un boycott des JO de 1914 à Amsterdam, ont très tôt entamé un bras de fer avec le CIO sur la question du professionnalisme. Elles ont obtenu, dès les années 1920, d’avoir un représentant de chaque fédération au sein du CIO afin d’infléchir les décisions de l’institution, voulue par De Coubertin comme une institution où les membres sont cooptés selon leurs compétences ; le baron assumait déjà une institution non-représentative, et de facto nondémocratique, pour éviter selon lui les risques de paralysie. Comme l’indiquait Andrieu (op cit), le mouvement olympique est, dès son émergence, soumis à des pressions des mondes sportif et économique qui viennent contrecarrer l’idéal de pureté moral souhaité par De Coubertin en restaurant les JO. Dès lors, l’histoire de l’olympisme est à mettre en relation avec celle du sport professionnel, qui s’est très vite approprié le support qu’offrait les JO pour s’exprimer. Ce contraste entre les valeurs humanistes prônées par le mouvement olympique, et une réalité économique et géopolitique qui contredit fortement ces valeurs, semble donc prendre sa source dans plus d’un siècle d’histoire de l’olympisme.
Un mouvement porteur d’un imaginaire très puissant
Le mouvement olympique contemporain est issu d’une riche histoire, où des valeurs fortes de vigueur, de partage, d’amitié, de pureté morale, lui sont assignées. Ces valeurs qualifiées bien souvent de « coubertiniennes », qui attribuent des qualités intrinsèques au sport et à la compétition, sont toujours incarnées dans l’imaginaire collectif par l’olympisme, bien qu’elles aient été rapidement bafouées dans les faits, dès le début du vingtième siècle (Andrieu, op cit). Ainsi, Monreal (1997), concepteur du musée olympique de Lausanne, défend l’existence d’une véritable culture olympique ; il considère que l’olympisme est culture, dans la mesure où il représente un symbole diffusé mondialement, et qu’il créée son propre langage. Positionné à mi-chemin entre un spectacle sportif et un spectacle artistique, ce mouvement aurait une identité culturelle propre, en plus d’un impact planétaire, et un enracinement culturel profond dans la société. Pour lui, le potentiel du mouvement olympique est l’occasion de promouvoir le fairplay, la protection de l’environnement et la paix. La puissance idéologique du mouvement olympique dans le monde social est à mettre en relation avec une conception laudatrice du sport, défendue par certains auteurs dans la littérature. Ainsi, Ehrenberg (1991) soutient le potentiel du sport qui permet à chacun de se réaliser individuellement dans la sphère sociale, en s’affranchissant ainsi du déterminisme de son appartenance sociale. Bromberger (1999) de son côté loue l’aléa des épreuves sportives qui en font tout son intérêt en tant que spectacle, tout en incarnant également l’idée que les sportifs peuvent inverser l’ordre social en s’illustrant dans les épreuves sportives. Ainsi, le sport – et plus encore, les JO, qui incarnent de façon concentrée et surmédiatisée le monde des épreuves sportives – constituerait un mythe égalitaire très puissant (Duret & Trabal, 2001) : le sport représenterait alors symboliquement un « îlot de pureté », où les fédérations internationales et le CIO seraient les « gardiens du temple ». Dans cette perspective, les mouvements sportif et olympique sont porteurs d’une fonction mythologique importante, comme le soulignaient Brohm (1976), ce qui leur confère une aura et un statut rarement discutés ou remis en cause, de par la puissance du mythe qu’ils représentent dans la société.