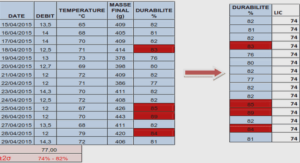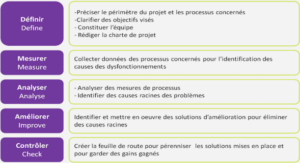LES FIGURES DE L’AIR SUR LA SCÈNE FRANÇAISE
Le XIXe siècle voit le développement à la scène de formes dramatiques et a-dramatiques qui privilégient la suggestion, l’invisible, le mystère et un goût pour un immatériel qui caractérise la réaction « idéaliste » étudiée dès la fin des années 1930 par Dorothy Knowles . Dans le domaine de la danse, Sylvie JacqMioche a ainsi montré comment s’est développée dans le ballet romantique une esthétique visant « la représentation paradoxale de l’immatériel, de l’imperceptible, de ce qui échappe à la dimension charnelle de l’incarnation ». Plus largement, Jean Starobinski a analysé l’imaginaire des Tréteaux qui se développe au XIXe siècle et a fait apparaître comment la dialectique de l’immatériel et de l’incarnation a marqué l’histoire du ballet comme du cirque, deux formes qu’apparemment tout distingue : Entre le triomphe de la chair et la virtualité d’une signification symbolique (suggérée par l’argument du ballet, mais le plus souvent assumée par le poète-spectateur), le spectacle offre à l’esprit un choix vertigineux : se laisser fasciner par la forte et vulgaire présence du réel vital, ou transcender, par un décret de la conscience interprétante, la réalité du corps pour s’élancer vers le lointain d’une signification allégorique. L’esprit trouve alors dans le bond de la danseuse ou de l’acrobate l’image de son propre bond « hyperbolique » hors de tout sens littéral221 . Au fil du XIXe siècle, et à travers des formes scéniques très différentes, l’impératif de dépassement et de sublimation de la corporalité est donc très nettement affirmé, notamment en ce qui concerne la représentation de la corporalité féminine. Cette représentation atteint sans doute son acmé à travers l’image Belle-Epoque de la « femme-fleur », dont Rhonda Garelick a étudié la productivité dans l’œuvre de Loïe Fuller, dont nous reparlerons . Il s’agira ainsi de faire apparaître la fertilité du paradigme atmosphérique sur la scène française et la manière dont le diaphane transforme la présence corporelle. Pour cela, nous interrogerons des pratiques scéniques appartenant à des aires culturelles a priori distinctes, au sein desquelles opèrent des circulations : le théâtre forain, où éclot la fantasmagorie ; le music-hall où se développe la danse de Loïe Fuller et la scène symboliste, où opère une poétique de la transfiguration.
Devenir théâtral de la fantasmagorie : l’invention d’une « outrescène »
Originellement conçu comme art de l’apparition de spectres, la fantasmagorie procède d’un engouement pour l’immatériel et l’ésotérique. L’atmosphère y est conçue comme un milieu d’inscription privilégié pour la présence corporelle. Max Milner a montré que la fantasmagorie s’inscrit dans un mouvement engagé depuis la seconde moitié du XVIIe siècle, mouvement de recherches théoriques sur l’optique mais surtout de réalisations pratiques visant à modifier notre perception, creusant au sein du visible unifié depuis la Renaissance selon les lois d’une perspective anthropocentrique des lacunes propices à la manifestation d’un autre visible. La fantasmagorie se développe à la fin du XVIIIe siècle et surtout au début du XIXe siècle, à un moment où l’héritage scientifique des Lumières commence à faire reculer la superstition, du moins dans les milieux parisiens où elle se développe. Milner montre que le recul de la croyance et de la superstition ouvre un espace symbolique propice au développement de cette forme scénique. C’est au moment où la croyance est en train ou vient de disparaître que l’imaginaire est investi avec le plus de force, parce qu’il bénéficie à la fois de l’effet de libération produit par l’adoption d’une conception rationnelle du monde et du vide affectif que provoque la renonciation à tout moyen de communiquer avec l’audelà. Mais l’intérêt particulier du substitut optique est de combler ce vide par une perception qui fonctionne à la manière du fétiche freudien (« je sais bien que les fantômes n’existent pas, mais quand même… ») alors que la littérature et le théâtre supposent le passage obligé par une mise entre parenthèses du réel223 Avant de devenir une forme d’attraction à part entière et d’être représentée à ce titre sur scène, la fantasmagorie s’est développée dans des lieux urbains alternatifs, témoins d’une redistribution des espaces.
Le « fantascope » de Robertson
Le lieu le plus connu, et sans doute l’un des plus marquants dans l’histoire de la fantasmagorie, se situait dans la chapelle de l’ancien Couvent des Capucins, entre le faubourg Saint-Honoré et la place Vendôme. Robertson y installa plusieurs dispositifs, tels quel le « fantascope », une lanterne magique montée sur rails, qui permet aux apparitions spectrales de se déplacer au milieu du public. Après plusieurs détours propres à changer l’impression que l’on conserve du bruit profane d’une grande cité, après avoir parcouru les cloîtres carrés de l’ancien couvent, et traversé mon cabinet de physique, on arrivait devant une porte de forme antique, couverte de hiéroglyphes, et qui semblait annoncer l’entrée des mystères d’Isis. On se trouvait alors dans un lieu sombre, tendu de noir, faiblement éclairé par une lampe sépulcrale, et dont quelques images lugubres annonçaient seules la destination ; un calme profond, un silence absolu étaient comme les préludes d’un monde idéal . Force est de constater que pour celui qui se donne comme un « aéronaute » dans le titre de son ouvrage, la topographie des lieux par lesquels passent les spectateurs avant d’entrer dans la chapelle est très importante. Elle conditionne pour beaucoup l’effet visé par la fantasmagorie. Le parcours topographique est conçu comme une remontée dans le temps, de l’époque contemporaine jusqu’aux « mystères d’Isis », marque d’un orientalisme en vogue au début du XIXe siècle. Robertson lui-même joue le rôle de guide, c’est lui qui place les spectateurs et leur apprend l’histoire, réelle et fantasmée, des lieux. Puis le silence se fait. Aussitôt que je cessais de parler, la lampe antique suspendue audessus de la tête des spectateurs s’éteignait, et les plongeait dans une obscurité profonde, dans des ténèbres affreuses. Au bruit de la pluie, du tonnerre, de la cloche funèbre évoquant les ombres de leurs tombeaux, succédaient les sons déchirants de l’harmonica ; le ciel se découvrait, mais sillonné en tous sens par la foudre. Dans un lointain très reculé, un point mystérieux semblait surgir : une figure, d’abord petite, se dessinait, puis s’approchait à pas lents, et à chaque pas semblait grandir Le dispositif de la lanterne magique sur rails permet de varier la taille des apparitions, ce qui donne aux spectateurs l’impression que le spectre s’éloigne et se rapproche à sa guise. Ces spectacles, connus pour impressionner les esprits, sont conçus comme des panoramas puisant dans ce que l’histoire ou la mythologie offre de plus spectaculaire : Robespierre sortant de son tombeau et marchant avant de s’écrouler, frappé par la foudre, Orphée et Eurydice, Diogène passant au milieu des spectateurs tandis que s’écrivait sur le mur en lettres phosphorescentes du célèbre « Je cherche un homme ».
Les « spectres vivants et impalpables » de Robin
Si les fantasmagories conçues par Robertson profitaient largement d’un lieu non dédié au théâtre mais dont la sacralité et le recueillement jouaient indéniablement pour impressionner les esprits, la fantasmagorie se développe quant à elle dans des théâtres, comme celui de la Gaîté situé boulevard du Temple, qui accueillit à partir de 1850 une attraction conçue par Robin228, les « spectres vivants et impalpables ». Conçus selon des scénarios des plus simplistes, ces spectacles n’en modifiaient pas moins la corporalité scénique, sur un mode grand-guignolesque propre aux attractions populaires. Un jour, [Robin] s’avisa de lancer des spectres vivants et impalpables et, pour commencer, dans un décor funèbre […], il montra un amoureux pleurant sa fiancée morte ; soudain, celle-ci se montrait, vêtue d’un suaire qu’elle rejetait, on la voyait alors pâle, dans une robe de mariée ; Son amant voulait la saisir, l’entraîner, mais ses bras passaient au travers de la vaine apparence, qui, peu à peu, s’effaçait, à la désolation de l’amoureux. L’impression produite fut profonde, terrifiante même ; à ce titre, elle dépassa le but que cherchait Robin. Des cris de terreur retentissaient dans la salle, des spectatrices s’évanouissaient229 . Le motif de la morte amoureuse, propre au romantisme noir, mais aussi le mythe d’Orphée et Eurydice, confèrent au numéro son unité d’ensemble. Les « spectres vivants et impalpables » font ainsi apparaître une tentative de rapprochement et d’union que déjoue la nature des corps mis en présence. Alors que le fiancé est vivant et que son corps se tient sur la scène du théâtre, celui de sa fiancée morte se constitue dans la transparence, privé de sa corporalité. C’est lorsque le fiancé cherche à toucher sa bien-aimée que le corps disparaît, comme pour marquer l’écart irréductible de deux personnages appartenant à des plans inconciliables. L’arrachement marqué visuellement par la disparition provoque des réactions de terreur au sein d’un public qui ne connaît pas – encore – le dispositif. Robin cultive les effets galvanisants liés à ce procédé dans un numéro ultérieur, « Le zouave d’Inkermann », au cours duquel le spectre d’un zouave vient tourmenter chaque nuit un chimiste. Georges Moynet le présente en ces termes : Après une scène de pantomime […], le médecin ramenait une épée et chargeait le zouave qui, de son côté, mettait sabre au clair, et recevait l’assaillant de vigoureuse façon. On entendait des cliquetis de lames, puis le zouave, avec un sourire dédaigneux, cessait de parer et son antagoniste lui passait à plusieurs reprises non seulement la lame, mais le bras au travers du corps. On apercevait la manche noire de l’habit du docteur qui transparaissait dans la poitrine du zouave de plus en plus gouailleur. Puis ce dernier montrait l’horloge et semblait annoncer qu’il renouvellerait cette séance le lendemain, à la même heure. Alors, il s’effaçait dans l’air230 . Si « Les spectres vivants et impalpables » reposaient sur un impossible contact entre les acteurs présents sur scène, « Le zouave d’Inkermann » fonctionne sur un mode différent, plus proche du récit d’aventure et d’un orientalisme hérités du XVIIIe siècle. S’il repose sur un scénario visuel analogue, fondé sur la présence des corps et leur effacement, le numéro sollicite la surprise et les rebondissements. La première est liée au choc du combat qui a lieu sur scène et qui est donné à entendre, alors même que le zouave n’est pas scéniquement présent. Cette orchestration sonore est renforcée par le recours à la pantomime qui, si elle retranche le son des voix, permet en revanche de percevoir le cliquetis des armes. Second rebondissement : alors que le combat et engagé, le chimiste « touche » le zouave et traverse son bras. La moquerie du zouave à l’encontre du chimiste vise aussi, semble-t-il, le spectateur crédule qui a été dupé par l’illusion scénique. Enfin, dans un ultime coup de théâtre, le zouave gouailleur, qui n’a pas été affecté par le coup, disparaît. La pantomime obéit donc à des principes de composition organisés autour de l’effet à produire et de la tension à créer chez le spectateur.
Productivité du Pepper Ghost dans la fantasmagorie
La fantasmagorie répond donc à un véritable engouement du public pour l’occulte et l’immatériel. D’un point de vue technique, elle est liée aux recherches de quelques passionnés plus ou moins extravagants. Robertson, comme Pepper, sont toutefois à considérer comme d’authentiques scientifiques, tant par leur formation que par leur démarche, fondée sur des méthodes de conception éprouvées dans le domaine de l’ingénierie. L’Anglais John-Henry Pepper (1821-1900) a ainsi été professeur à la Royal Polytechnic Institution. Il a élaboré le dispositif du Pepper Ghost et l’a fait protéger par des brevets. Cela lui valut notamment en 1863 de vendre à Hippolyte Hostein, le directeur du Théâtre du Châtelet, le brevet d’un numéro de spectres pour un drame intitulé « Le Secret de Miss Aurore ». En suivant les explications que Robert Houdin en donne dans son ouvrage intitulé Magie et physique amusante, cette transaction portait sur un polyscope de l’invention de John-Henry Pepper, un dispositif optique permettant de démultiplier l’image d’un objet, que Robert Houdin décrit en ces termes : Disposez verticalement sur une table une glace sans tain, ou à défaut un morceau de verre de vitre, exempt de bouillons et de stries, ayant une trentaine de centimètres de hauteur sur autant de large. Mettez, ensuite, une bougie allumée de dix centimètres environ en avant de cette glace et placez derrière un livre qui fera l’office d’un écran […]. En regardant par-dessus le livre B, dans la glace, vous y verrez l’image réfléchie de la bougie C que cet écran cache à votre vue directe, et cette image vous apparaîtra virtuellement en D, derrière la glace, à une distance égale à celle dont l’image réelle C s’en trouve éloignée. Si, tout en conservant la vue au même endroit, vous avancez la main derrière la glace, vous pourrez passer les doigts à travers la bougie D, et ce corps, qui vous semblait opaque, deviendra tout à coup impalpable et diaphane. A la place de la bougie C, mettez un corps blanc vivement éclairé, vous aurez la représentation du truc des spectres que l’on représente au théâtre231 . Cette description du dispositif permet de comprendre comment les attractions des années 1860 façonnent une corporalité plus diffuse, faisant passer du régime de l’opacité décorative à celui du diaphane, qui est encore largement tributaire de l’imagerie fantasmagorique. L’illustration jointe à la description de Robert Houdin fait ainsi apparaître le cadre illusionniste dans lequel le public est placé, celui d’une frontalité restreinte qui assure la pleine efficacité de l’illusion232. Ainsi que le montre Robert Houdin, le public ne devait pas être placé plus haut qu’une certaine ligne au-delà de laquelle la vitre et le dispositif apparaissent au regard.