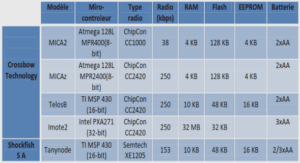Standards et évolution des discours à propos de sciences
Pourquoi parler de « standards » alors que les notions de formation discursive, ou de régime discursif, disponibles et bien éprouvées dans le champ de l’analyse du discours, rendent compte de régularités observables qui peuvent partiellement132 intégrer ce que recouvre le « standard ». Si la notion de standard est plutôt un concept opératoire en sociologie, j’en propose une version nourrie d’apports sémiotiques. L’articulation entre sciences de l’information et de la communication et les études de sciences s’est, dans la première partie de ce travail, focalisée sur les dimensions relationnelles que la notion de collectif permet de saisir. Puis cette articulation m’a permis d’analyser le travail de médiation inhérent au fonctionnement quotidien des dispositifs de financement de la recherche. Pourtant la communication n’a pas qu’une valeur productive et c’est le fonctionnement symbolique à la fois des sciences et de la communication qu’on peut contribuer à éclairer en les traitant ensemble. Ainsi, l’articulation théorique va ici aboutir à une certaine définition de ce qu’est un « standard ». La notion d’objet textuel, en tant qu’inscription des standards, est appréhendée différemment133 selon que l’on se place dans l’une ou l’autre des approches disciplinaires. Du côté des sciences de l’information et de la communication, les objets textuels sont analysés, selon une tradition littéraire, comme des indicateurs de conditions de production des discours sociaux (Véron, 1987) et se rattachent au projet historique large d’une élucidation de l’épistémé d’une époque (Foucault, 1969). Du côté des études de sciences, ces mêmes objets textuels sont des éléments de l’action, actants ou objets médiateurs (Hennion et Latour, 1993), témoins des dynamiques entre les acteurs (Vinck, 1999). Afin de préciser la manière dont je souhaite articuler les deux approches je vais présenter rapidement quelques uns de leurs apports spécifiques. On regroupe sous le terme de « communication scientifique » des pratiques aussi diverses que la publication d’articles scientifiques, les pratiques telles que les colloques et séminaires, la vulgarisation, la médiatisation des sciences, l’expertise, les débats publics. Leur étude, parallèlement à celles des pratiques ordinaires des chercheurs et à l’émergence puis au développement de la mise en débat des sciences, a fait apparaître l’hybridité des types de production, des formes discursives ainsi que la pluralité des modes d’énonciation et des espaces de référence (Moirand, 1997 ; Cusin-Berche (éd.), 2000). La vulgarisation est une tradition culturelle dont Yves Jeanneret (1994) montre l’historicité. Il souligne par exemple l’importance du modèle idéologique « du troisième homme » encore très actif, qui s’appuie sur un modèle de la communication très daté. Le troisième homme est un intermédiaire entre le monde homogène de la science et le « public » défini comme ce qui lui est externe. Cette vision de la vulgarisation comme opération de facilitation d’une transmission ou d’une traduction (qui peut donc être une trahison), omet complètement toute reconnaissance de la créativité et la poétique de la vulgarisation, ainsi que toutes interrogations en termes de « production culturelle » (Babou, 1999). Nous verrons en quoi ce modèle du troisième homme est encore actif et peut même être appréhendé comme un standard de la communication scientifique. Yves Jeanneret (2008) met également en évidence plusieurs figures « savantes » de la communication sociale telle que la propagation, la transmission ou la reproduction. Il montre comment certaines pensées du fonctionnement social renferment des conceptions de la communication qui ne sont pas problématisées : sa critique de la théorie de l’acteur réseau porte justement sur un repli de la communication à sa dimension logistique au détriment des dimensions sémiotique et poétique. Or, historicisées, ces représentations de la communication peuvent également être étudiées comme du marqueurs de rapport de légitimité entre des mondes sociaux. Par exemple, Igor Babou (1999) analyse l’évolution des positions énonciatives des journalistes et des chercheurs dans la mise en scène des émissions télévisuelles sur le cerveau entre 1975 et 1994. Il montre ainsi comment, à certaines périodes, les rapports de légitimité tendent à s’inverser. Si la parole est d’abord portée par des chercheurs, s’exprimant dans leurs espaces propres, où viennent les filmer les équipes de télévision ; les années 90 sont marquées par le déplacement des chercheurs sur les plateaux de télévision où s’exercent une régulation et une prise de parole beaucoup plus importante de la part des journalistes. Le discours télévisuel devient plus volontiers critique à l’égard des sciences au cours des années 80 durant lesquelles la montée de la parole profane est prégnante. La légitimité de la parole proprement télévisuelle est telle, qu’au début des années 90, la pratique de l’auto référence est constante.
Quelles conceptions de la communication environnementale ?
Les politiques environnementales, suite aux réflexions sur la place des sciences et des techniques menées par les écologistes (partie I), ont été un espace d’expérimentation138 privilégié pour répondre à « l’impératif délibératif » (Blondiaux et Sintomer, 2009). Cet impératif délibératif, témoin d’une crise de la légitimité technocratique et d’un besoin nouveau de réflexivité (Beck, 2001), est à l’origine de la production d’outils de débats publics. Des dispositifs de délibération (Mabi, 2011 ; Monnoyer-Smith, 2006) et des dispositifs participatifs élaborés pour faciliter l’expression des citoyens, encadrent cette dernière selon des procédures et des configurations plus ou moins formalisées. L’importance de mettre les acteurs « autour de la table » au sein de « forums hybrides » (Callon, Lascoumes et Barthe, 2001) est une exigence récurrente qui apparaît au moment de la création des parcs, dans la mise en place de trames vertes et bleues dans le Grenelle de l’environnement. Dans le cas des trames vertes et bleues, des expériences multiples coexistent : des discussions techniques autour de données standardisées et présentées sous forme cartographique pour faciliter la visualisation et des négociations selon des discussions argumentatives sont ouvertes à la pluralité (Charvolin, Mathevet et Vilmal, 2011). Si la rationalité scientifique perdure (Granjou et Mauz, 2007), la mise en place de ces différents dispositifs témoigne du succès spécifique139 d’une rationalité communicationnelle – on retrouve alors ici des tensions entre légitimités médiatique et scientifique. La rationalité scientifique est explicitement discriminante dans l’accès à l’expression, mais qu’en est-il de la rationalité communicationnelle ? Selon cette rationalité, la communication est supposée remettre en cause les pouvoirs et faire appel à des points de vue non spécialisés la rationalité communicationnelle ne présuppose-t-elle pas des compétences également réparties entre les différents acteurs ? En effet, les contraintes du dispositif encouragent certains types de prise de parole et certains régimes de discours (Blondiaux et Lévêque, 1999) au détriment d’autres, qui peuvent néanmoins trouver leurs espaces d’expression dans les réseaux (Monnoyer-Smith, 2006). N’at-on pas affaire parfois à une conception irénique des rapports entre communication et démocratie ? Comment sont prises en charge les asymétries de rapports aux différents registres d’expression ? Les questions de communication sont centrales dans la récente diffusion de termes et « notions » relatifs à l’environnement tels que le développement durable (Libaert, 2010). Or, elles ne sont à aucun moment problématisées. Cette notion de développement durable, apparue en 1987 dans un rapport de l’ONU « Our Common Future », plus connu comme rapport Brundtland, est sujette à de nombreux usages discursifs autour desquels se joue la question identitaire pour de nombreux acteurs en présence. En effet, l’analyse discursive de la question de la « sustainability »140 montre à quel point elle « est devenue une arène dans laquelle les individus et les organisations créent et protègent leurs identités »141 (Porter, 2005, p 9). Ainsi, la communication de la notion de « sustainable development » dépasse complètement la vulgarisation des sciences de la vie et touche à un ensemble de savoirs (économiques, écologiques et politiques notamment) distribués selon des formes de communication propre à la gestion (Jeanneret, 2008). Yves Jeanneret étudie les formes de communication visant la représentation du « sustainable development » et montre l’importance des outils, des savoirs et de leurs articulations selon un régime du visible : « C’est pourquoi l’existence d’une pensée synoptique, définissant la gouvernance en termes de conciliation et de procédures convient particulièrement bien à une approche libérale des affaires politiques, puisqu’elle donne aux institutions le rôle de régulateurs d’une pratique dont chaque partie prenante reste maîtresse dans son ordre : ce qui est sans conteste, le principe, et du capitalisme mondial et de la « cité par projets » (Boltanski et Chiapello, 1999) par laquelle il s’exprime volontiers aujourd’hui. » (Jeanneret, 2010, p 73) Peut-on alors parler d’une convergence dans l’espace public entre l’évolution des pratiques de communication et la notion de développement durable ? Si c’est le cas comment interviennent les logiques gestionnaires dans cette convergence ?
Le projet comme objet communicationnel, un vecteur de valeurs managériales
Dans Le nouvel esprit du capitalisme, Boltanski et Chiapello (1999) analysent la littérature managériale pour comprendre les justifications que donnent les acteurs pour se rallier au capitalisme tel qu’il a été revisité par la prise en compte des critiques « sociales » et « artistes ». Ce nouveau capitalisme véhicule de nouvelles formes de légitimité autour des valeurs de la mobilité, de la flexibilité et de l’autonomie des salariés. La « cité par projet » propose un monde connexionniste dans lequel le management créatif et l’autocontrôle sont les nouveaux principes mobilisateurs. Ce changement dans le domaine de la recherche peut s’apprécier par l’usage du benchmarking dans la mise en place d’un espace européen de la connaissance (Bruno, 2009) ou par la présence de nouveaux experts en gestion de la recherche (Vilkas, 2009). Nous pensons que la communication est centrale dans ces changements. Anne Piponnier propose d’analyser le projet comme « une forme généralisée d’organisation de la communication sociale et politique » ou plus largement comme un « objet communicationnel » impensé comme tel et jusqu’à lors peu investi par les sciences de l’information et de la communication (Piponnier, 2008b)142. Le projet fonctionne par exemple pour le territoire à partir d’une pensée communicationnelle de la politique : « D’instrument opérationnel pour la conduite des affaires du territoire, le projet devient un outil de communication stratégique : il permet d’un côté de renforcer le dialogue avec les partenaires économiques et institutionnels par le biais de la contractualisation, et de l’autre il cherche à renforcer la cohésion territoriale en favorisant la participation des acteurs aux différents stades de développement d’un projet. » (Piponnier, 2008a) Le projet est très souvent une occasion de promouvoir une logique gestionnaire qui se justifie par la promotion de valeurs consensuelles telles que la participation. En outre, il est autant un moyen de construire la gouvernance et d’incarner la notion de développement durable que de les représenter. Anne Piponnier travaille principalement sur les projets de recherche européens type PCRDT (programme cadre de recherche et développement technologique) en sciences sociales selon une approche socio-pragmatique qui permet de considérer « le projet comme situation pratique au cours de laquelle, dans des contextes considérés, la communication scientifique est mise à l’épreuve » (Piponnier, 2011a, p 6). En effet, le projet devient un dispositif par lequel les acteurs publicisent les connaissances produites, selon des procédures relativement homogènes qui sont inscrites dans un ensemble d’objets : dossier de soumission, rapports, délivrables, etc.