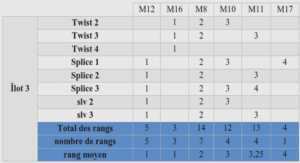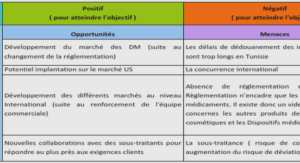LES ECHELLES DE LA MARCHE
LE CORPS, ECHELLE ONTOLOGIQUE DE LA MARCHE
Ce lieu que Proust, doucement, anxieusement, vient occuper de nouveau à chacun de ses réveils, à ce lieu-là, dès que j’ai les yeux ouverts, je ne peux plus échapper. Non pas que je sois par lui cloué sur place – puisque après tout je peux non seulement bouger et remuer, mais je peux le « bouger », le remuer, le changer de place –, seulement voilà : je ne peux pas me déplacer sans lui ; je ne peux pas le laisser là où il est pour m’en aller, moi, ailleurs. Je peux bien aller au bout du monde, je peux bien me tapir, le matin, sous mes couvertures, me faire aussi petit que je pourrais, je peux bien me laisser fondre au soleil sur la plage, il sera toujours là où je suis. Il est ici irréparablement, jamais ailleurs. Mon corps, c’est le contraire d’une utopie, ce qui n’est jamais sous un autre ciel, il est le lieu absolu, le petit fragment d’espace avec lequel, au sens strict, je fais corps. Michel Foucault C’est avec ces paroles que Foucault ouvre le 7 décembre 1966 sa conférence radiophonique « Les corps utopiques » sur France Culture. Pour Foucault, l’utopie première est celle d’un lieu hors de tous les lieux, mais surtout d’un lieu où le corps serait sans corps (Foucault, 2009 (d’après une série de conférences radiophoniques en 1966), p. 10). Le corps est ainsi pour Foucault la référence spatiale première face à laquelle toutes les autres spatialités s’organisent. « C’est autour de lui que les choses sont disposées, c’est par rapport à lui qu’il y a un dessus, un dessous, une droite, une gauche, un avant, un arrière, un proche, un lointain. Le corps est le point zéro du monde, là où les chemins et les espaces viennent se croiser (Foucault, 2009 (d’après une série de conférences radiophoniques en 1966), p. 18). La capacité de déambuler par nos propres moyens nous fournit, déjà dans nos toutes premières années, nos premiers émois liés à un espace que l’on maîtrise – la place de jeux, le parc au coin de la rue ou la place en bas de chez soi – et génère nos premiers soupçons de liberté. Nous découvrons, en tant qu’êtres doués de mouvement, posséder un libre arbitre qui nous permet de nous mouvoir où bon nous semble et d’évoluer au sein d’un monde urbain qui demeure, végétal ou minéral, toujours figé, par essence immobile. Cependant, cette liberté si fraîchement acquise est immédiatement contrainte par des règles de société qui dictent le « mouvoir » ensemble. Se mouvoir, dans un environnement urbain, est un processus extrêmement codé, comme nous avons pu le constater avec l’analyse de Samuel Bordreuil (2010) dans le chapitre dédié au togethering au mouvement I. En sus de ces compétences sociales acquises dès la première enfance qui nous préparent à « l’êtreensemble » en mouvement, nous avons développé au cours de nos vies de citadins quantité de compétences techniques pour déchiffrer les codes de ce monde urbain qui nous entoure, un monde orienté, fléché, contrôlé, un monde rendu visible dans ses axes et ses nœuds. Ses rues, ses places nous sont connues, nous palpons ses tissus, nous goûtons ses textures, nous disposons d’outils sensoriels et cognitifs pour le comprendre et l’intégrer dans l’univers de nos pratiques quotidiennes. Pour Henri Lefebvre, c’est à partir du corps que se perçoit et que se vit l’espace ; c’est donc à partir du corps que l’espace se produit (2000 (éd. orig. 1974), p. 190). Si l’espace ainsi incorporé devient intelligible, notre propre corps, en revanche, bien que véhicule premier permettant l’appropriation de la ville par le mouvement, reste à nos yeux une matière obscure. Sous son écorce de peau qui veille à la surface de notre conscience perceptive, comment fonctionne-t-il ? On le sait sans le savoir vraiment, car nous ne le percevons jamais avec ce degré de réflexivité cénesthésique qui permettrait l’accès aux mouvements intimes au sein de nos propres artères. Ce rêve d’apprenti-sorcier explique peut-être l’attraction qui motive certains à filmer la ville sous toutes ses coutures, comme d’autres filment les opérations qu’ils subissent, dans une tentative extrême de se rendre visible à soi-même. Pour Michel de Certeau, les pratiques urbaines, qui sont avant tout des pratiques corporelles, sont inséparables d’une culture de l’ordinaire (les pratiques, l’expérience) qui passe par le corps. Dès lors, l’enjeu devient celui de comment voir et parcourir un lieu afin qu’il devienne un espace pratiqué ? (Mongin in Paquot et Younès, 2009, p. 104). De Certeau identifie des pratiques qui permettent de créer du mouvement et, partant, de créer des mises en relation. Les lieux deviennent ainsi des espaces pratiqués grâce à des arts de faire, du nom du sous-titre de son ouvrage éponyme (De Certeau, 1990, (éd. orig. 1980), cité par Mongin in Paquot et Younès, 2009, p. 107). C’est dans cette optique que Michel de Certeau se penche sur la pratique de la marche et en particulier sur les énonciations piétonnières et les rhétoriques cheminatoires chères à Jean-François Augoyard, que ce dernier analyse avec beaucoup de finesse dans son ouvrage Pas à Pas. Essai sur le cheminement quotidien en milieu urbain (1979). Comment retrouver alors un corps urbain à partir de la pluralité de ces marches ? De Certeau voit deux manières de faire : soit on consomme ce qui manque dans des images, celles de la publicité urbaine ou du logo qui cherche à faire office d’imaginaire manquant de la ville. Soit on en appelle au lieu-dit, au nom de la ville, porteur de sens (de Certeau, 1990 (éd. orig. 1980), p. 189). De Certeau suit ainsi Bachelard lorsqu’il affirme que la ville doit avoir un nom et des topoï qui activent le discours de la ville et renvoient à des noyaux mythiques : ceux de la légende, du souvenir et du rêve (de Certeau, 1990, (éd. orig. 1980), p. 191, cité par Mongin in Paquot et Younès, 2009, p. 111). Il nous faut, en effet, relever l’importance de la mémoire du corps telle qu’elle a été mise en évidence par Gaston Bachelard dans sa Poétique de l’espace (1998 (1ère éd. 1957)). Pour Bachelard, la poétique de la présence des choses se tisse de toutes les dimensions apportées par la mémoire, s’enrichit de ce qu’apportent au présent les souvenirs du passé. Perception et imagination sont indissociables de la mémoire, à commencer par la mémoire du corps. Les rêveries chères à Bachelard sont ainsi activées et scandées par les mouvements du corps, ses gestes et rythmes. Un paysage urbain se laisse contempler d’autant mieux en le parcourant à pied, en marchant à travers lui au rythme lent du corps (Dutertre, 2007). Ainsi Bachelard note : « Nous ne devons pas oublier qu’il y a une rêverie de l’homme qui marche, une rêverie du chemin » (Bachelard, 1998 (1ère éd. 1957), p. 29, cité par Jean-Jacques Wunenburger in Paquot et Younès, 2009, p. 56).
La corporéité, échelle première de l’aménagement urbain
Du corps à la planète, l’individu est là, activement. Il est le passeur privilégié des spatialités, non seulement par le franchissement des frontières, mais aussi d’une échelle à l’autre ou d’une strate à l’autre. Jacques Lévy L’aménagement urbain se doit donc de toujours revenir à l’échelle première de la corporéité. Foucault insiste clairement sur ce point en substituant au regard trop éloigné et trop figé du plan le regard impliqué et proche des usages du projet : « On ne vit pas dans un espace neutre et blanc ; on ne vit pas, on ne meurt pas, on n’aime pas dans le rectangle d’une feuille de papier. On vit, on meurt, on aime dans un espace quadrillé, découpé, bariolé, avec des zones claires et sombres, des différences de niveaux, des marches d’escalier, des creux, des bosses, des régions dures et d’autres friables, pénétrables, poreuses. Il y a les régions de passage, les rues, les trains, les métros ; il y a les régions ouvertes de la halte transitoire, les cafés, les cinémas, les plages, les hôtels, et puis il y les régions fermées du repos et du chez-soi » (Foucault, 2009 (d’après une série de conférences radiophoniques en 1966), pp. 23-24). Aujourd’hui, la maison, la ville, constituent autant de seuils qui protègent notre corps de manière autrement plus étendue et autrement plus efficace que le seuil de la caverne. Ces seuils nous écartent irrémédiablement des arbres et des bêtes, que nous ne connaissons plus que médiatisés. La nature, auparavant si sauvagement concrète, devient une notion abstraitement domestiquée. Seul un tremblement de terre, ouragan ou autre tsunami, en somme un mouvement majeur, là encore, mais qui nous est profondément étranger et totalement indépendant de notre volonté, nous rappelle que nous ne sommes pas maîtres de notre corps urbain, comme nous ne sommes pas maîtres de notre corps tout court. Comment retrouver un semblant de maîtrise de cette corporéité urbaine ? Il s’agit dès lors, en faisant corps avec la ville, de donner sens au corps, un sens qui ne peut être que dynamique. C’est la mobilité, et en particulier la marche urbaine, qui à travers son engagement du corps offre la première une interface permettant à l’homme et à la ville de s’interpénétrer. Dans le mouvement qui recompose sans cesse cette relation émerge une image de la ville qui fait sens : cette représentation permet à l’homme de nouer son corps au corps de la ville en un véritable engagement urbain, subtil jeu de regards, de frôlements, d’évitements, de rendez-vous manqués, de quasi-certitudes ou de hasards heureux où se loge cette qualité urbaine entre toutes : la sérendipité chère à Jacques Lévy. Pour cet auteur, « les plus de la ville se situent dans la serendipity, c’est-à-dire dans l’accès non programmé et non cloisonné à l’information ainsi que dans les avantages d’interactions multisensorielles avec l’environnement qu’offre l’engagement des corps » (Lévy in Stébé et Marchal 2009, p. 703).