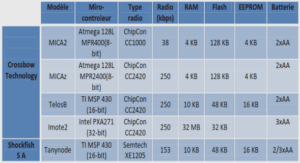Du langage à la langue
Le langage permet à l’homme de réfléchir, de discourir et de penser au-delà des contingences physiques présentes, de se projeter dans un passé ou un avenir qui n’a pas de réalité immédiate. Il est ainsi un élément essentiel de la logique comme instrument de savoir, mais il peut aussi pervertir cette dernière en lui imposant une progression propre et des liens spécifiques. Le langage est d’autant plus intéressant à étudier dans le cadre de ce travail qu’il occupe une place de choix dans l’histoire intellectuelle qui s’intéresse tant aux choses extérieures, en soi, qu’à la structure de l’expérience, à la narration de la réalité par les sujets et aux affaires de l’esprit. Tiraillée entre ces deux tendances externaliste et internaliste, l’histoire intellectuelle s’enrichit de ce double horizon et la langue semble être le seul endroit où les deux dimensions convergent : internalisée dans les individus, elle est aussi un objet de science que l’on peut analyser en termes de connaissance et de construction sociale1 . Dans la perspective méthodologique de cette double approche, cette sous-partie étudie la parole comme horizon de compréhension et la langue comme donnée collective réappropriée par un individu, tension dont le chevalier était conscient. La question de la parole se situe aussi au cœur des débats de l’époque qui interrogent la capacité de cet artefact formel et contingent à ouvrir l’accès à la vérité2 . Donnée ontologique essentielle, élément social ambivalent et postulat métaphysique fondamental, la langue se situe à la croisée d’interrogations diverses qui alimentent la pensée du chevalier. Le langage n’est pas un simple outil à la disposition de l’homme, il contribue à le définir comme acteur du monde et être raisonnable. 3.A.1. Les abstractions L’un des fers de lance des Deux traités est la réfutation du nominalisme que Sir Kenelm attribue aux scolastiques. Le terme même de nominalisme recouvre une grande diversité de doctrines, et je l’entends ici au sens de Guillaume d’Ockham, comme la question de savoir si les termes collectifs ont quelque chose de commun3 . Le problème peut être exposé par l’exemple d’un mot : le mot homme peut accepter trois propositions vraies : homme est un mot d’une syllabe (ou de deux syllabes en latin : homo est vox dissyllaba), l’homme court (homo currit), l’homme est une espèce (homo est species). Le premier terme « homme » fait référence au mot matériel (suppositio materialis), le deuxième représente l’un des individus de la classe qu’il désigne (suppositio individualis) tandis que le dernier tient la place de quelque chose de commun aux individus auxquels il fait référence (suppositio simplex) 1 . Les trois occurrences ont-elles quelque chose de commun qui soit réel ? Digby s’inscrit dans cette tradition anti-nominaliste lorsqu’il critique l’inutile multiplication de concepts qu’effectue la philosophie de son temps. À l’instar d’Ockham, il fustige ceux qui ont pris les « substances secondes » d’Aristote pour des étants principiels et qui ont perçu les « substances premières » comme le résultat de l’individualisation des espèces générales2 . Le langage constitue le site de cette tension liée à la façon dont l’homme perçoit son environnement. La première partie de ce travail présentait la fragmentation du réel par les sens, il convient maintenant d’analyser comment le langage prend part à ce processus. Le danger de morcellement du monde guette les philosophes, et en particulier les scolastiques, qui, au lieu de décrire le réel, réifient le langage et profitent de sa puissance plastique pour créer des entités nouvelles sans égards pour les différentes parties qui composent le monde. Digby considère qu’ils se fourvoient en prenant la représentation pour fin ; en se focalisant sur le cristal de l’horloge, ils ne voient pas le mouvement qui l’anime3 , ils prêtent trop d’attention aux termes au détriment du sens et du monde créé. Leur approche de la connaissance se limite à des jeux de mots, et, pour illustrer leur manque de cohérence et leur enseignement, le chevalier Digby les compare à l’élève féru d’école buissonnière qui invente des termes latins lorsque son père suspicieux l’interroge4 . Les scolastiques se comportent de même quand ils inventent des qualités pour expliquer l’apparence du monde. Digby reprend un exemple d’Ockham5 pour illustrer son propos que l’on peut paraphraser ainsi : quand on leur demande ce qui fait qu’un mur nous apparaît blanc, ils répondent que c’est en raison d’une qualité qu’on appelle la blancheur, qui est répandue dans le mur. Quand on leur demande pourquoi cette blancheur reste sur le mur, ils rétorquent que c’est en vertu d’une qualité nommée « l’union » dont la nature est de joindre ensemble la blancheur et le mur. Pourquoi la blancheur d’un mur est-elle conforme à celle d’un autre ? Parce qu’il existe une qualité de similitude qui permet à deux choses de se ressembler. Pour Digby, ces qualités n’ont pas plus de sens que les inventions juvéniles latinisantes de l’écolier, et il fait écho à une critique relativement répandue en son temps des arguties scolastiques et de l’excès d’abstraction à laquelle un Thomas Hobbes ou une Margaret Cavendish donnèrent aussi voix1 . Le chevalier leur reproche deux choses : d’une part, la doctrine des qualités ainsi conçue n’explique rien et ne fait que paraphraser une description simple de la réalité, et, d’autre part, elle fait croire à l’existence d’une myriade de petites entités, séparées par nature de la substance à laquelle elles sont rattachées, indifférentes aux autres substances, et étant toujours à l’origine des mêmes effets2 – Sir Kenelm refuse que les termes universels soient autre chose que des abréviations pour un agrégat d’individus. Le savoir ne peut se limiter à la connaissance des mots, ou du vocabulaire associé à une discipline. Digby loue les erreurs du jésuite Niccolò Cabeo – dont le travail sur le magnétisme avait suscité l’opprobre du chevalier – qui témoignent que le philosophe ne s’est pas contenté d’un savoir verbeux, de ces termes qui n’expriment pas l’essence de la chose, mais qu’il s’est confronté aux choses mêmes3 . La conclusion de Digby est simple : il ne faut pas prendre les mots pour les choses, au risque de croire à la réalité des accidents et de se quereller sans cesse sur le sens d’un mot, comme sur la question des pôles de l’aimant.
La langue comme critère ontologique
Chez Digby, le langage, du fait à la fois de son caractère social et de son origine humaine, contribue fortement à définir la nature de l’homme, comme on le voit dans l’épisode de Jean de Liège relaté dans les Deux traités, où l’enfant sauvage, à mesure qu’il s’enfonce dans la vie animale, perd l’usage de la parole. Ainsi, décrit Digby, on a rarement vu un homme « si proche de la bête, qui n’avait aucun langage pour demander ce qu’il souhaitait ou ce dont il avait besoin1 ». La comparaison avec les bêtes est reprise plus loin lorsque le chevalier se demande si les cris et les grognements des animaux peuvent être considérés comme un langage à part entière : parler est un acte de raison, affirme le chevalier, non pas parce que l’opération exprime des choses raisonnables, mais parce qu’elle incarne le travail même du discernement, elle met en forme la réflexion. Il n’y a pas de langage sans raison2 . Les bruits des animaux sont les fruits mécaniques et involontaires de mouvements du cœur et de divers organes, ils n’expriment pas un raisonnement et ne peuvent être considérés comme un langage proprement dit. Tout au plus peut-on les estimer actes de langage, par leur dimension purement physique et extérieure, c’est-à-dire par l’expression de sons grâce au passage du souffle dans la bouche, entre la langue, le palais et les dents, et ainsi de suite. La langue, quant à elle, est strictement humaine, elle constitue un acte interne de locution qui correspond à l’élaboration de la réponse, au choix des mots, à l’emploi de l’argument à propos ; ni instrument ni animal ne peuvent prétendre à cet aspect3 . Cette définition ontologique de la communication explique peut-être l’intérêt que prit Digby dans la communication avec les sourds-muets qu’il rapporte dans ses Deux traités. Vingtet-un ans plus tôt, au cours de son séjour en Espagne avec son oncle ambassadeur John Digby, il eut l’occasion de voir un jeune seigneur espagnol, sourd de naissance, qui avait acquis le langage grâce à l’industrie et à la patience d’un prêtre qu’il nomme Juan Paolo Bonet4 . La méthode mise en pratique fascine le chevalier parce qu’elle part d’éléments premiers « simples et nus » pour parvenir à la subtilité du langage5 , à l’instar de la méthode de Digby que j’appelle spagirique. L’instruction correspond en tous points aux convictions du chevalier : elle part de composants élémentaires puis s’achemine vers une complexification progressive, et elle permet de restaurer l’humanité d’une personne dont tout indiquait qu’elle bénéficiait du plein usage de sa raison. Jean de Liège et le jeune seigneur espagnol sont deux êtres qui, grâce à l’acquisition du langage, ont pu regagner les rangs de l’humanité à part entière. À l’origine, le langage est l’expression de notions ou d’images propres d’une personne, il occupe donc avant tout un rôle individuel, même s’il relie l’homme à la collectivité1 . Mais si cette forme d’expression peut être comprise par d’autres, c’est grâce à une convention sociale qui crée le sens par l’imposition arbitraire de noms à des signes particuliers, et qui recueille l’assentiment général sur l’usage de chaque mot2 . Digby est ainsi opposé à l’idée d’une origine divine du langage3 . Pour lui, le signe que constitue le mot suscite un frémissement dans l’entendement qui fait surgir la notion en question sur le devant de la scène. Digby a foi dans la langue, ses nombreux lettres et poèmes le prouvent, il pense que ceux-ci peuvent agir comme un miroir et exprimer l’état de l’âme à autrui, comme il le souligne dans sa lettre à Joseph Rutter, le remerciant pour la dédicace de sa pièce de théâtre qui le représente, mari éploré éperdu d’amour pour sa femme décédée. Les mots du dramaturge « [lui] apparaissent dans votre copie comme un beau reflet dans un miroir lisse et poli », ils sont des reproductions fidèles de sa douleur originale4 . Il y a une indifférence du mot à sa réalité matérielle, et si les termes sont les images d’une notion, ils permettent un accès au sens d’une façon générale5 . Ainsi, l’homme qui demande de l’argent comprend, quand il se voit remettre des pistoles, que cette entité entre dans la catégorie qu’il nomme, et que s’il voulait des couronnes, il lui fallait être plus précis. Les termes mêmes n’indiquent pas de relation nécessaire entre argent et pistole, mais le sujet, grâce à ses notions, est capable de voir le lien ; il faut donc en déduire que l’entendement est indifférent aux mots employés, mais qu’il est fidèle aux notions signifiées qui leur sont associées6 . Les mots sont ainsi une forme de représentation, ils mettent en scène le vécu intérieur de la personne et acheminent l’interlocuteur vers les notions de l’énonciateur.