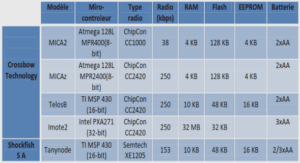Le rôle capital de la substitution
Nous pouvons alors revenir à « La rhétorique restreinte », où l’on trouve une idée voisine de celle de masque, qui explique l’accusation de mensonge : Par définition, tout trope consiste en une substitution de termes, et par conséquent suggère une équivalence entre ces deux termes, même si leur rapport n’est nullement analogique : dire voile pour navire, c’est faire de la voile le substitut, donc l’équivalent du navire. Or, le rapport sémantique le plus proche de l’équivalence, c’est évidemment la similitude, spontanément ressentie comme une quasiidentité, même s’il ne s’agit que d’une ressemblance partielle. Il y a donc, semble-t-il, une confusion presque inévitable, et qu’on serait tenté de considérer comme « naturelle » entre valoir pour et être comme au nom de quoi n’importe quel trope peut passer pour une métaphore. Toute sémiotique rationnelle doit se constituer en réaction contre cette illusion apparemment première, illusion symboliste que Bachelard aurait pu ranger au nombre de ces obstacles épistémologiques que la connaissance objective doit surmonter en les « psychanalysant ». La motivation illusoire du signe, par excellence, c’est la motivation analogiste, et l’on dirait volontiers que le premier mouvement de l’esprit, devant un rapport sémantique quelconque, est de le considérer comme analogique, même s’il est d’une autre nature, et même s’il est purement « arbitraire », comme il arrive le plus souvent dans la sémiosis linguistique par exemple : d’où la croyance spontanée en la ressemblance des mots aux choses, qu’illustre l’éternel cratylisme – lequel a toujours fonctionné comme l’idéologie, ou la « théorie indigène » du langage poétique.53 Une fois de plus, ce développement de Genette possède une grande force de séduction, et l’on ne peut que tomber d’accord sur un certain nombre de points : le rôle central de la substitution dans le destin de la métaphore, notamment, et la survalorisation du rapport analogique dans certains cas – par exemple avec la référence au cratylisme, même si celle-ci cumule en fait plusieurs types d’analogies, pas toutes « métaphoriques ». Gérard Genette met en particulier le doigt sur le point central en soulignant la confusion entre « valoir pour » (le rapport de substitution) et « être comme » (le rapport d’analogie) : la définition de la métaphore organise souvent le passage de l’un à l’autre lorsqu’elle présente celle-ci comme désignant quelque chose dans les termes d’autre chose, ou sous le signe d’autre chose (comme souvent en langue anglaise) ou la métaphore comme désignant une chose en utilisant un mot à la place d’un autre (plus fréquemment dans les langues romanes). Mais il faut souligner que cette remarque, cette « confusion presque inévitable » vaut pour lui aussi, et peut-être même surtout, qui réserve une place à part à la métaphore in absentia. De ce point de vue, les contempteurs de la métaphore ressemblent beaucoup à certains thuriféraires, et notamment Genette à ceux qu’il critique. Pourquoi la métaphore in absentia est-elle la seule à être appelée métaphore, si ce n’est précisément parce qu’on ne veut voir en elle qu’une cumularde, qu’une confusionniste, jouant des deux rapports de l’« être comme » et du « valoir pour », parce qu’elle seule vaut pour quelque chose avec lequel elle entretient un rapport de similitude ? N’était-il pas préférable, au contraire, au nom du souci de rigueur tant invoqué, de ne conserver qu’un seul des deux critères ? C’est d’ailleurs une dernière assimilation qui complète ce premier portrait implicite de la métaphore : derrière la confusion justement relevée entre « valoir pour » et « être comme », on perçoit une autre confusion, sur laquelle joue également Genette, avec « passer pour ». C’est presque le même jeu de mots que chez Turbayne entre « prendre », utiliser, et « méprendre », confondre. On le retrouve aussi chez Lacan, entre autres exemples : « Un mot pour un autre, telle est la formule de la métaphore », peut-on lire en effet dans « L’instance de la lettre dans l’inconscient » où Lacan dénonce auparavant, de façon cohérente, la « définition » surréaliste de la métaphore : « L’étincelle créatrice de la métaphore ne jaillit pas de la mise en présence de deux images, c’est-à-dire de deux signifiants également actualisés. Elle jaillit entre deux signifiants dont l’un s’est substitué à l’autre en prenant sa place dans la chaîne signifiante, le signifiant occulté restant présent de sa connexion (métonymique) au reste de la chaîne. »
La métaphore comme violence contre le langage et le réel
Cette idée d’une dissimulation propre à la métaphore n’en conduit pas moins certains auteurs à suggérer l’idée d’une véritable violence de la figure. On pourrait commencer par Structure du langage poétique, en 1966, où c’est encore très discret : Jean Cohen présente la poésie comme « violation systématique du code du langage, chacune des figures se spécifiant comme infraction à l’une des règles qui composent ce code ». La poésie n’est pas, pour lui, « de la prose plus quelque chose », c’est « de l’antiprose » : « Sous cet aspect, elle apparaît comme totalement négative, comme une forme de pathologie du langage. » L’auteur signale néanmoins, ensuite, que « cette première phase en implique une autre, positive celle-là », que « la poésie ne détruit le langage ordinaire que pour le reconstruire sur un plan supérieur ».57 Mais, comme il le souligne lui-même, c’est cette première phase qui est la plus développée dans son livre, la dernière n’étant exposée pour l’essentiel que dans le dernier chapitre. Ce n’est pas seulement pour des raisons de méthode ou de nouveauté scientifique, comme il l’avance, c’est évidemment parce que cette première étape est la plus compatible avec l’herméneutique du soupçon propre au structuralisme. La seconde, qui appelle davantage une herméneutique « instaurative », pour reprendre l’expression de Gilbert Durand, ne pouvait que susciter des doutes, des problèmes théoriques, et c’est probablement à elle que songeait Genette quand il évoquait la métaphore qui jouait le rôle de Marie la contemplative, qui s’appropriait « la meilleure part », laissant la mauvaise à Marthe : Cohen est d’ailleurs cité dans « La rhétorique restreinte », on s’en souvient ; il prend des coups, alors que la théorie structurale de la métaphore lui doit beaucoup (comme cela est reconnu par le groupe µ, par exemple, un peu aussi, mais moins nettement, par Le Guern). Quoi qu’il en soit, la métaphore apparaît ensuite comme « violation du code de la langue », faisant suite à une prédication impertinente, à une « violation du code de la parole ». La métaphore est en effet identifiée par Cohen à la seconde étape, à la « réduction d’écart » suivant la perception d’un « écart », dans un mouvement qui le conduit d’ailleurs à identifier toute réduction d’écart à la métaphore, élargissement de sens légitimement critiqué par le groupe µ. On pourrait donc dire, en s’écartant légèrement de la lettre des propos de Cohen, que la métaphore est formée de deux violations symétriques du code du langage. Il s’agit selon lui d’« écarter » le premier signifié de la métaphore pour qu’ensuite un second signifié « prenne sa place » : « Là est le but de la poésie : obtenir une mutation de la langue qui est en même temps, nous le verrons, une métamorphose mentale ».58 Cette conception est joliment rappelée en conclusion, dans un passage qui n’est pas sans rappeler Victor Chklovski : « La métaphore n’est pas seulement changement de sens, elle en est la métamorphose. La parole poétique est tout à la fois mort et résurrection du langage. » Seulement, ce qui frappe le plus dans cet ouvrage, c’est que Jean Cohen ne pense jamais la possibilité d’une novation de sens à travers la métaphore ou la poésie : le sens est seulement métamorphosé. À la dénotation s’ajoute une connotation purement « émotionnelle », un « sens émotionnel » qui constitue la métaphore poétique, « l’image émotionnelle ». On ne peut s’empêcher de percevoir comme une régression l’idée que « la métaphore est nécessaire » de la même façon que « la poésie est art, c’est-à-dire artifice », autrement dit qu’elles répondent toutes deux au besoin de subvertir le langage ordinaire, trop étroitement dénotatif. C’est ainsi que l’auteur peut conclure : « c’est pourquoi le poète est tenu de violer le langage s’il veut lever ce visage pathétique du monde, dont l’apparition produit en nous cette forme limite de la joie esthétique que Valéry appelle “enchantement”. » 59 Aussi Structure du langage poétique ne s’éloigne-t-il pas beaucoup finalement de la vieille tradition rhétorique : si la poésie et la métaphore constituent de l’antiprose, ils n’en ressemblent pas moins à un simple « supplément d’âme », malgré les dénégations, déployant un luxe de procédés sans rien apporter d’autre qu’un plaisir assez vain. Cette idée de « sens émotionnel », qu’on retrouve chez Le Guern sous la forme d’une simple « image associée » 60 qui se superpose à la signification du premier mot, comme une connotation qui n’apporterait aucune information logique, rejoint la vieille idée des mots natifs, du sens propre, qui seraient ornés, maquillés par la métaphore – celle-ci introduisant un risque de malentendu mais aussi un éclat supplémentaire, qui compenserait le défaut de précision. Seulement, comme Jean Cohen perçoit malgré tout la puissance de la métaphore, il n’en reste pas à cette idée traditionnelle dans la rhétorique : il introduit l’idée de viol du langage (mais surtout au sens de violation de son code, comme on peut enfreindre le code de la route, même s’il joue de l’ambiguïté) ainsi que l’idée de métamorphose mentale.