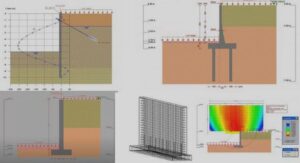La métaphore comme idéologie, comme distinction : une figure bourgeoise ?
L’idée d’une défiguration proprement métaphorique, d’une violence faite au réel par cette figure, ne relève pas d’une conception authentiquement magique de ses pouvoirs, dans l’écrasante majorité des cas – ces pouvoirs n’étant, généralement, pas reconnus. En fait, c’est une lecture vaguement politique qui domine, même si cet implicite est rarement explicité : derrière l’image d’une figure élitiste, dominante, « reine des figures et des salons », on retrouve fréquemment l’idée du caractère idéologique de la métaphore, voire de son caractère « bourgeois ». Sa dimension prétendument spirituelle, voire certaines accusations de mensonge, d’illusion, s’expliquerait ainsi : métamorphosant le réel, imposant le point de vue de son auteur, la métaphore serait l’opium du littéraire, un de ces mirages anesthésiants proposés par la société de classes. Tout ce que nous avons déjà exposé peut se réinterpréter ainsi : la métonymie Marthe, « l’active, la ménagère, qui s’affaire, va et vient, passe, chiffon en main, d’un objet à l’autre », et la synecdoque Cendrillon, qui toutes deux respectent davantage les faits, seraient les armes à opposer à une métaphore qui masque ou sublime le réel, qui dissimule et qui enchante, qui divertit, qui émeut sans rien apporter. On retrouve même cette idée d’une métaphore « petite bourgeoise » sous la plume d’Henri Lefebvre, qu’on a connue plus inspirée : « Dans le “monde pavillonnaire”, on peut dire que la métaphore est reine. C’est une métaphore transubstantiante : un coin de pelouse, “c’est” la nature, la santé, la joie, vécues de façon à la fois fictive et réelle. Le symbole, miniaturisé, pullule : l’arbuste, le jet d’eau, l’animal en faïence, etc. Dans les grands ensembles la métonymie l’emporte : le tout est dans la partie et la partie équivaut au tout par permutation d’éléments identiques ».85 Si la critique de la métaphore touche même l’auteur de Critique de la vie quotidienne et de L’Idéologie structuraliste, en 1966, c’est bien qu’elle s’étend à des gens très divers, qu’elle se renforce de grilles d’analyse différentes. Le groupe µ relève d’ailleurs cette idée du philosophe marxiste, qui n’était encore qu’accessoire dans Le Langage et la Société, pour lui donner en 1970 statut de programme tout à la fois rhétorique et politique : « nous ne pensons pas qu’il soit vain de traquer les figures de style jusque dans les H.L.M. Nous croyons au contraire que tel est bien l’objectif d’une rhétorique généralisée. » Et de définir leur projet comme une reprise plus scientifique de la même idée : « Mais il faut généraliser à partir de bases solides. »86 On le voit, cette façon de présenter la métaphore contre les HLM témoigne d’une volonté politique de régler des comptes. De ce point de vue, l’opposition entre « homme de science » et « homme de lettres », telle qu’on a pu la rencontrer dans Rhétorique générale, ou entre rhétoriqueur et poète semble bien provenir d’un marxisme mal digéré, qui se devinait déjà dans l’exigence d’une « distanciation » propre au rhétoriqueur : derrière l’apparence brechtienne, c’est l’idée de Turbayne qui est utilisée, mais le mot apporte une évidente « connotation » révolutionnaire. Lorsque le groupe µ expose le cas du poète qui refuse de dire qu’« un chat est un chat » (Baudelaire, en l’occurrence), les choses sont plus claires encore, il attaque précisément sa démonstration par une profession de foi « matérialiste » : « Il est vrai que dans certains contextes socio-culturels, la divinisation du chat n’est pas métaphorique. De même, la vache, qui pour nous est bonne à traire, est un être divin pour les Hindoux. »87 Le poète apparaît comme un « ennemi » en cela que, pour lui, le monde n’est pas rempli de choses ou d’êtres « bons à traire ». On pense alors à ces marxistes évoqués par Castoriadis qui extrapolent à l’ensemble de l’humanité les motivations et les valeurs de leur société, qui érigent « la mentalité capitaliste en contenu éternel d’une nature humaine », étranges « révolutionnaires » qui traitent par le mépris la majorité de la population du globe – comme ici les poètes et les Hindoux – alors qu’ils constituent eux-même une autre « curiosité » anthropologique.88 En effet, entre la divinisation des animaux et leur réification, ou du moins leur utilisation sans égard, il y a un espace pour un rapport apaisé aux autres êtres. Ce n’est d’ailleurs pas seulement pour les Hindoux qu’une vache mérite mieux que l’exploitation industrielle. A-t-on jamais vu un paysan considérer vraiment ses vaches comme du vulgaire bétail, tout juste bon à traire, puis à abattre quand il ne produit plus assez de lait ? Or, ce respect des bêtes repose bien sur une espèce de métaphore, sur une intuition de cet type-là : même s’il ne s’agit pas de dire qu’un chat ou une vache est un dieu, c’est voir en l’animal comme une personne, « quelqu’un » qui mérite de la considération. Est-ce voiler une « réalité » pour autant, est-ce « défigurer » le concept d’animal ? Considérer les bêtes ainsi ne fait pas de Baudelaire ou des paysans des émules de Brigitte Bardot avant la lettre : respecter un animal, ce n’est évidemment pas – pas forcément, du moins – le considérer jusqu’au bout comme d’une égale dignité avec l’humain. On voit donc bien ici l’importance de la métaphore in absentia dans la théorie : la métaphore joue le rôle de l’idéologie, elle masque le réel en effectuant un tour de passe-passe entre les mots, entre leurs signifiés, voire chez certains auteurs entre leurs référents. Dans « Proust palimpseste », par exemple, Genette rapproche lui aussi la métaphore de l’idée de transsubstantiation, la même année que Lefebvre, mais dans un contexte beaucoup moins polémique : il s’appuie notamment sur une lettre de Proust à Lucien Daudet où l’écrivain évoquait ces phrases merveilleuses « où s’est accompli le miracle suprême, la transsubstantiation des qualités irrationnelles de la matière et de la vie dans les mots humains ». Et Genette de relever plusieurs passages très intéressants qui développent l’idée de ce miracle littéraire, de cette « conversion » de la réalité « en une même substance », pure, réfléchissante, « une espèce de fondu, d’unité transparente » semblable au vernis des peintres.89 Genette ne relève d’ailleurs pas une autre métaphore que l’on devine ici, celle de la transmutation alchimique, de la pierre philosophale. En revanche, il présente sous une forme très platonicienne la recherche proustienne d’une « essence des choses », référence qui n’est pas étrangère à l’auteur de La Recherche en effet, mais qui ne joue pas un rôle aussi central. Cependant, ce n’est pas une religion de la métaphore, comme dans « La rhétorique restreinte », que dénonce ici l’auteur de Figures
Le pacte ancien entre la métaphore et le mot
La métaphore comme substitution (Aristote et les autres) Aristote ne définit donc pas la métaphore dans la Rhétorique. Lorsqu’il aborde cette question, il commence par renvoyer à la Poétique : c’est dans celle-ci qu’il définit la métaphore comme « transport à une chose d’un nom qui en désigne une autre », avant de distinguer quatre espèces de métaphores ; « métaphore » est alors, on l’a vu, un mot employé pour dire trope. C’est dans le même sens qu’il donne, peu après, l’exemple de la métaphore pour évoquer l’exigence dans la littérature d’une expression qui soit « claire sans être basse », qui « use de mots étrangers à l’usage quotidien ». Mais, deux pages plus loin, quand il écrit « ce qui est de beaucoup le plus important, c’est d’exceller dans les métaphores », il glisse clairement vers un second sens, celui de métaphore par analogie, puisqu’il ajoute : « En effet, c’est la seule chose qu’on ne peut prendre à autrui, et c’est un indice de dons naturels ; car bien faire des métaphores c’est bien apercevoir les ressemblances. » 103 Le même glissement s’opère, très vite, dans la Rhétorique : cette idée du « talent de la métaphore » qu’on ne peut « emprunter d’autrui » est d’ailleurs rappelée, avant que l’harmonie des métaphores en général ne soit présentée comme le résultat d’une analogie.104 Ce qui intéresse le plus nettement Aristote, c’est donc bien la quatrième espèce de métaphore, la métaphore au sens où nous l’entendons aujourd’hui, à tel point qu’il en oublie parfois sa première définition pour identifier le genre à l’espèce. Bien sûr, Aristote ne néglige pas totalement les autres figures de mot, et l’on trouve dans ses développements, parmi les « métaphores », ce qu’on appellerait aujourd’hui des hyperboles, des euphémismes, etc. Nous pouvons néanmoins remarquer que « la rhétorique restreinte » décriée par Genette existe dès l’origine, avec l’auteur de la Poétique : une préférence très nette est marquée pour l’une des figures de mot. D’ailleurs, Aristote consacre à la quatrième espèce de « métaphore » bien plus de la moitié de son développement sur la μεταφορά. 102 François Châtelet, Platon, Gallimard, Paris, 1990, coll. Folio essais, p. 37. L’idée est d’abord exposée, puis elle est développée ensuite, par exemple, dans tout le chapitre 2 : « Ce que parler veut dire (ce que veut dire parler) ». 103 Aristote, Poétique, 21-22, 1457b-1459a, op. cit., p. 61-65. 104 Aristote, Rhétorique, III, 2, 1405a, op. cit., p. 43. 235 Seulement, alors qu’Aristote se préoccupe essentiellement de la métaphore par analogie, la définition de la métaphore reste celle du trope, celle du genre. C’est là le point essentiel : un lien se noue, dès la Poétique, dès la première définition de la métaphore, entre elle et le nom, entre la métaphore et la théorie de la substitution. Peut-être le disciple de Platon n’a-t-il fait là que reprendre une définition existante, quitte à la modifier un peu : il indique d’ailleurs dans sa Rhétorique qu’il existe, au moment où il l’écrit, un art du style davantage constitué que l’art oratoire authentique. 105 Isocrate ou Anaximène de Lampsaque, l’auteur probable de Rhétorique à Alexandre, dont les écrits sont soit antérieurs à ceux d’Aristote soit contemporains, évoquent d’ailleurs la métaphore dans le même contexte d’une réflexion sur les différentes « sortes de mots », de noms ou d’expressions.106 Il est donc très vraisemblable qu’Aristote n’innovait pas sur ce point. Mais que cette définition de la métaphore comme quelque chose qui arrive au nom tienne en propre à Aristote ou non n’y change rien : la même définition se répètera de siècle en siècle, sans grand changement, malgré le déplacement du genre vers l’espèce ; la définition de la métaphore répète alors celle du trope et se contente d’y ajouter un lien de ressemblance, et ce alors que ce dernier est pensé chez Aristote sur un autre modèle, celui de l’égalité de rapports, de la proportionnalité. Aussi la reprise de la définition aristotélicienne va-t-elle souvent de pair avec une déperdition assez forte de la théorie initiale : là où une certaine tension était décelable entre la définition de la métaphore comme genre et celle de la métaphore par analogie, il n’existe plus rien de tel par la suite, dans les grandes rhétoriques qui ont succédé, les plus connues du moins, alors que c’était probablement là ce qui constituait son principal apport. La déperdition, bien indiquée par Ricœur, s’effectue d’ailleurs à plusieurs niveaux. Catherine Détrie fait remarquer, par exemple, que la rhétorique « classique » se met souvent à définir la métaphore comme substitution d’un mot à un autre, et non plus comme transport à une autre chose d’un nom qui désigne une chose. 107 Les exemples sont innombrables : si la métaphore est, chez l’auteur d’Ad Herennium, le transfert d’un mot « d’une chose à une autre parce que la similitude semblera autoriser ce transfert » (comme chez Lamy, au XVIIe siècle), chez Cicéron, c’est « le transfert d’un mot pris d’une autre notion, par l’intermédiaire de la ressemblance », ou un mot « transporté du sens propre au sens figuré et qui se trouve comme dans une place d’emprunt » ; chez Quintilien c’est le transport d’« un nom ou [d’]un verbe d’un endroit où il est employé avec son sens propre dans un autre » ; chez Dumarsais c’est « le transport de la signification propre d’un mot à une autre signification », etc. Certes, la métaphore n’a jamais vraiment été présentée comme une « mise en scène de la pensée » capable de re-décrire, de redéfinir le réel, comme le souligne Ricœur. 108 Mais, avec ces différentes définitions, elle n’apparaît même plus très nettement comme un jeu de représentations portant sur le réel : très tôt, elle apparaît presque comme un jeu de mot, comme un simple déplacement de significations. Ce pacte entre la métaphore et le mot, ce lien étroit posé dans la Poétique, n’est donc pas dissout dans la Rhétorique non plus, malgré le rapprochement qu’Aristote effectue avec la comparaison, malgré les exemples de métaphores in praesentia, malgré les développements qu’il propose sur la métaphore par analogie, pourtant définie comme un rapport entre quatre termes. Les occasions, on 105 Aristote, Rhétorique, III, 1, 1403b, 24-25 et 1404a, 20-29, op. cit., p. 39 et 40, où il cite Glaucon de Téos et défend la légitimité d’une théorie du style non poétique. 106 Isocrate, Evagoras, 9, dans Discours, tome 2, Les Belles Lettres, Paris, 1961, p. 148, et Pseudo-Aristote, Rhétorique à Alexandre, Les Belles Lettres, Paris, 2002, 1434b, p. 65. 107 Catherine Détrie, Du sens dans le processus métaphorique, op. cit., p. 34 et p. 40 notamment. 108 Paul Ricœur, La Métaphore vive, op. cit., p. 83. 236 l’a vu, étaient nombreuses. Les rhétoriques ultérieures ne feront que renforcer ce pacte en consacrant le partage des figures que nous connaissons : on ne retrouve chez aucun successeur, à ma connaissance, l’intimité du lien établi par Aristote entre métaphore, comparaison et analogie à quatre terme. Certes, quelques souvenirs existent, chez Quintilien, Lamy ou Dumarsais par exemple, mais ils sont timides, et toujours différents d’ailleurs. C’est ainsi que « la dictature du mot », comme l’appelle Ricœur en réponse à « la dictature de la métaphore » décelée chez Genette, déploie toute une série de conséquences, « de postulats qui, de proche en proche, rendent solidaires la théorie initiale de la signification, axée sur la dénomination, et une théorie purement ornementale du trope ». Nous avons évidemment ici l’une des sources principales, peut-être la plus ancienne, du soupçon sur la métaphore. Il vaut la peine de résumer cette série de postulats, proposée par Ricœur pour étudier Fontanier, mais « dont l’ensemble constitue le modèle implicite de la tropologie » et, serait-on tenté d’ajouter, de toute elocutio. On peut donc relever : a) le « postulat du propre et de l’impropre ou du figuré » : idée que « certains noms appartiennent en propre à certaines sortes de choses », les tropes faisant alors exception constituent « des sens impropres ou figurés » ; b) le « postulat de la lacune sémantique » : « certaines sortes de choses sont appelées d’un terme impropre », il y a donc parfois « absence du mot propre dans le discours », lacune délibérée ou contrainte qui « résulte soit d’un choix de caractère stylistique, soit d’un réel manque » dans le code lui-même ; c) le « postulat de l’emprunt » : « la lacune lexicale est comblée par l’emprunt d’un terme étranger » ; d) le « postulat de l’écart » : l’emprunt a lieu « au prix d’un écart entre le sens impropre ou figuré du mot d’emprunt et son sens propre » ; e) l’« axiome de la substitution » : « le terme d’emprunt, pris en son sens figuré, est substitué » au mot absent ; f) le « postulat du caractère paradigmatique du trope » : la transposition s’effectue en fonction d’une raison qui « constitue un paradigme pour la substitution des termes » ; dans le cas de la métaphore, il s’agit de la ressemblance ; g) le « postulat de la paraphrase exhaustive » : « expliquer (ou comprendre) un trope », c’est « restituer le terme propre » ; h) le « postulat de l’information nulle », solidaire du précédent : « l’emploi figuré des mots ne comporte aucune information nouvelle » ;