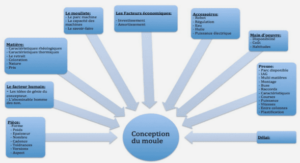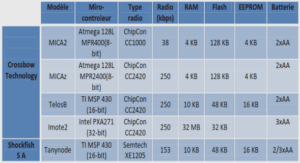L’homme double
Définition, nature et fonctionnement de l’âme
Qu’est-ce qui fonde l’identité profonde de l’homme ? Qu’est-ce qui fait que la personne est toujours la même, depuis sa conception dans la matrice jusqu’à l’éternité où elle est séparée à jamais de son corps pourrissant, avant de retrouver une enveloppe charnelle dont la nature reste à déterminer ? Dans le drame de la vie baroque, où l’homme, successif, ne cesse de changer et de se métamorphoser, la question de l’identité individuelle se pose avec une urgence aiguë1 . Digby s’inspire, pour répondre, du célèbre Discours de la méthode de Descartes, paru quelques années plus tôt, et dont il avait recommandé la lecture à Thomas Hobbes2 . L’approche à la première personne du singulier fait écho à son contemporain français3 : Si je m’examine et m’interroge : qui suis-je quand je marche, ou je parle, ou je pense, ou je donne des ordres ? Ma raison me répond que même si j’étais privé de mes jambes ou de ma langue et que je ne pouvais plus marcher ou parler, je ne serais pourtant pas inexistant, et je saurai et verrai avec mon entendement que je suis toujours la même créature, le même ego qu’auparavant4 . Le chevalier reprend le raisonnement cartésien, mais, au lieu d’avancer à partir de certitudes vérifiées, il anatomise le monde, s’interrogeant sur sa faculté de demeurer luimême s’il perd l’usage de sa langue ou de ses jambes. Il définit ainsi la personne en dehors du champ du mouvement volontaire, puis de la parole, et enfin des perceptions par les cinq sens. La raison établit que l’ego demeure inchangé. Puis, le chevalier examine le processus interne de digestion – dont on se souvient qu’il était central dans la conception et au maintien de l’être vivant – pour l’éliminer comme cause essentielle de l’être. Enfin, le travail de l’imagination et les phantasmes qu’elle traite sont eux aussi exclus – la pensée elle-même, qu’il prétend mal nommée puisqu’elle recouvre dans ce cas la simple présence de signes du monde extérieur, ne constitue pas le ferment de l’identité pérenne1 . Le cerveau pourrait ne plus être que le penseur serait toujours. Comme Descartes, Digby établit ainsi le fondement de la personne dans sa capacité à penser et non dans l’acte associé. À l’appui de sa théorie, il avance le fonctionnement du rêve : n’y faisant usage ni de sa raison ni des organes sensoriels, le rêveur n’en existe pas moins. Il est à noter au passage que la thématique du rêve, chère à l’esthétique baroque2 , surgit çà et là dans la pensée de Digby et fait souvent office de preuve3 . Dans une méditation non datée, il évoque l’aveugle et l’endormi pour dire les capacités en puissance de l’âme : l’un comme l’autre a les facultés de voir et de réfléchir, alors même qu’ils n’en font pas usage. L’activité intellectuelle de l’âme est ainsi en puissance chez tous, et cette potentialité suffit à définir l’être comme personne4 . Quand tout corps est abstrait en l’entendement, il demeure toujours une substance, un « je » qui n’est en rien amenuisé par la perte de son enveloppe de chair. Ainsi, l’âme a la préséance dans la définition de la personne. Pour déterminer quel est le ferment présent en l’homme qui permet d’affirmer qu’il demeure toujours le même malgré ses métamorphoses multiples, Digby, paradoxalement, emprunte aussi sa méthode à l’alchimie et attribue cette vertu à un substrat, à une forme qui permet ensuite la résurrection, partant du principe qu’aucun agent n’a la capacité d’éliminer entièrement la matière d’une forme sans laisser un infime support, une étincelle, qui a le pouvoir presque magique d’assimiler de la matière pour se recréer5 . La destruction absolue et intégrale est impossible, un substrat infrangible demeure toujours. L’expérience de la palingenèse, décrite plus tôt6 , illustre cette idée : le vecteur rescapé ayant une propension à la dilatation, il se recrée avec une matière renouvelée. Figé dans la glace, il révèle parfois ses contours. Comme une métonymie, ce « sel » représente l’ensemble auquel il appartient, il est présent dès la conception et demeure inchangé, que l’être soit fini ou en évolution, qu’il soit incarné ou, au contraire,qu’il soit au-delà de la mort1 . Ce substrat, cette « forme » du corps, est l’âme, seule garante de la pérennité de l’individu. La définir comme immortelle et immatérielle revêt dès lors un enjeu central, tant pour le salut de l’homme que pour la compréhension du monde. Une telle définition sert évidemment la démonstration ultime du chevalier : toute substance est dotée d’existence, et toute substance immatérielle constitue un être indépendant, c’est-à-dire un être qui ne nécessite pas de corps pour exister2 . La quantité, si centrale dans la compréhension du monde physique et à la détermination de ses mouvements et forces, n’a aucune pertinence dans le monde spirituel, bien que Digby aborde parfois la question de l’âme par l’alchimie. La séparation a une raison biblique : l’homme est certes tributaire des lois de la nature, mais il les surpasse dans la mesure où il est appelé à dominer la nature par son action et l’œuvre de ses mains3 . De même, l’âme, soumise par la double identité de l’homme aux lois de la nature, doit pouvoir transcender celles-ci pour mieux les comprendre – et s’en libérer au jour de la mort. Cette fonction invite Digby à envisager la question de la spécificité de l’homme – et de son âme – du point de vue de sa mise en action et de la volonté à laquelle il peut soumettre son entourage.
Définition et composition de l’âme
Éternelle, immortelle et tendant à l’infini : l’âme vue par Digby semble, au premier abord, incarner un idéal classique de stabilité et d’unité que le monde physique n’est pas capable de fournir. Nous allons voir son rôle par rapport au corps puis détailler sa composition pour tenter d’établir que Digby situe la double nature de l’homme dans une perspective baroque de tension et de contradiction.
L’âme comme forme informante
L’âme recouvre une réalité multiple et complexe que Digby s’efforce de découvrir au fil de sa vie. La plupart des écrits de Digby traitent d’une façon ou d’une autre de l’âme, depuis son premier opuscule qui analyse la dialectique entre corps et âme dans quelques vers de Spencer4 jusqu’à Deux traités. Ces deux ouvrages, publiés en même temps, bien que rédigés à une vingtaine d’années d’écart, ont en commun d’examiner l’âme du point de vue de son opposition avec sa contrepartie corporelle. À la base de sa pensée se trouve une ferme division entre corps et âme, entre matériel et spirituel. L’approche est parfois plus théologique ; ainsi, dans ses méditations de retraite éditées en annexe, Digby définit l’âme non par ses opérations innées, mais plutôt par ses actions de comprendre et d’aimer : L’ame estant une substance spirituelle est toujours en action : ses operations sont entendre et aymer ; lesquelles sans intermission elle exerce ; elle ne peut estre en repos ; comme les choses materielles qui ne subsistent que par les vicissitudes de mouvement et de quietude1 . L’âme « à une subsistence et activité au dela de la capacité de la matiere. Elle entendt, elle veut, elle ayme ; et après tout, fait des reflections sur ses propres operations2 ». Distincte de la matière, elle a la propriété d’être réflexive, et ainsi elle est comparable à ce qu’on appellerait aujourd’hui la conscience. L’âme, loin d’être un rempart au chaos du monde, lui fournit un équivalent spirituel, en étant sans cesse en mouvement et en se définissant comme une activité permanente. Peut-être faut-il voir là un écho au scolastique Dietrich de Freiberg qui redéfinit l’intellect agent d’Aristote comme une substance dynamique, c’est-à-dire « une substance qui est substance en tant qu’elle agit ou opère, une substance qui a pour objet son activité – une opération qui est donc ellemême identique à la pensée en tant que substance3 ». En considérant l’âme dans son mouvement, dans son devenir et dans son activité plutôt que par sa définition statique et descriptive, la vision simpliste qui oppose un monde physique, composé de division permanente et de chaos, à un monde spirituel unifié et stable se fissure et laisse entrevoir que ce dernier est lui aussi animé d’une agitation constante. Le rapport de l’âme au monde peut expliquer cet effet de miroir entre chaos physique et mouvement de l’esprit. De fait, l’âme comprend toutes les vérités en soi, mais elles ne sont pas toutes disponibles à l’entendement.
Les trois degrés de l’âme
L’un des attributs essentiels de l’immortalité de l’âme se situe dans son indivisibilité, puisque, a contrario, ce qui comprend des parties est susceptible de mouvement, et se révèle donc mortel1 . Or, l’âme est traditionnellement perçue comme composée de parties – par exemple, l’anatomie de l’âme est un passage obligé des manuels de spiritualité qui visent la réforme intérieure . La nature exacte de ces parties varie suivant les auteurs et les influences qu’ils subissent. Descartes, quelques années plus tard, marque une rupture anthropologique importante lorsqu’il conçoit l’âme non plus comme la forme de l’âme, mais en union avec le corps, et qu’il affirme « [qu’]il n’y a en nous qu’une seule âme, et [que] cette âme n’a en soi aucune diversité de parties3 ». Digby ne souscrit pas à la même réflexion que Descartes – qui, rappelons-le, ne sera publiée qu’en 1649, soit cinq ans après Deux traités – mais il entretient le même genre de questionnement sur le rôle de l’âme par rapport au corps et sur la composition de cette dernière. Digby contourne la difficulté en parlant de « degrés » de l’âme pour rendre compte des différents niveaux que comprend l’âme, sans la décomposer en parties4 . De fait, il faut comprendre le terme « degré » au sens anglais comme synonyme d’escalier, présentant des échelons entre les mondes matériel et spirituel. Le terme a aussi des échos chez les mystiques espagnols qui peuplaient la bibliothèque de Digby5 . Une incertitude plane sur la pensée du chevalier, dans la mesure où il semble parfois confondre ces degrés avec des facultés – on peut attribuer ce flou à l’importance considérable que prend l’acquisition de la connaissance dans sa pensée, ce qui fait que sa pensée épistémologique est indissociable de sa conception de l’âme1 . Loin d’être un fallacieux détour pour ne pas parler de parties, la notion de gradation permet de tenir ensemble, d’une part, le fait que l’âme est susceptible de fonctions diverses au plus haut point et, d’autre part, qu’elle forme une unité parfaite. Digby insiste, lors de sa description de l’âme désincarnée, sur le fait que celle-ci ne peut souffrir aucun ajout, accident ou excroissance, ce qui fait écho à sa conception de la connaissance comme transformation de la substance de l’âme et non comme accroissement de celle-ci2 . L’âme indivisible, et donc immortelle, peut souffrir des degrés qui ne sont pas des parties, mais des distinctions qualitatives, liées à ses activités. Cette précision, je tenterai de le montrer au sujet de la résurrection, permet à l’âme de préserver son unité lors de sa séparation d’avec le corps. Pour expliquer les activités de l’âme, le chevalier recourt, comme bon nombre de théoriciens avant lui, à une analyse tripartite de l’âme3 . Chaque degré correspond à un état de l’âme plus ou moins désirable, mais que chaque personne connaît en elle-même. L’âme, rappelons-le, est composée de trois degrés : les affections sensuelles (la fantaisie), les facultés rationnelles (la partie rationnelle) et l’intellect4 . À chacun correspond un moyen distinct de connaissance déjà esquissé. Cette fois-ci, nous nous intéressons non à la dimension épistémologique de chaque degré, mais à la spirituelle. Au niveau inférieur, les espèces corporelles produisent des impressions sur la fantaisie qui relie l’homme au monde sensible ; cette partie basse gouverne les gens qui emploient leur raison au service de leurs appétits. Chez la plupart des hommes, l’activité la plus intense concerne ces facultés subalternes – directement liées au monde sensible. Pires que les bêtes, les sujets emploient alors leur raison au profit des objets corporels et des appétits, tandis que le règne animal ne procède que par pur instinct. Le chemin spirituel qui s’impose pour de telles gens passe par la mortification systématique et l’extirpation des vices, accompagné de saines lectures et de solitude.