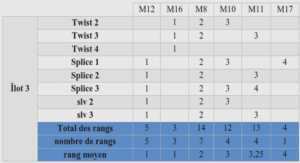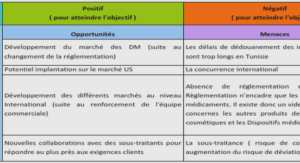Le verbe découvrir contient plusieurs significations. La découverte est d’abord une expérimentation, une recherche de choses nouvelles. Parfois la découverte est aussi une aventure : entre perte, difficultés, efforts et victoires. Lorsque le verbe est précédé du pronom réfléchi, il prend d’autres sens. Se découvrir, c’est d’abord enlever des couches de vêtements en allant parfois jusqu’à la mise à nu qui expose le corps et le rend vulnérable au regard des autres. Se découvrir, c’est donc aussi montrer sa vulnérabilité. Mais c’est en même temps se rendre visible dans l’espace alors qu’on ne l’était pas avant. C’est quelque part pratiquer le coming out, assumer sa différence, sa déviance à la norme, sa vulnérabilité pour mieux pouvoir se recouvrir d’une fierté reconstruite et réappropriée. C’est aussi d’une certaine manière se découvrir soi. À l’image des couches de vêtements qu’on peut empiler ou retirer à l’envi, se découvrir revient à étudier le palimpseste des identifications qui nous constituent. Au moment de la rédaction de ma thèse, je dois me rendre à l’évidence que c’est bien, au moins inconsciemment, cette volonté de me découvrir qui m’a mené.e à ma recherche.
A mesure que j’expérimentais et analysais les lieux et milieux queers, je découvrais comment les lieux mais aussi les milieux et les théories queers résonnaient à travers moi. Dans un mouvement contraire, plus ces théories résonnaient en moi, plus je revêtais des habits queers (au sens propre comme au figuré), plus mon corps apparaissait dans l’espace public et dans l’espace académique. À la fin de ma thèse, j’ai décidé de me mettre à nu dans l’espace académique en assumant à la fois mon positionnement de chercheur.e queer c’est-à-dire de changer mon prénom dans mes dernières publications, en acceptant d’apparaître en public ouvertement comme une personne queer et en affirmant mon engagement féministe dans ma recherche et dans le cadre de mes enseignements. Pour ces raisons, j’ai décidé de restituer mon cheminement dans un récit auto-ethnographique en reconstituant mon parcours et en mettant en avant les ruptures et changements de cap de ma recherche.
L’auto-ethnographie est une pratique parfois décriée dans le milieu académique comme le montrent Adams et Holman-Jones, tout comme peuvent l’être les théories queers. J’ai choisi, comme ces auteurs, de donner de l’importance à mon récit auto-ethnographique. Mes déplacements théoriques à la fois dans le choix des chercheur.e.s sur lesquel.le.s je me suis appuyé.e mais aussi dans le choix de mes terrains de recherche, ont été décisifs dans ma manière de penser et d’élaborer ma problématique et de définir les concepts-clés que j’utilise dans cette thèse.
La réflexivité, si elle n’est pas encore appliquée dans toutes les recherches en géographie, tend à devenir une norme académique des recherches en sciences sociales. Elle ne consiste pas seulement à parler de soi mais à mettre en relation son récit de soi et comment celui-ci peut influencer la recherche menée. Réfléchir ainsi à sa manière de faire de la recherche permet de mettre en évidence les biais de l’étude tout en en renforçant ses points forts. On peut être réflexif de plusieurs manières. La manière la plus répandue est de produire son propre récit sur sa perception de sa propre recherche. Ce récit est cependant limité par la perspective téléologique qu’on lui donne le plus souvent en reconstruisant a posteriori son parcours et en lui donnant un sens. La réflexivité peut aussi être travaillée en groupe, comme le font les chercheur.e.s Adams et Holman Jones (2008) en décidant d’écrire collectivement sur la méthode auto-ethnographique soit dans le cadre de leur terrain, soit dans le cadre de groupes de recherches et d’entraide parmi les doctorants et jeunes chercheur.e.s. J’ai personnellement utilisé ces deux outils. J’ai voulu prendre en compte l’avis des enquêté.e.s sur ma recherche. En effet, la perspective d’être une chercheur.e enfermé.e dans sa tour d’ivoire, comme en parlait Pierre Bourdieu, ne m’intéressait pas. J’ai, de plus, eu la chance d’étudier certains groupes qui réfléchissaient aux conséquences de leurs pratiques et mettaient en place des outils réflexifs. Ainsi, j’ai écouté les jugements des enquêté.e.s sur ma manière de faire de la recherche et, à partir des commentaires que j’ai jugés recevables, j’ai corrigé certains « défauts » dans ma manière de faire du terrain, et j’ai parfois, au contraire affirmé et confirmé mes méthodes et discours premiers. Parallèlement à ma pratique de terrain, les séminaires organisés par Marianne Blidon m’ont permis de partager avec les autres doctorant.e.s et jeunes chercheur.e.s mes doutes sur ma manière de faire de la recherche, sur la façon dont je devais me dévoiler en rédigeant cette thèse et jusqu’où je voulais le faire. Le paragraphe suivant reprend ces différentes réflexions menées tout au long de ma thèse et réécrit un discours, sans doute téléologique et performatif, mais qui prend sens dans la démonstration de mon passage d’Outsider (Becker 1985) à Insider dans les milieux queers.
Paris : l’épreuve du passage de l’autre à soi
Comme je l’ai rapidement expliqué, j’ai eu lors de ma première année une grosse appréhension de mon terrain parisien. J’ai eu peur de passer pour un.e imposteur.e, peur de ne pas en savoir assez. J’ai donc attendu d’être allée à Montréal pour vraiment commencer mon terrain à Paris. C’est par l’intermédiaire d’ami.e.s mais aussi grâce à mes recherches que j’ai réussi à accéder aux soirées queers parisiennes. Petit à petit, j’ai remarqué qu’il existait plusieurs types d’événements ciblant différents types de publics. Certaines soirées étaient très festives, centrées autour de la transgression des normes de genre et de sexualités, mettant en avant des performances burlesques ou sexy : c’était notamment le cas des soirées organisées par Louis(e) de Ville (Moral Panic, Pretty Propaganda) ou à la Java (Flash Cocotte puis Trou aux biches)… D’autres soirées semblaient plus militantes : la soirée Disco-OestroTesto notamment, organisée par l’association OUTrans, défendant les droits des personnes trans. Ces dernières soirées n’étaient pas identifiées comme queers mais plutôt comme transpédégouines. Ce mot queer était plutôt dévalorisé à Paris dans les milieux militants et renvoyait à son aspect festif ou académique. Dans les deux cas, il semblait très éloigné des réalités que vivaient les personnes transpédégouines au quotidien.
A la fin de ma deuxième année de thèse, en rentrant de Montréal, j’ai découvert la Mutinerie, « un lieu féministe et ouvert à tou-TE-s, par et pour les Meufs, Gouines, Trans’, Queers » . Ce bar avait ouvert pendant l’été. J’ai mesuré au fur et à mesure l’importance de ce nouveau lieu quand j’ai vu le calendrier des événements se remplir. Non seulement, de plus en plus de soirées et d’événements, de rassemblements politiques semblaient se concentrer dans ce lieu mais j’y ai aussi découvert le déroulement et la pratique des ateliers et des groupes de paroles… J’ai alors commencé à réfléchir au concept de safe space qui allait devenir une articulation majeure de ma thèse.
De plus, après m’être investie dans l’association PolitiQ à Montréal, j’ai voulu en rentrant en France trouver un endroit où militer. Le contexte homophobe concomitant au débat sur le Mariage pour tous a facilité cette introduction et m’a permis de continuer à bâtir une approche critique à la fois de l’hétéronormativité de la société mais aussi des homonormativités gay et lesbienne. C’est aussi à ce moment-là que j’ai commencé à questionner la consubstantialité et la coextensivité des rapports sociaux (Kergoat 2010).
INTRODUCTION |