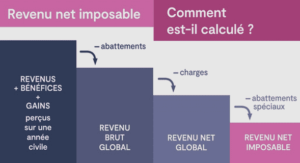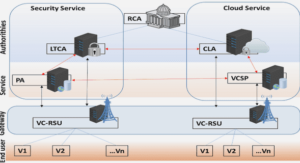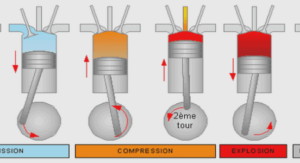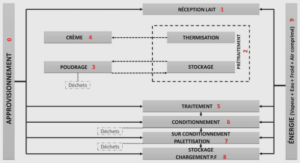La notion d’autonomie est un concept loin d’être facile à cerner et à caractériser. De nombreux courants disciplinaires tant philosophiques que scientifiques ont cherché à la circonscrire. La capacité décisionnelle dont se doivent d’être dotés les systèmes autonomes en est sans nul doute le marqueur central. L’autonomie se déploie au sein d’un environnement avec pour objectif la réalisation d’actions jugées contextuellement, localement et globalement pertinentes dans le temps et dans l’espace, par le système. La réalisation d’une action implique une dimension physique (manière d’agir sur quelque chose ou quelqu’un ) qui suppose que le système est capable de se positionner au sein de l’environnement dans lequel il évolue. La localisation joue donc un rôle central pour le déploiement de l’autonomie.
La capacité de localisation parait naturelle aux êtres humains. Nos cinq sens nous renvoient des informations allothétiques (extéroceptives) sur notre environnement que notre cerveau traite en permanence pour nous permettre de nous mouvoir et d’interagir avec les objets ou personnes qui nous entourent. Même si la vision reste la modalité dominante, il ne faut pas minorer l’importance du rôle des informations idiothétiques (intéroceptives) avec la proprioception qui permet de localiser la position et l’orientation des différentes parties de notre corps dans l’espace, et le système vestibulaire qui nous renseigne sur nos mouvements (accélération) [40]. Si l’on y regarde de plus près, un individu construit une carte cognitive de son environnement qui correspond à la représentation interne qu’il se fait de son organisation, et qui évolue en fonction de notre expérience. Ces cartes mentales nous permettent à tout instant (dynamiquement) de connaitre notre localisation et de planifier nos actions [92]. Notre représentation de l’espace fait appel à plusieurs référentiels en fonction du point de vue retenu [142] : Allocentrique (centré sur l’environnement), et égocentrique (centré sur notre corps). Ce dernier se décompose lui même en fonction de la perception qu’a l’individu des mouvements à mettre en œuvre [96]. On distingue l’espace de saisie (préhension directe), du champ proche (utilisation d’un outil) et de l’espace lointain (locomotion nécessaire). Nous construisions ou nous disposons donc d’une représentation mentale des lieux dans lesquels nous évoluons et en fonction du contexte de nos actions nous recherchons une localisation plus ou moins précise. Nous sommes aussi capables de nous déplacer à l’estime dans le noir sur de courtes distances dans des lieux que nous connaissons, seulement à l’aide de notre perception proprioceptive, grâce à notre mémoire locomotrice. Cependant, même lorsque notre vision peut être employée, en l’absence d’éléments discriminants auxquels nous raccrocher, nous sommes perdus, incapables de nous localiser. En effet pour planifier nos actions nous avons besoin de nous appuyer sur une organisation hiérarchisée de connaissances spatiales de type repères, routes (liaisons entre repères) et survol (carte mentale de l’environnement vue de dessus) [216].
Il existe évidemment de nombreuses analogies entre les entités biologiques que nous sommes et les systèmes autonomes tels que les robots mobiles qui nous intéresseront dans le cadre de ce manuscrit. Pour eux aussi la capacité de localisation est un marqueur incontournable de l’autonomie. C’est un domaine de la robotique des plus prolifiques pour lequel de très nombreuses approches permettant au robot de se repérer dans son environnement ont été proposées. Les robots sont dotés de capteurs lui permettant d’appréhender, tout comme nos sens, l’environnement dans lequel il évolue, ainsi que son propre mouvement. Cet aspect matériel est l’une des rares dimensions du problème de localisation pour lequel les systèmes artificiels peuvent se révéler très supérieurs aux êtres humains. En effet nos organes sensoriels possèdent des limites de fonctionnement et de sensibilité qui peuvent être largement dépassées par les capteurs. C’est ensuite que la machine va se révéler moins performante. Il va falloir fusionner la grande quantité d’informations recueillies, plus ou moins bruitées, et être capable d’interpréter ces données à sémantique faible pour conclure quand à la localisation du robot au sein de son environnement. La mémorisation et/ou la construction de la représentation de ce dernier, même si plusieurs niveaux de granularité ont été proposés, demeure encore très élémentaire par rapport aux informations cognitives très variées que les êtres humains sont capables d’intégrer pour se localiser. Enfin le traitement de cette masse de données peut aussi induire un coût de calcul important parfois incompatible avec une utilisation réellement opérationnelle et continue d’une technique de localisation. Malgré tout, on peut sans doute considérer qu’actuellement on dispose en robotique d’un très large panel de méthodes de localisation aux performances et limitations assez largement éprouvées.
La performance d’une méthode de localisation est bien évidemment directement reliée à la précision avec laquelle le robot est capable de se localiser. Celle-ci dépend clairement de la fiabilité des informations capteurs recueillies, et donc souvent du coût de ces derniers, mais aussi de leur adéquation à l’environnement. Le choix de la méthode de localisation retenue et des principes théoriques sous jacents influent aussi significativement sur la qualité de la localisation. La nature intrinsèque d’une méthode la rend plus ou moins performante en fonction des capteurs mobilisés, des ressources de calcul nécessaires et disponibles, des limites de principe associées (grille), et de l’environnement traversé. Il existe donc une adéquation méthode/environnement. Dans les articles scientifiques, cette précision est le plus souvent évaluée de façon factuelle, a posteriori, dans un environnement donné. Cependant, comme nous le verrons dans la suite de ce document, les conditions d’obtention de la réalité terrain ne sont pas toujours clairement explicitées, et il faut bien distinguer si l’on s’intéresse à un positionnement relatif par rapport à un objet, ou, plus généralement, à un repérage global au sein d’une carte. Quoiqu’il en soit, en raison du lien précision/action, il est indispensable de pouvoir garantir que le système robotique est réellement localisé en deçà d’une marge d’erreur acceptable pour pouvoir engager l’action envisagée. Certes, il existe des méthodes dites ensemblistes ou intervallistes permettant de vérifier si les contraintes de localisation visées le sont effectivement. Mais, à notre connaissance, ces travaux ne procurent, là encore, dans leur très large majorité, qu’une évaluation à posteriori de l’espace au sein duquel se trouve avec certitude le robot, sans pour autant pouvoir assurer, à priori, que ces dimensions vérifient les contraintes de localisation imposées.
Mais évidemment une mission robotique autonome ne peut se restreindre à la seule dimension de la Localisation. On doit entre-autres être capable de prendre en compte l’aspect sécuritaire et énergétique, sans oublier des points de vue plus utilisateur tels que la durée de la mission. Toutes ces dimensions sont corrélées et le choix de certaines méthodes de localisation impactera nécessairement les autres dimensions de la performance notamment l’énergie. L’équipe Explore au sein de laquelle ont été déployés les travaux présentés dans ce manuscrit a développé une méthodologie dénommée PANORAMA qui cherche à planifier l’utilisation et le paramétrage des ressources matérielles et logicielles d’un robot mobile autonome de façon à garantir la satisfaction des contraintes de performance imposées, tout au long d’une mission s’exécutant dans un environnement connu. Elle s’appuie sur la mise en place de modèles de performance prédictifs et sur le suivi en ligne de l’évolution des marges de performance estimées. Cependant les premiers travaux présentés dans [112], bien que prenant en compte les dimensions sécuritaire, énergétique et durée d’une mission, n’appréhendaient la dimension localisation que de façon arbitraire et heuristique en postulant que les méthodes sélectionnables contextuellement permettaient effectivement de satisfaire les contraintes de localisation imposées.
La notion d’autonomie est apparue dans l’antiquité pour désigner des citoyens qui édictaient leurs propres (autos) lois (namos). Depuis le champ lexical de ce terme s’est étendu pour être utilisé dans des disciplines très variées telles que la philosophie, la psychologie ou la robotique et donc pour être appliqué à des systèmes tant biologiques qu’artificiels.
L’approche philosophique Kantienne [124] considère que l’autonomie se décline au travers des notions d’action morale et de libre arbitre. En d’autres termes l’autonomie consiste à vouloir la loi et à s’y soumettre. Si maintenant on s’intéresse à sa vision en psychologie comportementaliste, Skinner dans [208] avance que l’autonomie et le libre arbitre ne sont qu’une illusion car c’est l’environnement qui détermine le comportement. Plus récemment Bouvet dans [38] pointe l’ambiguïté de définition de l’autonomie et lui préfère le terme anglo-saxon d’empowerment c’est à dire du pouvoir d’agir. Ces définitions non consensuelles, qui font référence au système biologique intelligent qu’est l’Homme, mettent donc en avant les notions de libre arbitre, de capacité d’action et l’importance que peut avoir l’environnement. Venons en maintenant au domaine des systèmes artificiels et plus particulièrement de la robotique où le concept d’autonomie a été et sera de plus en plus étudié. La table 2.1 tirée de [230] et enrichie, en propose un ensemble de définitions. Même si elles ne relèvent pas du même niveau de granularité, elles mettent en avant que le concept d’autonomie est lié :
• À l’absence de supervision humaine [27] [58] [230].
• À la capacité qu’a le système à exécuter les actions demandées [230] [11].
• À la poursuite d’un objectif [11] [169].
• À la capacité d’adaptation du système au contexte interne [169] et externe d’exécution des actions.
L’absence de supervision et la capacité à exécuter les actions demandées semblent être deux dimensions évidentes pour un système autonome. Certains chercheurs tel que [68] vont encore plus loin en avançant qu’un système ne peut être réellement autonome que s’il est capable de se construire par lui-même. Sinon, il ne peut utiliser que les lois mises en place lors de sa conception ce qui limite sa capacité d’action et d’adaptation. Ce point de vue est d’une certaine façon corroboré par le principe de rationalité limité de Simon [207] qui énonce que les actions d’un système sont nécessairement contraintes par ses capacités de calcul et par les informations et algorithmes dont-il dispose. Ce point de vue pourrait être cependant plus nuancé dans les prochaines années avec l’avènement des techniques récentes d’apprentissage de l’intelligence artificielle telles que le deep-learning [94].
1 INTRODUCTION GÉNÉRALE |