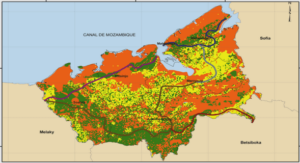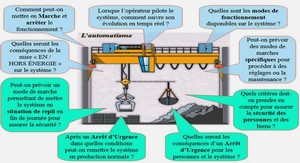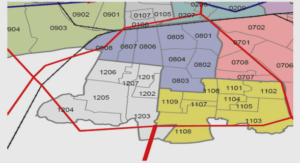PARTICULARITÉS DU SYSTÈME D’ARBITRAGE D’INVESTISSEMENT INTERNATIONAL
LA NOTION D’INVESTISSEMENT
Avant de s’atteler à l’analyse des différents textes internationaux relatifs aux investissements et aux mécanismes de règlement des différends qu’ils prévoient, il convient de définir la notion d’investissement elle-même. Il n’existe pas de définition générale de l’investissement au niveau international . Ceci peut notamment s’expliquer par le fait que la notion d’investissement est destinée à embrasser une réalité économique de par sa nature en constante évolution, générant sans cesse de nouvelles pratiques qui pourraient potentiellement être qualifiées comme telles. Cette tendance ne fait d’ailleurs que s’accélérer avec l’explosion des nouvelles technologies. Une définition trop rigide de l’investissement ne serait tout simplement pas du tout adaptée. Il n’est dès lors pas étonnant que la Convention de Washington pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats (ci-après désignée Convention CIRDI) ne prévoie aucune définition de son objet . Elle se limite à indiquer en son article 25 : « (1) La compétence du Centre s’étend aux différends d’ordre juridique entre un Etat contractant (ou une collectivité publique ou tel organisme dépendant de lui qu’il désigne au Centre) et le ressortissant d’un autre Etat contractant qui sont en relation directe avec un investissement et que les parties ont consenti par écrit à soumettre au Centre. Lorsque les parties ont donné leur consentement, aucune d’elles ne peut le retirer unilatéralement. » Il n’y a pas de problème si l’Etat et la partie privée ont conclu une convention d’arbitrage. En effet, les parties se sont alors mises d’accord sur le fait que leur litige était relatif à un investissement, et les arbitres qui seront saisis n’auront pas à se poser la question de leur compétence ratione materiae. Cette solution était d’ailleurs celle envisagée par les rédacteurs de la Convention CIRDI. Est donc un investissement ce que l’Etat a consenti à qualifier comme tel . Cependant, la question a retrouvé une incidence pratique indéniable avec le développement des traités bilatéraux d’investissement, au détriment des contrats. En effet, comme nous le verrons infra, ceux-ci se caractérisent par le fait que l’Etat d’accueil de l’investissement donne son consentement à l’arbitrage de façon différée. Pour déterminer si un litige concerne un investissement, il faut dès lors regarder la définition de l’investissement telle que donnée par le traité. On peut d’ailleurs observer une grande diversité dans les approches adoptées, certains traités restants muets sur la définition de l’investissement, d’autres ayant une acception plus ou moins stricte du concept.
Au vu des éléments qui précèdent, on ne peut approcher la notion d’investissement qu’en la brossant à gros traits, en identifiant les traits généraux qui se dégagent de la pratique arbitrale. Comme cela n’est pas directement l’objet de notre étude, et qu’une analyse détaillée demanderait à elle seule un travail complet, nous nous bornerons ici à isoler une définition « de travail ». Qu’on se le dise de toute façon : il n’existe en la matière aucune solution définitive et d’application générale. Confrontés à des Etats et des particuliers en conflit sur la question même de savoir si leur litige pouvait être qualifié d’investissement au sens du BIT, les arbitres ont essayé de fournir un vision objective de la notion d’investissement, qui ne dépendrait plus de la vision des parties . Les premières tentatives en la matière furent fortement marquées par l’empirisme, les tribunaux arbitraux identifiant des éléments de fait in casu, qui sont en général rattachés à la notion d’investissement, mais en prenant soin de ne pas les présenter comme des critères généraux d’identification des investissements applicables de façon généralisée . Un progrès des plus significatifs fut réalisé dans le cadre de la sentence Salini c. Maroc . Cette sentence propose quatre critères. Le premier critère est celui de l’apport financier. Pour que l’opération puisse être qualifiée d’investissement, le ressortissant de l’autre Etat contractant du BIT doit avoir injecté une certaine somme d’argent dans l’économie de l’Etat d’accueil. Le second critère est celui de la durée. L’investissement se caractérise par une certaine permanence sur le territoire de l’Etat d’accueil. L’idée est ici de ne pas confondre de réelles opérations d’investissements avec des interventions tout à fait ponctuelles et de courte durée. Ce critère a été apprécié de façon très diverse en fonction des tribunaux arbitraux, et les exigences en matière de durée minimale de l’investissement ne sont pas uniformisées. Le troisième critère est celui du risque. On veut entendre ici le risque inhérent au développement d’une activité économique sur le territoire de l’Etat d’accueil, à savoir le fait que celle-ci périclite et que l’on ne tire pas les bénéfices escomptés. Ce critère permet notamment d’exclure de la notion d’investissement l’épargne qu’un particulier pourrait détenir auprès d’une banque et qui serait située à l’étranger.
Enfin, la sentence Salini se singularise par l’ajout d’un quatrième critère, par ailleurs très controversé, qui est celui de la participation au développement économique de l’Etat d’accueil. Les critères Salini ne sont pas appliqués de façon uniforme en pratique. Certains arbitres n’y voient que des lignes de conduite très générales qui ne les oblige en rien et qui ne doit surtout pas entraver un examen au cas par cas des situations qui se présentent , d’autres au contraire les considèrent comme contraignants et les appliquent de manière cumulative . Il y a des arguments en faveur de chacune des deux approches. La première correspond davantage à une vision traditionnelle de l’arbitrage, où il n’y a pas à proprement parler de jurisprudence, et où chaque nouveau litige entraîne une nouvelle réflexion. Elle permet une plus grande souplesse en adéquation avec une notion aussi évolutive que n’est celle de l’investissement. A l’inverse, la seconde vision des critères Salini offre davantage de sécurité juridique. Il est d’ailleurs intéressant de constater que cette logique s’éloigne en cela sensiblement de l’arbitrage traditionnel (notamment l’arbitrage commercial international) , pour se rapprocher de la logique d’un juge. Malgré ce manque d’uniformité dans leur application et les controverses qu’ils suscitent, les critères Salini présentent un caractère suffisamment clair et concret pour que nous puissions les retenir comme définition de travail pour les réflexions qui vont suivre.
HISTORIQUE DU REGLEMENT DES DIFFERENTS EN MATIERE D’INVESTISSEMENT
LA SITUTION ANTERIEURE A L’APPARITION DES BIT
Le droit international se préoccupe de la question de la protection des investissements réalisés par des étrangers sur le territoire d’un Etat depuis des temps immémoriaux. Une des caractéristiques saillantes de cette matière est la méfiance naturelle que l’investisseur étranger éprouve vis-à-vis des institutions de l’Etat d’accueil, notamment vis-à-vis de ses juridictions, dont la neutralité et l’indépendance pourraient être remises en cause. Au fil du temps se sont apparus divers moyens de régler le contentieux international relatif à l’investissement. Il faut souligner à titre liminaire que l’apparition d’un nouveau mécanisme de règlement des différends ne rend aucunement ceux apparus précédemment obsolètes, et que la présentation chronologique des différentes méthodes qui va suivre ne doit donc aucunement induire en erreur sur ce point. Le droit international des investissements a tout d’abord été régi par des règles d’origine essentiellement coutumière. S’y appliquait le principe bien établi que le droit international public est un droit applicable aux Etats, par les Etats, pour les Etats et que les particuliers ( en ce compris les investisseurs) ne pouvaient aucunement s’en prévaloir. En cas de violation par un Etat de ses obligations internationales vis-à-vis de lui, l’investisseur n’avait d’autre choix que de s’en remettre à son gouvernement. Au 19ème siècle, l’intervention du gouvernement de l’Etat d’origine de l’investisseur se traduisait souvent par l’envoi d’une flottille devant les ports de l’Etat d’accueil pour une démonstration de force (stratégie abondamment utilisée par les puissances européennes). Cette « diplomatie de la canonnière »prit fin avec la conclusion de la Convention de la Haye sur la Résolution pacifique des Différends Internationaux en 1907 .
Une autre modalité d’intervention de l’Etat d’origine qui s’est quant à elle maintenue jusqu’à nos jours est le mécanisme de la protection diplomatique, devenu traditionnel en droit international public. L’Etat prend ainsi « fait et cause pour son ressortissant » mais de la sorte il ne défend pas en réalité les droits et intérêts de celui-ci, mais les siens propres. Il a en effet « le droit d’assurer vis-à-vis de la personne de ses nationaux le respect des normes du droit international » et d’obtenir une indemnité dans le cas contraire . La procédure ne répond pas efficacement aux attentes de l’investisseur. En effet, rien n’oblige l’Etat d’origine à mettre en branle le mécanisme en question, qui relève d’une compétence discrétionnaire . De plus, il ne peut exercer sa protection diplomatique que si l’investisseur est un de ses ressortissants. Ce principe exclut par exemple l’idée d’une intervention de l’Etat de la nationalité des actionnaires si la société qui a réalisé l’investissement ne partage pas cette nationalité . Ensuite, l’investisseur doit non seulement avoir épuisé toutes les voies de recours internes mais aussi ne rien avoir à se reprocher par rapport à ce qui lui arrive (théorie dite des « mains propres ») . Enfin, si l’Etat d’origine devait exercer sa protection diplomatique et se voyait donner raison, l’indemnisation lui serait destinée, et rien ne lui imposerait de la rétrocéder à l’investisseur malheureux. Du fait de ces inconvénients, si le recours à la protection diplomatique n’a pas totalement disparu de la pratique en droit international des investissements, il est devenu quasiment anecdotique .
Sont alors apparues les commissions mixtes, institutions établies entre deux états dans un souci d’économie, afin de traité des cas semblables plutôt que de recourir de façon séparée à la protection diplomatique pour chaque cas. Chaque Etat désignait la moitié des commissaires, auxquels la pratique a vu s’ajouter l’ajout d’un tiers d’une nationalité autre que celle des Etats en litige, le « surarbitre ». Il convient de considérer ce mécanisme comme un raffinement et une rationalisation de celui la protection diplomatique. Les commissions n’étaient pas là pour trancher les litiges qui leurs étaient soumis, se contentant de dégager des pistes de résolution, la décision finale revenant aux Etats .
Introduction |