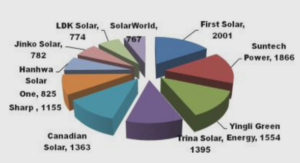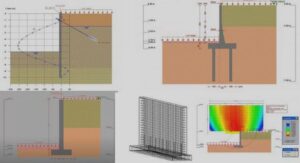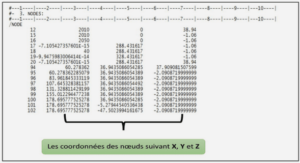Aux origines de la finance solidaire : de l’associationnisme ouvrier jusqu’aux banques coopératives
La finance solidaire n’est pas un champ nouveau et même si ce secteur n’était pas formalisé comme tel, de nombreuses pratiques de finance solidaire ont eu cours tout au long de l’histoire. Il est difficile de s’accorder sur une définition de la finance solidaire tant ce secteur est hétérogène et renvoie à de multiples réalités. Dans le cadre d’une approche historique de la finance solidaire, il nous apparaît pertinent de mobiliser les travaux d’Amélie Artis (2013) – une chercheuse ayant longuement travailler sur l’histoire de ce champ – pour le définir :
« La finance solidaire se caractérise par un système de relations sociales de financement qui associe des relations monétaires et du lien social dans un ensemble cohérent (Artis, 2012). À la différence d’une relation de financement classique, elle n’est pas une simple relation d’échange marchand anonyme. Elle s’inscrit dans un paradigme différent de la logique capitaliste selon lequel la recherche de profit n’est pas la finalité de l’activité et les valeurs de réciprocité et de solidarité sont au centre des relations entre les prêteurs et les emprunteurs. Elle finance des projets économiques viables subissant une contrainte de financement en raison de leurs spécificités (mode de gouvernance, propriété du capital, règles de redistribution des gains) par rapport à l’idéal type de la société de capitaux. »
De nombreux auteurs se sont essayés à dessiner une fresque historique de la finance solidaire. Nous pouvons par exemple citer Amélie Artis ou encore Thibault Cuénoud (Cuénoud et Glémain, 2014) qui ont notamment tenté de saisir la particularité historique de la finance solidaire au travers des modèles socio-économiques attachés aux pratiques de finance solidaire durant les différentes périodes. Artis et Cuénoud se sont accordés sur une typologie partagée que l’on trouvera ci-après :
De 1800 à 1848 : D’une relation de crédit fondée sur des relations interpersonnelles à une relation de crédit reposant sur des liens communautaires
La plupart des auteurs marquent le début de la finance solidaire au début du XIXème siècle, à une période ou le système financier se structure et accompagne le développement industriel des pays européens. La demande de monnaie se fait de plus en plus importante du fait de modes de production de plus en plus capitalistiques. Les pratiques de crédit mobilisant les réseaux sociaux proches deviennent insuffisantes pour subvenir à la demande de monnaie et au développement de certaines activités (Artis, 2008). L’accès au crédit est à cette époque très limité et conditionné par une épargne monétaire et des moyens matériels conséquents (Bachet, 2012). Les premiers prêteurs de l’époque sont craintifs et souffrent d’un déficit de confiance vis-à-vis de ces populations qu’ils méconnaissent. La décision de prêter se fait donc à l’aune des richesses matérielles possédées par l’emprunteur et non sur le projet que ce dernier compte développer. De fait, seules les classes les plus aisées et notamment les propriétaires industriels investissant dans les moyens de production accèdent au crédit alors que les petits commerçants ou artisans ne disposant pas de ces garanties ne peuvent y prétendre. Les franges de la population les moins dotées financièrement sont donc exclues de ces relations de crédit malgré les besoins de financement qu’elles peuvent exprimer. Elles peuvent seulement gérer leur épargne via des Caisses d’Epargne car celles-ci n’octroient pas de prêts (Artis, 2013).
Des penseurs issus du socialisme utopique comme Buchez proposent un soutien étatique pour l’accès au crédit de cette classe ouvrière qui en est privée. Buchez demande à l’Etat en 1831, la création d’une « Caisse Générale du crédit public » dans le but de proposer un crédit gratuit, celle-ci s’exprimant par l’absence de taux d’intérêt sur le prêt octroyé (Artis, 2013). Louis Blanc plaide également pour un crédit public à taux nul dans l’objectif de financer la production dans les ateliers sociaux. Ces propositions resteront lettre morte auprès des pouvoirs publics et le mouvement associationniste réfléchit alors sur les moyens de favoriser l’offre de crédit à long terme et répondant à des besoins de financement spécifiques pour ses membres, en prônant notamment l’auto-organisation des entités productives collectives.
De 1848 à 1927 : D’une relation de crédit communautaire tentant de répondre à une contrainte de financement vers une relation de crédit institutionnalisée
La crise politique de 1848 est une date importante dans le développement des pratiques de finance solidaire. L’industrialisation croissante se caractérise par un progrès technique galopant, de nouveaux rapport de travail avec le recours au salariat et une augmentation de la taille des entreprises. L’intensification des modes de production capitalistes demande toujours plus de monnaie et la demande de crédit se fait de plus en plus forte (Artis, 2008). Les petits commerçants et artisans, en perte d’autonomie et faisant face à un déficit de compétitivité vis-à-vis des industries naissantes sont contraints de se regrouper pour satisfaire collectivement leurs besoins de financement.
En 1863, un projet fondateur et préfigurant les futures banques coopératives émerge: la « Société de Crédit au travail » initiée par Jean Pierre Beluze. Le prospectus de l’époque mentionnait ce nouvel organisme comme étant une « Société du Crédit solidaire » en direction des associations et destinée à « l’extinction du paupérisme et l’affranchissement de la misère pour les travailleurs et les honnêtes gens ». Cette société devait être une « Œuvre démocratique », et devait avant tout « fonctionner au bénéfice des travailleurs, des ouvriers et petits bourgeois». Comme le mentionne Chaibi (2016), l’association beluzienne « n’est pas conçue comme un instrument de lutte des classes en faveur du prolétariat, mais comme un moyen pour les ouvriers de s’affranchir du prolétariat et acquérir « l’indépendance que possède la bourgeoisie ». Le projet de la Société de Crédit au travail est alors envisagé comme un projet émancipateur permettant de rendre une certaine autonomie financière à la classe ouvrière en s’appuyant sur le collectif. La société de Crédit au travail est à la fois une « Caisse d’épargne pour le travailleur, une Société de Crédit mutuel entre ses membres et une Banque de Crédit et d’Escompte pour les Sociétés coopératives » (Chaibi, 2016). L’objectif était de «réunir les épargnes des travailleurs pour les prêter à d’autres travailleurs qui les fassent fructifier par le travail, l’économie et la prévoyance ». La volonté de Beluze pour sa « Société de Crédit au travail » est que celle-ci devienne une véritable banque pour les associations. Pour cela, un taux d’intérêt modéré est pratiqué, celui ci étant identique à celui pratiqué par la Banque de France qui finançait les grandes entreprises de l’époque. Cela permettait alors aux groupements associatifs et aux petits emprunteurs d’avoir accès au crédit. De plus, l’organisation rémunérait les dépôts à hauteur de 3%, ce qui correspondait aux taux d’intérêts rémunérateurs pratiqués par les Caisses d’Epargne classiques, mais la société offrait l’avantage de pouvoir retirer son argent plus facilement que dans les Caisses d’Epargne. La Société de Crédit au Travail a eu un succès certain, au vu du nombre de sociétaires et de l’augmentation rapide de son capital.
Introduction |