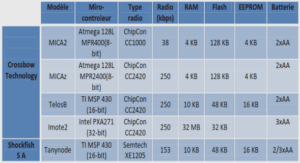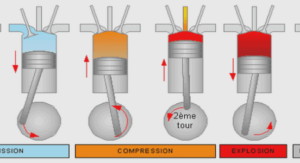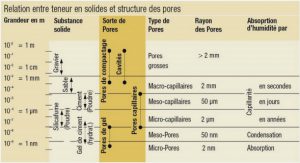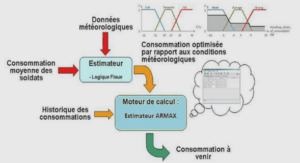Une compétence langagière qui pose problème
Les États généraux sur la situation et l’avenir de la langue française au Québec, tenus en 2001, ont été l’occasion de rappeler les faits et d’insister sur l’importance de la maîtrise de notre langue maternelle. À cet effet, un mémoire, produit par l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), rappelle la nécessité d’une maîtrise relevée de la langue pour la survie et le rayonnement du fait français au Québec en mettant l’accent sur les connaissances linguistiques comme moyen d’accès aux multiples savoirs (savoir lire, écrire, s’exprimer). Selon les auteurs de ce mémoire, l’école doit être un modèle ou un exemple de cette promotion des savoirs (2001). Ainsi, des représentants du monde universitaire reconnaissent la primauté de la langue et le rôle qu’ils ont à jouer, eux aussi, dans l’acquisition de sa maîtrise. Cette double reconnaissance légitimise en quelque sorte le choix que nous faisons de porter notre attention sur cet objet de savoir, la langue, et sur cet ordre d’enseignement, l’université. Par la suite, nous aborderons plus spécifiquement la question du français en formation des maîtres, laquelle d’ailleurs est davantage concernée par les propos de ce mémoire. Cette question portera sur l’essentiel du problème, que nous soulevons dans cette recherche, soit l’importance de clarifier et de déterminer les compétences langagières des futurs enseignants et de s’entendre sur ces compétences et sur un seuil de réussite dans une perspective de professionnalisation de l ‘ enseignement.
Outre la formation continue, étant donné que l’université est le dernier rempart qui offre aux étudiants la possibilité d’améliorer leur performance en français, nous jugeons pertinent d’examiner quelques moyens que s’est donnés cette institution pour contrer le problème de la langue, d’en montrer les résultats, de citer quelques chiffres pour finalement proposer une approche différente du problème concernant les moyens de correction et d’amélioration de cette situation.
L’histoire récente du français à l’université
C’est en 1986, année où la maîtrise du français écrit devient une préoccupation majeure dans tous les ordres d’enseignement et où efforts et recherches s’intensifient (Lépine, 1995), que la Conférence des recteurs et principaux des universités du Québec (CRÉPUQ) prend position officiellement et force les universités à adopter des mesures pour améliorer la qualité du français écrit chez les étudiants. On considère que «l’état de leurs connaissances linguistiques peut être préjudiciable à l’exercice d’une profession» (CRÉPUQ, 1986).
En 1988, les universités optent pour une politique institutionnelle qui, globalement, comprend deux volets: l’un de suppléance, qui se concrétise par des cours de récupération, et l’autre qui concerne le règlement pédagogique et exige que tous les enseignants tiennent compte de la langue dans la correction des travaux et des examens. Certains prétendent que cette politique, bien que quelques fois amendée ou modifiée, demeure plus ou moins efficace. En effet, étudiants et professeurs, conscients de la prépondérance du français, notamment en éducation mais aussi dans d’autres programmes, jugent qu’on accorde un trop faible pourcentage à la maîtrise de la langue (Bélanger et Paradis, 2000). Pour sa part, l’ancien président du Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement (CAPPE), monsieur Conrad Ouellon, affirme que si cette politique avait été réellement appliquée, certains problèmes liés à la connaissance de la langue auraient pu être évités .
Subséquemment, la création d’une telle politique (mise en place par la plupart des universités en 1990) a donné lieu à l’élaboration d’un test d’admission permettant d’orienter les étudiants vers des mesures ponctuelles et à court terme. Ce test «maison», élaboré par les universités, portait sur la connaissance du code et devenait obligatoire. Il s’est avéré, cependant, que le taux d’échecs élevé, contraire aux estimations, a remis en question sa validité (Lépine, 1995).
Pour corriger le tir, dès 1992, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science (MESS) élabore et administre un test qui, cette fois, semble s’inscrire dans la continuité des apprentissages des autres ordres d’enseignement, donc être plus près de la réalité de ces étudiants : ce type d’épreuve met l’accent davantage sur la capacité rédactionnelle et fait appel à des compétences diverses (linguistiques, discursives et informatives), qui vont au-delà de la simple connaissance du code (Lépine, 1995). Toutefois, après une analyse du protocole de correction et de la pondération, on conclut que ce test comporte des lacunes significatives et représente un défi des plus légers pour l’étudiant qui entre à l’université. De plus, il se trouve que les mesures qui suivirent ces différentes tentatives (cours de grammaire et de rédaction) ont été jugées plus ou moins adéquates, car elles ne tenaient pas compte des besoins et difficultés d’apprentissage d’une clientèle variée (Lépine, 1995).
En 1996, le ministère de l’Éducation, dans le cadre de la réforme du collégial, prend le relai de l’évaluation par la création d’une épreuve ministérielle de français qui sanctionne le diplôme de l’étudiant et fait foi de sa compétence en la matière. Les tests d’entrée sont donc abolis dans l’ensemble des universités et des programmes, sauf ceux dont les exigences linguistiques sont plus élevées. Dans ces programmes (c’est le cas en éducation), souvent les étudiants sont invités à repasser le test d’admission jusqu’à ce qu’ils le réussissent et/ou à suivre quelques cours de rattrapage. Cette situation varie d’une université à l’autre, certaines s’en remettant à la politique institutionnelle, laquelle admet des étudiants, peu importe leur programme d’ études, à partir des résultats obtenus à l’ examen du ministère.
Rappelons néanmoins que c’est avec prudence qu’il faut considérer ces résultats. Notre expérience au collégial nous permet d’affirmer que ceux-ci ne sont pas une garantie sine qua nun d’un niveau de compétence langagière suffisant pour entreprendre des études universitaires puisque nous avons été confrontés à une situation pour le moins paradoxale où des étudiants échouaient le cours de français qui les préparait à l’examen du ministère alors qu’ils réussissaient haut la main cet examen. Bien des facteurs sont à considérer dans l’interprétation des résultats obtenus d’une part comme de l’autre et dans l’explication d’une telle situation. Il n’en demeure pas moins, cependant, que les résultats de l’épreuve témoignent d’une réussite en regard d’exigences collégiales et ne devraient pas être une condition d’admission pour entrer dans un programme universitaire et encore moins lorsque les exigences en français dans ce programme sont plus élevées que dans d’autres.
En somme, l’ empressement de répondre à certaines presswns des corporations professionnelles et des employeurs, un mandat plus ou moins clair relatif aux contenus des tests (à l’origine de certaines erreurs de jugement de la part des concepteurs), des mesures se voulant transitoires, une méconnaissance de la situation linguistique (ibid.), une politique institutionnelle appliquée partiellement, l’abandon des tests d’entrée par les universités, tout ceci explique, en partie, les effets mitigés des mesures prises.
Ces facteurs ne contribuent guère à améliorer une situation déjà préoccupante, au moment où les étudiants entrent à l’université. À cet égard, certains chiffres et commentaires sont assez éloquents sur la situation qui prévalait en 1993 et qui semble se maintenir: «L’opération test d’admission menée par les universités a mis en évidence la piètre qualité de la maîtrise de la langue des futurs maîtres à l’arrivée à l’université, car plus de 40% des étudiants admis à la formation des maîtres échouent au test de français de l’université» (Gervais, 1993, p. 46) ; bien que nous ayons souligné les imperfections de ces tests, il n’en demeure pas moins qu’un taux élevé d’étudiants se présente à l’université avec des connaissances minimales en français ou peu suffisantes pour entreprendre de telles études: «Une proportion encore beaucoup trop forte d’étudiants qui se présentent à l’université ne possède pas une maîtrise adéquate de la langue» (Mémoire déposé à la Commission des états généraux sur l’éducation par la CRÉPUQ, 1995).
Cinq ans plus tard, d’autres voix se font entendre et vont dans le même sens. Un mémoire, déposé à la Commission des états généraux sur la situation et l’avenir de la langue française au Québec et présenté par un groupe d’ étudiants en Sciences de l’éducation, reconnaît que la langue est encore un problème à surmonter à l’université (anonyme, 2000).
Également, une étude réalisée en 2000, par les chargés de cours de la faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal (UDM), auprès de 1156 étudiants (112 en sciences infirmières, 897 en art et sciences et 147 en sciences de l’éducation) démontre le peu de changement et insiste sur le fait que l’université doit continuer à se préoccuper de la qualité de la langue et revenir à certaines mesures comme les tests d’entrée. Selon cette étude, un nombre significatif d’étudiants éprouve des difficultés de vocabulaire (entre 75 et 87,6%), de conjugaison (plus de 70%), de structuration de textes écrits (entre 49,6 et 64,5%), de rédaction de phrases complexes (entre 44,4 et 54,7%), de ponctuation (52,3%), de synthèse lors d’exposés oraux (52,7%), de syntaxes et de grammaire, etc. C’est d’ailleurs la disparition des tests d’admission en français écrit et l’ inquiétude manifestée par un certain nombre d’ enseignants quant à la qualité de la langue de leurs étudiants qui fut à 1′ origine de cette étude.
Étudiants, chargés de cours, professeurs, tous se mobilisent à leur manière autour de la question du français. Partant de son expérience, un autre professseur en formation des maîtres réaffirme l’urgence d’agir : «Actuellement, un étudiant sur quatre en éducation échoue le test de routine du CEFRANC dans l’ensemble des universités québécoises» (Paradis, 2000, p. 5), test qui, par ailleurs, est jugé de niveau cinquième secondaire (Rapport Larose, 2001). En plus, la correction méthodique de travaux d’étudiants dans trois groupe-cours, à l’hiver 2000, révélait qu’en moyenne les étudiants font plus de 30 fautes (orthographe et grammaire) dans un travail de 20 à 30 pages et d’autres peuvent en faire jusqu’à 200» (ibid.). Ici, l’ auteur fait référence uniquement à la maîtrise du code. Il ne dit pas s’il tient compte dans son évaluation de critères relatifs à la cohérence textuelle, au respect de la situation de communication, à la qualité et à la pertinence des informations, au vocabulaire technique ou spécialisé, etc.
Même si cette situation n’est pas imputable à 1 ‘université et remet principalement en cause 1 ‘état de notre système scolaire, cette institution a tout de même une responsabilité à cet égard et davantage lorsqu’il s’ agit d’admettre des étudiants dans un programme où l’exigence langagière est plus élevée qu’ailleurs. C’est le cas en formation des maîtres. L’université doit tenir compte de cette exigence et se donner les moyens qui conviennent afin de détourner les regards inquisiteurs qui sont loin de dorer le blason de cette profession : « Au Québec en 2002, il est possible de devenir institutrice en écrivant autographe au lieu d’orthographe. [ .. . ] de nombreux parents, étudiants et professeurs continuent de me confirmer que cette institutrice est loin d’être une exception.» (Foglia, La Presse, 2002).
En lisant ces lignes, on serait également tenté de donner raison à ces étudiants en éducation qui ont terminé leur programme ou «sont entrés dans la profession» avec une certaine appréhension ou insatisfaction. En effet, dans un mémoire de maîtrise en éducation intitulé Perception des futurs enseignants et des enseignants en exercice du niveau de maîtrise de la langue orale et écrite nécessaire à l ‘exercice de la profession (Zerbib, 1996), 1’ auteur témoigne des limites ressenties par les étudiants en éducation et les nouveaux enseignants en ce qui a trait à leurs connaissances du français. Ceux-ci expriment le besoin de posséder un niveau de maîtrise supérieur à celui qu’ils ont déjà, ce qui démontre que des lacunes n’ont pu être corrigées après trois ou quatre années d’études universitaires ou encore une inadéquation entre les besoins de la profession et la formation reçue. Suite à ce constat, on peut se demander si ces étudiants ont pu bénéficier de moyens concrets pendant leur formation pour redresser leur niveau de compétence en français, en regard des exigences de la profession, et si oui, s’interroger sur la pertinence ou l’efficacité de ces moyens : Actuellement, sur les 120 crédits exigés pour l’obtention d’un diplôme d’enseignement au préscolaire et au primaire, de 6 à 12 crédits sont consacrés au français, soit 1/10 de la formation. Pour le baccalauréat en enseignement du français au secondaire (option majeure), 30 crédits sur 120 sont consacrés à la langue» (Rapport Larose, 2001, chap.3, p. 44 ) .
Bien que Zerbib s’appuie uniquement sur des perceptions, elle révèle un malaise que certains chiffres, déjà cités, viennent confirmer, comme c’ est le cas des chiffres de la citation précédente, qui laissent plutôt perplexe quant à la place du français dans le curriculum de la formation à l’ enseignement.
En somme, s’il n’y a pas toujours eu de bons coups dans cette entreprise de redressement de la qualité du français à l’université, il y a certes eu de bonnes intentions. Mais cela n’est sans doute pas suffisant puisqu’à travers cette petite histoire, on reste avec . une vague impression, qui s’incruste à travers le temps, que plus les moyens se multiplient moins les effets se font sentir. Et lorsque les effets bénéfiques recherchés n’atteignent pas non plus les futurs enseignants, il importe de se questionner de manière plus pressante.
INTRODUCTION |