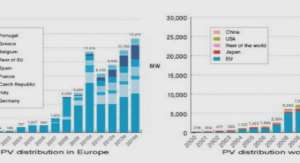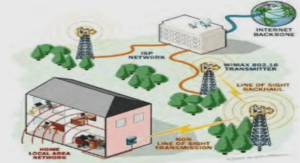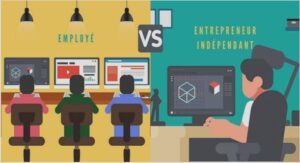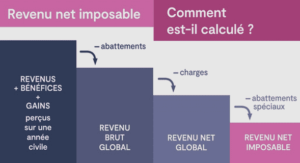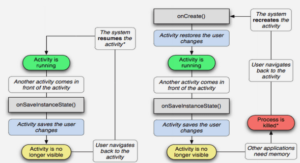En Belgique, deux mesures découlent de la première loi de défense sociale : la mise en observation et l’internement (van de Kerchove, 2010). C’est à cette dernière que nous nous intéresserons principalement. Il s’agit d’une mesure reposant actuellement sur le principe selon lequel les personnes ayant commis des infractions dans un état leur ôtant tout discernement ou contrôle de leurs actes sont considérées pénalement irresponsables. Ainsi, des personnes atteintes notamment de troubles mentaux ou présentant une déficience mentale grave échapperont à une peine potentielle pour se voir imposer une mesure de sûreté à durée indéterminée (Mary, Kaminski, Maes & Vanhamme, 2009). De cette manière, « l’anormal » est mis hors d’état de nuire et peut être soigné en vue d’être réinséré ensuite dans la société (van de Kerchove, 2010). Deux objectifs principaux sont désormais attribués à l’internement : la protection de la société et la dispense de soins adaptés aux internés. En résumé, comme le dit à juste titre Cartuyvels (2018 ; 398), le « régime d’internement oscille entre […] soin et sécurité », avec une préférence inavouée pour la sécurité.
La matière a été modifiée à diverses reprises – sans jamais faire l’objet d’une réorganisation totale –, notamment via la loi du 1e juillet 1964 qui révisera quelques points de la loi de 1930. Une loi du 21 avril 2007 relative à l’internement des personnes atteintes d’un trouble mental était supposée apporter de véritables changements, mais elle n’a jamais vu le jour, la loi du 5 mai 2014 l’ayant remplacée avant son entrée en vigueur (Cartuyvels & Cliquennois, 2015). C’est la transition entre la loi de 1964 et la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement entrée en vigueur le 1e octobre 2016 qui retiendra particulièrement notre attention. Si cette transition est heureuse et attendue, notamment afin de répondre aux vives critiques effectuées par les rapports de la CPT et par la Cour de Strasbourg qui condamna à plusieurs reprises la Belgique (Cartuyvels, 2017), elle crée néanmoins une forme de vide juridique à certains égards.
En effet, l’article 7 de la loi de défense sociale à l’égard des anormaux et des délinquants d’habitude mentionnait que la personne qui « a commis un fait qualifié crime ou délit et qui est dans un des états prévus à l’article premier. […] », à savoir dans un état de démence, de déséquilibre mental ou de débilité mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions, peut être internée. C’est là un aspect du texte révisé par la loi du 5 mai 2014, qui modifie une des conditions spécifiques au prononcé d’un internement dans l’article 9. Actuellement, ne peut être internée que la personne : « qui a commis un crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l’intégrité physique ou psychique de tiers […] ».
En ce qui concerne la situation des individus qui passent du statut de condamné à celui d’interné en cours de détention, elle est toujours prévue par la loi – après qu’elle ait failli passer à la trappe dans la version 2007 de la loi –, mais a également été revue. Alors que l’article 21 de la loi de 1964 concernait : « Les condamnés pour crimes et délits […] », le nouvel article 77/1 restreint désormais l’accès à la mesure d’internement en précisant : « Le condamné qui fait l’objet d’au moins une condamnation pour un crime ou un délit visé à l’article 9, § 1er, 1° […] ». Dorénavant, seuls les individus condamnés pour un crime ou délit ayant menacé ou porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’un tiers sont concernés par la mesure.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi de 2007 une volonté d’éviter une « différence de traitement […] entre une personne malade mentale et une personne saine d’esprit » (Nederlandt, Colette-basecqz, Vansiliette, Cartuyvels, & Pierre, 2018; 53), certains faits étant susceptibles de ne pas donner suite à un emprisonnement de facto, alors que la personne porteuse d’un trouble mental aurait fait l’objet d’une mesure d’internement à durée indéterminée.
Cependant, suite aux modifications de l’article 71 du code pénal par la loi pot-pourri III, l’acquittement n’est désormais plus applicable qu’en cas d’abolition totale des facultés mentales de l’individu, cette loi ayant supprimé les termes « ou gravement altéré » de la version précédente de l’article. Une situation problématique découle donc de ces deux évolutions juridiques : que fait-on des personnes qui ne remplissent pas les conditions de matérialité des faits en matière d’internement, et dont les facultés mentales ont été déclarée altérées, et non abolies ? Seuls les travaux parlementaires portant sur le projet de loi relatif à l’internement indiquent à ce sujet : « dans ces cas, la peine de probation, qui oblige l’intéressé à suivre un traitement psychiatrique, serait certainement appropriée » (2016, n°1590/004 ; 55 ; 2016, n°1590/006), c’est pourquoi nous investiguerons cette option dans le cadre de notre recherche.
Ces travaux parlementaires (2016, n°1590/001 ; 102) font également état du fait que le rétrécissement du champ d’application de la loi va permettre de cibler des personnes dont les faits témoigneraient d’une certaine dangerosité sociale. Mais les caractéristiques de ces personnes sont-elles différentes de celles des autres internés? Scientifiquement, peut-on réellement parler d’une dangerosité moindre chez ces individus ?
Force est de constater que la littérature scientifique ne regorge pas d’études investiguant spécifiquement les caractéristiques des individus atteints de maladie mentale et commettant des faits « mineurs ». Il est donc peu aisé de comparer raisonnablement les individus internés pour des faits portant atteinte à l’intégrité d’autrui, et les individus qui ne peuvent à présent plus être internés pour des faits « mineurs ». Cependant, quelques études interrogent la dangerosité, le risque de récidive, et établissent le profil d’individus placés sous l’ancien article 21 en comparaison des autres internés. Parmi eux, se trouvaient à la fois des individus ayant commis des faits menaçant ou portant atteinte à l’intégrité d’autrui, mais aussi des individus ayant commis d’autres faits, ces derniers représentant justement une proportion de la population n’ayant plus accès à l’internement actuellement. Il ressort de ces études que les individus sous article 21 ne présentent pas de différences significatives au niveau psychiatrique et criminologique en comparaison des autres internés (Vicenzutto & Pham, 2015). Ils ne présentent pas un danger moindre (De Page, Mercenier & Titeca, 2018), ce qui ne justifie donc pas nécessairement leur exclusion de la mesure d’internement. Au niveau du risque statique de récidive, il serait plus élevé que chez les autres internés, notamment en raison de leur parcours délinquant apparaissant relativement plus lourd. D’après les chercheurs Pham, Ducro, Vicenzutto et Jeandarme (2017), ces personnes semblent nécessiter autant de soins que les autres internés, et semblent donc avoir leur place dans les établissements adaptés à la prise en charge d’internés. Néanmoins, les résultats de ces études sont à relativiser, les individus ayant commis des faits mineurs parmi les cas sous article 21 étudiés ne représentant qu’une proportion mineure de l’échantillon, ce dernier ne prenant d’ailleurs en compte que les individus dont l’état se dégrade durant l’incarcération.
Cependant, en ce qui concerne les personnes atteintes de psychoses – qui représentent 40 à 50% des psychopathologies présentes chez les internés –, l’étude de 2018 de De Page, Mercenier et Titeca apporte une information non-négligeable : ils mettent en avant « des corrélations modérées à fortes entre la symptomatologie psychotique et les échelles liées à la dangerosité ». Plus précisément encore, une autre étude portant sur un échantillon de 50 internés psychotiques affirme qu’il n’y a de lien ni entre la gravité des faits et la dangerosité de l’auteur, ni entre la gravité des faits et la gravité des symptômes de la psychose, mais que la dangerosité de l’individu serait bien liée à la sévérité de son atteinte au niveau psychiatrique (De Smet, De Page & Titeca, 2014). Ces résultats viennent donc invalider le raisonnement du législateur qui, au vu de la restriction des conditions d’accès à l’internement, semble avoir considéré que la sévérité des faits commis illustrait la dangerosité de l’auteur.
En effet, dans la situation actuelle des choses, il est tout à fait probable qu’un individu qui a déjà commis des faits mineurs et qui n’a pas (encore) commis de faits portant atteinte à l’intégrité d’autrui échappe à la mesure d’internement alors qu’elle présente un potentiel de dangerosité élevé – par exemple en raison d’une grande avancée dans sa maladie. De nombreuses études se sont intéressées au développement des psychoses et à leur traitement (Large & Nielssen, 2007 ; Nielssen, Westmore & Hayes, 2007 ; Large & Nielssen, 2008 ; Boter, Peuskens, Libiger, Fleischhacker, Davidson, Galderisi, & Kahn, 2009 ; Farooq, Large, Nielssen & Waheed, 2009 ; Langeveld et al., 2014) et il en ressort que plus la prise en charge médicale se fait tôt, plus le traitement se montrera efficace. De même, la dangerosité des personnes psychotiques semble plus élevée lors des premières crises, ainsi qu’avant la prise d’un traitement, et « plus la durée d’évolution de la schizophrénie sans traitement est longue, plus le risque de passage à l’acte homicide serait important » (Richard-Devantoy, Duflot, Chocard, Lhuillier, Garré & Senon, 2009 ; 621). Nous pouvons ainsi envisager que cette même personne est susceptible, avec l’absence de traitement à plus ou moins long terme, de commettre un acte violent à l’égard d’un tiers, alors que si elle avait été prise en charge plus tôt dans l’évolution de sa maladie, le passage à l’acte à l’égard d’autrui aurait peut-être pu être évité.
La situation est transposable aux déficients intellectuels qui sont également concernés par cette loi : sans prise en charge adaptée – qu’il s’agisse d’un traitement médicamenteux ou d’un suivi thérapeutique portant sur le contrôle de l’impulsivité et de la frustration, sur la gestion des émotions, sur la distinction entre le bien et le mal, etc… –, ces personnes sont susceptibles de commettre à nouveau des infractions, peut-être d’une gravité plus importante s’il n’y a pas de conscience de leur sérieux ou de leurs conséquences potentielles.
En ce qui concerne plus précisément la situation des condamnés chez qui un trouble mental apparaît en cours de détention, les modifications apportées par la nouvelle loi posent aussi question. Si un individu incarcéré pour des faits « mineurs » venait à décompenser en cours de détention, il serait tout au mieux envoyé en annexe psychiatrique pour être mis en observation et recevoir un traitement – s’il l’accepte – et une fois son état amélioré – s’il s’améliore – il serait renvoyé en régime de droit commun.
Cependant, les conditions de vie en prison, et plus spécifiquement en annexe psychiatrique, sont interpellantes. Tout d’abord, l’endroit en lui-même est générateur de troubles divers (Archer, 2004 ; Manzanera & Senon, 2004 ; de Brito, 2011) tels que le stress (Agius & Goh, 2010), la dépression (Ridelier, Roustit & Varescon, 2014), l’anxiété et les insomnies, qui sont d’ailleurs des facteurs prédicteurs de l’apparition des pensées paranoïaques (Freeman, Stahl, McManus, Meltzer, Brugha, Wiles & Bebbington, 2012). Plusieurs études attestent du fait que la santé mentale des détenus est plus altérée que celle de la population générale (Thomas, Fovet & Amad, 2015), et ce, en raison des conditions carcérales, mais aussi des caractéristiques psychologiques qui les y ont amenés (Fovet, Thomas & Amad, 2015). Bien que sa vocation se site entre le judiciaire et le médical, le lieu est régi par une logique carcérale et les soins pénètrent difficilement ses murs (Thomas, Fovet & Amad, 2015 ; Kalonji, 2016), se composant principalement de psychotropes parfois prescrits sans examen de l’intéressé (Cartuyvels, 2017), l’endroit rendant impensable la nécessaire relation de confiance entre le soigné et le soignant (Mormont, 2014). Cette situation résulte notamment du manque de moyens alloués à ces annexes qui ne permettent donc pas la dispense de soins de santé de qualité : le personnel qualifié manque, l’espace n’est pas conçu pour prodiguer des soins ou mettre en place des activités thérapeutiques (Kalonji, 2016) … Enfin, l’usage qui est fait des annexes n’est pas adéquat. À l’origine, elles constituaient des lieux destinés à accueillir des détenus mis en observation, mais elles font également office de lieu d’internement pendant des mois, des années, alors qu’elles ne sont pas prévues à cet effet (Cartuyvels, Champetier, & Wyvekens, 2010 ; Mormont, 2014 ; Kalonji, 2015 ; Cartuyvels, 2018). Notons que les soins dispensés en Etablissement de Défense Sociale (particulièrement celui dépendant du Ministère de la Justice) ne sont pas non plus d’une qualité égale à ceux que dispensent les hôpitaux psychiatriques généraux bien qu’ils en aient l’obligation légale (art. 88, loi de principes du 12 janvier 2005) : le lieu reste avant tout une « prison-asile » où le sécuritaire prime sur le soin (Cartuyvels, Champetier & Wyvekens, 2010 ; Cartuyvels & Cliquennois, 2015 ; Cartuyvels, 2017).
INTRODUCTION THÉORIQUE |