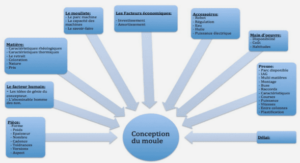Première partie
À New-York
En 1838, la ville de New-York n’était pas ce que nous la pouvons voir aujourd’hui ; mais elle était déjà très importante par son gros commerce. Hâtivement bâtie à l’embouchure de la rivière Hudson, elle n’avait pas la symétrie et la correction de ligne qu’on lui trouve de nos jours, et on ne l’avait pas encore décorée de ses mille tours de Babel. Elle n’était pas encore devenue la capitale de la finance juive ; en 1838, New-York était le lot presque exclusif de commerçants d’origine anglaise, et sa société, en dépit de certaines originalités qu’on s’efforçait d’inventer, et en dépit également de son puritanisme trop affecté, demeurait une société purement anglaise.
Seulement, comme on venait de se séparer du régime britannique, il importait de changer ses habitudes, son mode de vivre, son costume, sa façon de parler. On ne voulait plus être anglais, mais des « Américains », et que les Anglais, par revanche ou ironie, surnommèrent « Yankees ». Tout de même, ces Américains ne pouvaient ignorer que leur prétention n’effaçait nullement leur origine, et c’est peut-être à cause de cette reconnaissance même qu’ils continuaient de demeurer de vrais Anglo-Saxons. Ensuite, dans les nouveaux États américains, tout comme en Angleterre, on était bien forcé d’ouvrir ou de fermer les portes, puisqu’on avait là aussi des portes à fermer ou à ouvrir. Mais voilà, nos étranges voisins eurent l’air de prétendre que les portes pouvaient être fermées et ouvertes d’une toute autre façon.
Plus tard ils eurent raison positivement : car ils avaient réussi à modifier leur physionomie ethnique, leurs allures et leur langage qu’on n’aurait pu les regarder comme issus d’une race européenne. Les Américains semblaient donc avoir justifié l’appellation des Anglais : c’étaient des Yankees. Une chose sûre, ces Yankees avaient alors pour notre race canadienne-française une sympathie que, hélas ! nous ne retrouvons plus guère. Cette sympathie fut la raison pour laquelle tant de nos Canadiens pourchassés par les agents anglais trouvèrent, durant nos troubles politiques de 1837 à 1839, un refuge sûr dans les États américains.
L’American-gentleman
La nuit est venue. Nuit d’octobre, froide, épaississement voilée de nuages que charrie un grand vent de l’ouest. Ce vent soulève violemment les eaux du Lac Champlain, si célèbre dans l’histoire militaire de l’Amérique du Nord. Sur la plage et contre les rochers sonores en roulant leur écume les lames mugissent en un soupir qui s’égare dans la tourmente.
Cette plage est déserte.
Toute la nature et tous ces lieux sont déserts.
Nul être vivant n’apparaît.
Là-haut, les monts noirs frémissent sous l’aile rude et rapide des nuages gris, et rien ne trouble leur silence morne que leurs propres gémissements. Entre ces monts et la plage du lac, les pins dressant leur cime centenaire, les épinettes élevant leur flèche tourmentée, les cèdres craquant sous le poids de leur ramure trop violemment secouée dessinent leur sombre amphithéâtre avec des rumeurs plaintives.
Et la nuit, à mesure qu’elle progresse, semble devenir plus noire et l’ouragan plus impétueux.
L’étranger, qui se fût trouvé à ce moment en ces lieux sauvages et d’aspect si terribles, se serait cru à jamais séparé du monde des vivants, si un signe de vie humaine ne s’était tout à coup révélé à lui.
En effet, là-bas, et comme surgissant des ondes mêmes, une lueur brillait. Oui, l’on pouvait voir sur le lac, et pas très éloigné du rivage, un rayon de lumière. Ce rayon montait, s’abaissait, s’élevait à nouveau ; et parfois l’on eût pu croire, par l’éclat plus limpide qu’il jetait, que c’était une étoile tombée des cieux dans ces eaux furieuses.
Mais non, c’était simplement la lueur d’un falot, et ce falot était accroché au mât d’artimon d’un petit navire rudement balancé par les vagues et difficilement retenu par ses ancres.
Que fait là ce navire ?
Il attend, mais il voguera bientôt. On le prendrait pour un navire-fantôme : le jour on ne le voit pas, il dort dans quelque rade ou crique où on ne le dérangera pas ; la nuit, toutes voilées déployées, il navigue.
Pourquoi ce mystère ?
Pourquoi ? Parce que M. Duvernay a réussi, avec l’aide de ses amis, à charger ce petit bâtiment de fusils américains, de quelques canons et d’une bonne quantité de munitions de guerre.
Ce navire est la propriété d’un gros industriel de Montpellier, de l’État du Vermont, qui l’a mis à la disposition des Patriotes canadiens. Cet industriel – dont le nom fut toujours gardé avec le secret le plus impénétrable – avait en outre versé une belle somme d’argent pour l’acquisition de machines de guerre. Son petit navire portait son nom, mais pour ne pas compromettre ce généreux ami de la cause canadienne, le nom fut remplacé par celui-ci : The American-Gentleman.
Le chargement avait été complété deux jours auparavant, dans une petite anse où l’on ne redoutait aucune surprise des émissaires anglais ou des agents américains. Jusqu’à ce soir-là, il avait navigué une nuit pour s’arrêter avant l’aube suivante en ces lieux où nous sommes, c’est-à-dire en une sorte de rade circulaire que la nuit ne permet pas de décrire. Mais dès après la brume de ce jour-là le petit navire est sorti de la rade, afin d’être prêt, la nuit totalement venue, à voguer.
L’équipage a été choisi par l’industriel personnellement : il se compose d’un pilote et de sept manœuvres. Ce sont des Américains, marins de métier, des hommes dévoués et courageux. Cependant, sur les instructions expresses de M. Duvernay, cet équipage a été placé sous les ordres d’Hindelang et de M. Rochon. Ce sont eux qui sont responsables des marchandises précieuses que porte le navire. Et l’on estimait d’autant plus ces marchandises, qu’on avait mis deux semaines à les transporter à travers monts et bois avant de les embarquer. Il avait fallu suivre un chemin très difficile par les montagnes, chemin sans cesse obstrué d’arbres renversés, de fondrières, chemin qui avait été frayé soixante ans auparavant par l’armée du général américain Schuyler, lors de la tentative de conquête du Canada par les Américains.
Depuis cette époque ce chemin n’avait été parcouru qu’à de rares intervalles par des Indiens, des chasseurs ou des excursionnistes, et il devenait d’année en année impraticable. N’importe ! on avait réussi à y passer sans accident le matériel de guerre qu’on emmenait au Canada.
La nuit avançait encore. Les vents avaient diminué de violence. Les nuages, moins épais, couraient toujours très vite, mais de temps en temps la lune en montant de l’horizon de l’est pratiquait une déchirure et hasardait sa face blanche pour regarder le lac. Et comme apeurée par les bruits de la tourmente qui rasait la terre, elle rejoignait les lambeaux de nuage et se cachait. Alors la nuit semblait plus obscure.
C’est à l’un de ces moments d’obscurité funèbre que des ombres humaines surgirent tout à coup des bois avoisinant la place du lac. Ils s’approchèrent tout près des eaux clapoteuses, et l’un d’eux, ayant élevé ses deux mains en visière au-dessus de ses yeux, prononça en anglais d’une voix basse :
– Boys, nous les tenons ! Voyez cette lumière là-bas vivement ballottée !
– Ho ! ho ! firent une dizaine d’hommes armés de fusils.
– Allez chercher le canot… pas un mot… pas un bruit ! commanda celui qui avait parlé.
Les dix hommes, ou mieux les dix ombres s’enfoncèrent sous bois, glissant silencieusement. Ils revinrent dix minutes après portant sur leurs épaules un léger canot muni de rames et de câbles.
L’embarcation fut déposée sur l’eau moutonneuse, les inconnus embarquèrent, prirent chacun une rame, et leur chef commanda :
– Allez !
Mais cet homme, tout à coup poussa un juron.
– Boys, dit-il, nous sommes arrivés trop tard !
– Ho ! ho ! firent les dix ombres qui ramaient.
– Voyez cette blancheur qui se balance, ne dirait-on pas que le navire déploie ses voiles ? Regardez !
– Ho ! ho ! firent encore les voix ahuries des rameurs.
– Un bon coup de rames, boys, cria le chef, le bâtiment appareille !
Courbés sur leurs rames, les dix hommes, le souffle rude, dédoublaient d’efforts. Et la légère embarcation sautait de lame en lame et diminuait très rapidement la distance entre elle et le navire, dont on commençait à distinguer la confuse silhouette sous ses voiles blanches qu’on hissait l’une après l’autre.
Et sur le pont du navire maintenant on apercevait les lueurs agitées, semblant courir çà et là, de plusieurs lanternes. On pouvait même entendre des éclats de voix que le vent emportait dans l’espace. Mais le petit navire ne demeurait plus stationnaire : il avait semblé au chef de l’embarcation qu’il se déplaçait peu à peu. Dans la crainte de manquer la prise précieuse après laquelle il courait, il jeta encore cet ordre :
– Steady, boys ! steady