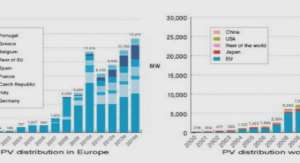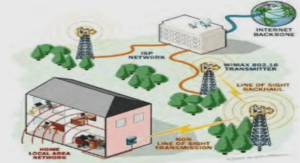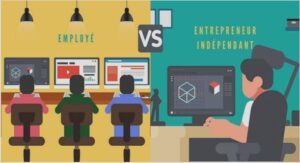Si les avancées en matière d’intégration du genre dans les politiques publiques, programmes et projets de développement sont lentes, très lentes, le contexte actuel n’est pas favorable à une évolution, au contraire il risque même d’être contraignant. Dans de nombreux pays en effet, le contrat social semble avoir été rompu entre une jeunesse confrontée à des taux de chômage de plus en plus élevés et des Etats qui se sont attachés à flexibiliser, le plus souvent en vain, le marché du travail. Dans un tel contexte, les inégalités de genre ont eu tendance à passer au second plan. Au Maghreb et au Moyen Orient, cette situation pourrait être compromise encore un peu plus par l’arrivée des islamistes au pouvoir avec un risque de recul des Etats de cette région quant à leurs engagements internationaux en faveur du genre. Pourtant les inégalités de genre sont au cœur de la problématique qui tend vers une plus grande égalité dans l’ensemble de la société. Avancer dans le sens de la réduction de ces inégalités de genre est possible car des opportunités existent, mais cela nécessite d’abord de prendre la mesure de ce qui les détermine ou de ce qui les contraint.
Une nouvelle approche du développement
Ce n’est qu’après la seconde guerre mondiale et les premiers travaux de comptabilité nationale visant à mesurer la croissance de la production nationale que la notion de développement économique a commencé à s’installer dans la réflexion économique. Certes la mesure de la production nationale annuelle devait naturellement déboucher sur le concept de croissance économique, mais parallèlement la notion de développement économique et social se frayait un chemin pour donner un sens nouveau à celle de progrès, notamment pour les pays nouvellement indépendants. Par la suite fut forgé le concept de développement durable, lorsque les premières inquiétudes sur le caractère considéré jusqu’alors comme illimité des ressources naturelles commencèrent à se faire jour.
On a longtemps considéré, et on continue encore souvent à considérer le Produit Intérieur Brut (PIB) par tête – qui a pris progressivement la place du Produit National – comme un indicateur de niveau de vie des populations. Ce qu’il n’est pas, de l’avis même de ses concepteurs. Le PIB par tête converti en dollars est cependant devenu l’indicateur de référence permettant de classer les pays sur l’échelle de la croissance et le rapport sur le développement dans le monde de la Banque Mondiale établit annuellement ce classement. Le dollar des Etats Unis n’ayant pas le même pouvoir d’achat dans tous les pays du monde, le PIB par tête est désormais calculé en parité de pouvoir d’achat, ce qui est une façon de se rapprocher d’un indicateur de niveau de vie.
Mais le développement ne saurait se limiter à la seule production de richesses matérielles et le facteur humain fut le premier à être mis en avant pour venir compléter l’indicateur du PIB. Théodore Schultz (1971) et Gary Becker (1964) s’efforcèrent ainsi d’intégrer le capital humain mesuré en termes d’éducation et de formation, et de santé, aux théories de la croissance économique dont Walt Rostow (1960) avait formulé les étapes. François Perroux, dans l’Economie du XXème siècle (1961), plaidait pour « le développement de tout l’homme et de tous les hommes ». Mais il devait véritablement revenir à Amartya Sen (1987) d’en tirer les conséquences ultimes en contribuant à la définition d’un nouvel Indice de Développement Humain (l’IDH), développé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) à partir de 1990. L’IDH adjoint au PIB par tête PPA, les indicateurs d’espérance de vie à la naissance d’une part, et d’alphabétisation des adultes et de taux de scolarisation combiné (primaire, secondaire et supérieur) d’autre part. Le développement est alors conçu comme une progression des capacités (« capabilities ») des individus (éducation, santé), mises en œuvre à travers des opportunités (emploi, moyens de production) et par la représentation dans les instances de pouvoir où l’on peut se faire entendre (« agency »).
Jusque là, les théories du développement se satisfaisaient d’une « neutralité » au regard du genre. Il ne venait à l’idée que d’un très petit nombre de théoriciens (Margaret Reid, 1934 ; Marilyn Waring, 1988) qu’en demeurant aveugle au genre, on privilégiait une approche qui faisait fi de la moitié de la population et de la contribution invisible des femmes (leur travail non rémunéré dans la sphère domestique) ou de leur sous-estimation dans le PIB (leur travail dans des activités économiques prises en compte par le PIB mais mal mesurées car exercées sous le statut d’aide familial ou de type informel).
Les travaux d’Ester Boserup (1983), cités par Christine Verschuur (2009) ont cependant permis de montrer, dès les années 1970, des différences d’impact du développement sur les femmes et sur les hommes et de remettre en cause la thèse selon laquelle le développement serait neutre au regard de l’égalité des sexes. Ses travaux montrent qu’en plus du fait que les projets de développement ne tenaient nullement compte des principes d’égalité, ils ont affaibli l’autonomie des femmes et leurs opportunités économiques. En s’intéressant au travail des paysannes africaines, asiatiques et latino-américaines, ce travail a également contribué à la prise de conscience, dans le monde de la coopération, de l’invisibilité des paysannes dans le tiers monde.
Mais ce ne sera seulement qu’avec la Conférence de Beijing en 1995 et le rapport mondial sur le développement humain de la même année, préparé à l’occasion de la Conférence, qu’une véritable prise de conscience va se faire jour et que des efforts vont être entrepris ici et là, puis de façon plus systématique, en vue non seulement de prendre la vraie mesure de la contribution des femmes au développement, mais aussi – et corrélativement – de faire en sorte qu’elles en soient aussi bénéficiaires. Les deux aspects étant liés, puisque l’on peut considérer que le moindre bénéfice que tirent les femmes du développement vient notamment du fait que leur contribution à celui-ci est largement sous-estimée. Le concept de « féminisation de la pauvreté » est d’ailleurs explicitement lié à ces représentations du développement. D’où la création d’un Indice Sexo-spécifique de Développement Humain (ISDH) et d’un Indice de Participation des Femmes (IPF), ce dernier correspondant à la notion d’autonomisation (ou « empowerment ») et à l’« Agency » dans la théorie de Sen.
On notera d’ailleurs que le Rapport de la Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social, dite commission Stiglitz, Sen et Fitoussi (2009), a intégré dans ses réflexions, à côté des questions environnementales (le PIB vert), la question du travail domestique (les « tâches ménagères », et plus largement les soins apportés aux enfants, personnes âgées, malades au sein du ménage), notant que le nombre d’heures qui y sont consacrées est du même ordre, sinon supérieur, que celui consacré au travail économique mesuré par les PIB.
S’il est vrai qu’aujourd’hui la problématique du développement économique s’est définitivement adjoint le qualificatif de durable, en faisant de l’aspect environnemental une dimension essentielle du concept, la dimension sociale n’en reste pas moins primordiale et la question du genre en constitue un des aspects encore trop souvent négligé mais qui ne pourra qu’y prendre plus de place dans l’avenir.
La construction du champ de savoir « femmes/genre et développement »
Depuis la première conférence mondiale sur les femmes tenue à Mexico en septembre 1975, un nouveau champ de savoir « femmes/genre et développement » s’est constitué, rattaché aux mouvements féministes, aux recherches dans les milieux universitaires et dans les agences de coopération. Ce champ de savoir s’est développé parallèlement à celui des études sur le développement.
Alors que les années 1960 ont connu l’affirmation de la spécificité féminine, les années 1970, avec l’émergence du concept du genre, vont voir les études sur les femmes s’ouvrir à d’autres champs d’analyse ; Et c’est à partir des années 1990, après la conférence de Beijing, que le champ de savoir « genre et développement » va connaître un nouveau souffle. Il s’est développé parallèlement à celui des recherches sur le développement et celui sur les recherches sur le genre.
Trois grandes étapes identifient la construction de ce champ de savoir : La reconnaissance du travail invisible des femmes et l’articulation entre la sphère reproductive et la sphère productive ; L’analyse des transformations liées à la nouvelle division internationale de travail ; et l’approfondissement des questions ouvertes par les recherches antérieures, notamment celles liées à l’identité.
Introduction générale : Problématique |